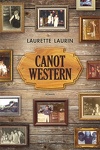Commentaires de livres faits par bellajessica
Extraits de livres par bellajessica
Commentaires de livres appréciés par bellajessica
Extraits de livres appréciés par bellajessica
 Editer
Editer
— Pour notre fille, le théâtre est un jeu, lui répondit Agnès, Aristide n’acceptera jamais qu’elle en fasse une carrière.
Au fond d’elle-même, elle éprouvait un brin de tristesse. Elle aurait aimé que son mari prête davantage attention au talent d’Ophélie, qu’il daigne la féliciter de temps à autre. Sentir l’estime de son père était une chose importante. N’était-ce pas dans son regard qu’une fille constatait pour la première fois sa valeur de femme ? Elle-même avait eu tellement de plaisir à pratiquer cet art de la scène et à l’enseigner ; si le mariage n’avait pas interrompu ses aspirations, elle serait probablement là aujourd’hui, sur les planches, à cueillir les bravos. Mais les regrets étaient inutiles ; en acceptant de devenir la femme d’Aristide, elle avait choisi d’orienter sa vie différemment.
Les acteurs étaient retournés derrière le rideau, la salle se vidait.
— Venez, madame Renée, l’invita-t-elle. Ophélie doit nous attendre dans sa loge, elle sera heureuse de vous voir.
En les apercevant dans les coulisses, Rémi s’avança à leur rencontre.
— Mon grand frère n’est pas avec vous ? s’étonna-t-il.
— Aristide est à son club de tir, il avait une importante compétition aujourd’hui.
— Ah bon !
— Il avait promis de venir… si ça se terminait assez tôt. Mais oublions-le puisqu’il n’est pas parvenu à se libérer. Où est ma mignonne petite vedette ?
À moins qu’elle n’en soit pas consciente, toute à son plaisir de chanter devant un public. Son public. Toujours fidèle. Ému. Je l’ai alors vue autrement que comme une chanteuse infirme passée de mode. J’ai découvert une artiste. M’est revenue en mémoire la célèbre citation du Petit Prince de Saint-Exupéry : « On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. »
J’ai vécu de nouveau cette expérience avec Marie Lord un samedi soir, lors de son premier spectacle de la soirée. Je l’ai regardée avec les yeux du cœur.
Ce samedi-là, Marie Lord monte sur la scène dans sa robe lilas à volants. Elle prend le micro et dans un geste théâtral, elle fait signe aux musiciens de ne pas jouer. Elle garde un moment de silence, immobile. Les clients se taisent. On entendrait une mouche voler. Les serveuses s’arrêtent en plein vol avec leur cabaret surchargé. Marie Lord fait sentir à tout le monde que l’heure est grave. Tout le monde la croit.
Elle relève la tête lentement et elle pose son regard sur l’homme à la chemise lilas assis au fond de la salle.
Je me tiens au coin d’une rue tapageuse de New York en mâchant un bretzel géant, et mon petit ami a un comportement étrange. Je le relève à peine parce que cette ville est pleine de bruit. Nous sommes là pour une projection du court-métrage de Simon à un festival, et il me semble qu’il est un peu agité. Son film le rend nerveux, je pense. Puis je reprends une bouchée de bretzel. Je replonge dans une rêverie de diner yankee et de pommes de terre rissolées.
Je suis trop enfoncée dans mon resto virtuel pour remarquer que Simon achète juste sous mon nez deux verres à shot I Love New York et une demi-bouteille de champagne. Alors quand il tombe à genoux au sommet de l’Empire State Building, c’est plus qu’un choc. Je ne l’avais tout simplement pas vu venir. Ça ne m’avait même pas traversé l’esprit.
Sa Voix dans cette position est plus aiguë et stressée que jamais, et la Rêveuse est perplexe. Le mariage ? Je n’y avais jamais songé. Mais maintenant qu’il a une voix, ce concept semble soudain la plus fantastique, la plus prodigieuse et la meilleure idée du monde entier – et de New York. Dis-le avec ta voix normale, lui réponds-je en couinant moi aussi, et la Voix le répète dans ses habituelles LETTRES CAPITALES. Ruth Patricia O’Neill, veux-tu m’épouser ? OUI ! crié-je – en capitales également –, et du haut de ce gratte-ciel, les rêveries et la réalité s’enlacent comme si elles n’étaient qu’une seule et même chose.
Mes enfants sont des squatteurs de matelas notoires. On dirait qu’ils vagabondent la nuit, leurs petits corps chauds se faufilant à la recherche de plis frais dans tous les lits qu’ils croisent. Plus il y a de lits, mieux c’est.
Chaque année de mariage supplémentaire, nous sommes passés à des lits plus grands, plus confortables. À des couettes plus sophistiquées. Un solide navire sur les rives d’une vie partagée, avec suffisamment de couvertures à motifs et de coussins rembourrés.
Par le passé, nous avons vécu dans la campagne de Louth. Après trois ans de mariage, notre vie commune a connu un glorieux crescendo avec le vaisseau mère de tous les lits-navires : un mastodonte de deux mètres, une bête magique de bois foncé et de miles de matelas. Nous...
Sigalit releva la tête, examinant les alentours. D’instinct elle avait évité les halles commerçantes du centre, elle avait contourné les parcs de plantes aquatiques et traversé le district des herboristes, avec ses ateliers où fermentaient les meilleures lotions et les poisons illégaux de Bo Chaï. Cette part de la cité constituait une sorte de transition, entre les quartiers fréquentables du centre et ceux plus mal famés, plus pauvres et plus sombres de la périphérie.
Les traditionnelles lanternes vertes du district des herboristes conféraient à la nuit une aura délétère, une atmosphère malsaine de marais. Ici les vivants dormaient. Seuls les fantômes peuplaient les rues. Celui d’un pauvre hère tendait la main sur le seuil d’une échoppe, même si la misère ne le tourmentait plus. Celui d’une jeune fille se recoiffait à un balcon à l’étage, son fin visage maculé de taches sombres, elle était morte empoisonnée. Celui d’une marchande de sangsues arpentait les passerelles avec encore des bocaux s’entrechoquant au bout de son bâton de marche. Certains spectres, Sigalit ignorait pourquoi, poursuivaient dans la mort les activités de leur vie, même et surtout si celles-ci s’avéraient dénuées de sens. Cela pouvait paraître ridicule, mais qui était-elle pour juger ?
Peu après être devenue générale, Rangsei s’était lassée d’elle, dans l’intimité en tout cas. En façade elles étaient toujours en couple, et de fait Sigalit n’avait jamais envisagé de se tourner vers une autre femme. Elle aurait eu trop à perdre. Alors que leur histoire prenait l’eau, Rangsei s’était révélée d’une jalousie possessive. Sigalit lui appartenait, la générale le lui avait amplement fait comprendre. Et si la Voix de Bohen était aimée par le peuple, elle faisait moins l’unanimité auprès des dirigeants de Bo Chaï. Face à eux, elle avait besoin de l’appui de l’amazone. Elle n’aimait pas le jeu des convenances mais elle s’y adaptait.
Je l’imitai, déclarai que j’étais content de l’avoir revu, le raccompagnai jusqu’à la porte de mon bureau et, après avoir entendu se refermer celle de l’entrée, retournai à ma fenêtre. Bobby fit halte à mi-chemin du coin de rue suivant devant le Rags N Riches, la friperie d’Ellie. Le vieil Ezra était là. Personne ne savait grand-chose d’Ezra. Un montagnard, disaient certains, alors que d’autres le tenaient pour un cinglé intégral ou un ancien combattant de deux guerres, à moins que ce ne soit tout ça à la fois. Il réapparaissait de temps à autre, vivait dans la rue, ne mendiait jamais ni argent ni nourriture mais acceptait de bonne grâce tout ce qu’on lui offrait. En vertu d’un accord tacite, la ville entière prenait soin de lui.
Bobby lui parla un moment, sortit son portefeuille et lui donna une liasse de billets. Ezra enfouit l’argent dans la poche de la plus profonde de ses trois chemises superposées et lui serra la main. Ils partirent chacun de son côté.
Bobby boitait. De façon à peine perceptible, mais c’était là. Il ne traînait pas la patte, donc il y avait peu de chances que ce soit neurologique. Sa démarche n’était pas non plus saccadée, ni marquée par les tressaillements typiques des problèmes de hanche ou de genou. Quelque chose de profond, de permanent, pas une foulure ou un claquage. Une vieille fracture, peut-être, assortie d’une perte osseuse qui avait un peu raccourci une de ses jambes.
Je le suivis des yeux jusqu’à ce qu’il ait tourné au coin de Mulberry. Puis je vérifiai par deux fois que le verrou était mis et me refis du café.
Maintenant que je suis chez moi, plutôt que de me cacher, je fonce vers le réfrigérateur où je prends un Palm Bay, une boisson alcoolisée très sucrée. J’aurais préféré un bon verre – la bouteille complète, probablement – de vin blanc frais, mais le Palm Bay est tout ce que j’ai sous la main pour l’instant. Ça fera bien l’affaire. Sans tenir compte de mes vêtements, qui pourraient s’abîmer, je m’installe directement sur les marches de béton de mon balcon, à l’avant de la maison. Ce n’est pas dans mes habitudes de boire face à la rue – je garde plutôt ça pour la cour arrière –, mais c’est le seul endroit où il y a encore du soleil et je veux en profiter, question de me réchauffer le cœur.
Une fois assise par terre, ce qui représente ma situation – je suis au plus bas –, j’ouvre la canette et en prends une grosse gorgée. Il me semble que ça va déjà mieux. Je termine rapidement ma boisson et je vais m’en chercher une autre à l’intérieur. Je me réinstalle à la même place, toujours sous les chauds rayons. J’ouvre la deuxième canette. Elle coule dans mon gosier aussi bien que la première. Je soupire un long moment. J’aimerais vraiment avoir quelqu’un à qui me confier présentement. Un chum, une amie, n’importe qui. Le premier a déserté ma vie il y a quelques mois. Les deuxièmes sont, pour la plupart, toutes occupées avec leur merveilleuse progéniture. Il est près de dix-sept heures trente. À cette heure, et surtout avec cette température, c’est idéal pour emmener les enfants au parc, pas pour aller boire sur une dalle de béton froide avec une amie pas de vie qui pleure parce qu’elle a perdu son emploi.
Comme je n’ai personne à qui me confier, je décide de faire part de ma peine au monde entier. C’est moins intime, mais ça a le mérite de me soulager légèrement. J’écris sur mon mur Facebook : « Après une journée de merde et de grosses émotions, je bois toute seule sur mon balcon. Cheers ! » Maintenant que c’est fait, je dépose mon cellulaire près de moi et j’attends de voir si certaines personnes vont commenter mon statut. Il faut environ une minute avant qu’une connaissance le like et me demande ce qui se passe. Je regarde le commentaire, dubitative. Je me lève pour aller chercher une troisième boisson. À mon retour, cinq personnes m’ont déjà questionnée. Je regrette d’avoir voulu partager ma peine au monde entier, finalement. Je n’ai pas envie de m’étendre en commentaires sur les réseaux sociaux. Mes sentiments sont contradictoires, ce soir. Pas étonnant après les émotions vécues aujourd’hui. J’éteins mon cellulaire et le dépose près de moi, face contre le ciment.
Il est 7 heures à Paris, et c’est encore un jour de pluie. Anna est étourdie par ce réveil tonitruant. Elle se sent lourde, très lourde, comme après un entraînement de natation, lorsque au moment de sortir de l’eau, le corps semble peser beaucoup plus qu’avant. Cette pesanteur lui donne envie de se rendormir.
Soudain, Anna se remémore son rêve. Surtout ce magnifique cheval blanc, elle est fascinée. Quelle beauté ! Et quelle lumière ! Anna n’a qu’une envie : retourner là-bas, dans son rêve. Elle s’y sentait si bien et c’était si beau. Quand elle pense à sa journée qui ressemblera certainement à toutes les autres, elle ressent un profond sentiment de lassitude.
Anna est graphiste. Elle travaille pour une entreprise automobile, et les projets qu’on lui propose sont toujours un peu les mêmes. Elle songe depuis longtemps à changer de métier pour enfin laisser s’exprimer complètement sa créativité. Mais elle a peur du changement, peur de trouver pire, peur d’être encore plus malheureuse. Chaque jour elle se dit qu’elle va passer à l’action, et chaque jour elle trouve un prétexte pour remettre ses projets au lendemain. Cette procrastination la poursuit depuis de nombreux mois, mais rien n’y fait, elle ne trouve pas l’énergie pour changer sa vie professionnelle.
Et puis elle pense à sa situation amoureuse. Laurent l’a quittée brusquement après trois ans de relation, dont deux de vie commune. Sans aucune explication, lâchement, il a pris ses affaires et il est sorti de la vie d’Anna. Quand elle est rentrée chez elle ce soir-là, elle n’a trouvé que le double des clefs sur la table de la cuisine et un « excuse-moi » écrit en rouge sur un Post-it jaune. Sous le choc, elle a pensé à un truc bête : du rouge sur du papier jaune... Pour être certain que je voie le papier ou pour souligner l’urgence du départ ? Puis Anna s’est effondrée en larmes. Choquée par le geste de Laurent, aussi soudain qu’incompréhensible, tremblante de chagrin, elle a composé le numéro de Mathilde, la seule à qui elle pouvait parler.
Mathilde, c’est la meilleure amie dont tout le monde rêve. Elle est belle, flamboyante, forte, courageuse, dotée d’un humour dévastateur à vous faire oublier en une fraction de seconde vos problèmes du moment. La quarantaine pulpeuse, Mathilde est un cocktail explosif de générosité et de sensualité. Dans le petit groupe d’amis dont Anna fait partie, elle materne tout le monde. C’est elle que l’on appelle quand ça va mal. Et quand on appelle Mathilde, elle accourt : « Quoi ?! Mais pourquoi ? s’était exclamée Mathilde lorsque Anna avait enfin pu articuler trois mots au téléphone. Il est débile ! On ne fait pas ça ! On s’explique avant ! Bouge pas, j’arrive ! »
Mes pensées sont fixées sur Trussardi. Je suis trop occupée pour passer des heures à éplucher les journaux. Par contre, je consulte mon iPad quotidiennement pour noter les crimes récents, les affaires qui risquent de m’échoir. Le meurtre de Laura St-John Trussardi a éclipsé l’éventail hebdomadaire habituel de coups de couteau, viols et pornographie. Les détails macabres de sa mort (ceux que les journalistes ont été autorisés à révéler) attiraient l’attention grâce aux photos tirées des pages mondaines. Ce n’est pas tous les jours qu’une personnalité notoire de la haute société se fait assassiner.
Bien qu’il s’agisse d’une histoire atroce, je ne ressens que de l’exaltation. C’est le crime du mois, peut-être de l’année, et c’est moi qui assure la défense. D’accord, les chances d’acquittement ne sont pas très élevées. La victime a été tuée dans le lit conjugal avec l’arme de son mari, après tout. Mais il est encore tôt. Il y a encore beaucoup de détails inconnus et l’avenir peut nous réserver des surprises.
Au bout du compte, nous n’avons besoin que d’un doute raisonnable. Les bureaux de mon modeste cabinet, pompeusement nommé Truitt et Cie, sont situés à l’ouest de la prison. Toutefois, la rue à sens unique m’emmène vers l’est, dans les rues étroites au nord de Hastings : pubs à l’étage inférieur, vitres brisées au-dessus et détritus des activités de prostitution, d’abus d’alcool et de drogue de la veille éparpillés sur le trottoir. Je tourne à droite vers les immeubles géorgiens en brique du quartier distingué de Gastown.
Je gare ma voiture et prends l’ascenseur jusqu’à mon bureau. Trois ans plus tôt, dans un élan rempli de doute, j’ai signé le bail de cet espace situé dans un ancien entrepôt. Murs en briques délavées, puits de lumière... Rien de prestigieux comme les espaces à bureaux des tours du centre-ville, mais près de tout ce qui est important dans ma vie : les tribunaux, les criminels et une poignée de restaurants à la mode. Construisez et ils viendront. Ils sont venus : Jeff Solosky et Alicia Leung, mes anciens associés. Et bien sûr Debbie, pour laisser entrer les visiteurs bienvenus et bloquer l’accès aux autres.
Je m’arrête devant une meurtrière où il n’y a personne, je pousse ma charrette contre la palissade et regarde, moi aussi. Le côté gauche du vieux bâtiment est encore presque intact, un bulldozer rouge tend vers le ciel sa mâchoire d’acier et broie gouttières, armatures et réclames lumineuses qui ne s’éclaireront plus jamais. Au centre, un bulldozer bleu, muni d’un pilon gros comme un tronc d’arbre, martèle le béton armé. Sur la droite, tous les murs ont déjà été déblayés ; dans le trou, une pelleteuse jaune ramasse du gravier blanc. Je me demande si c’est encore la base du sous-sol ou déjà l’ancien lit de la rivière qui, il y a cent, mille et cent mille ans, serpentait dans cette vallée.
Les vieillards évitent soigneusement tout contact visuel. Moi de même. Nous suivons des yeux les sols qui s’effondrent et les murs qui s’écroulent, et chacun plonge dans ses souvenirs de l’ancien grand magasin. L’un se rappelle peut-être y avoir acheté en 1967 une paire de tennis, un autre y avoir fait l’acquisition au rayon disques, en 1971, de son premier vinyle de Jimi Hendrix. Moi, je me souviens qu’au milieu des années 1970, à l’endroit où le bulldozer bleu martèle le sol, travaillait au rayon boucherie une ravissante vendeuse rousse aux yeux verts. Son décolleté était parsemé de taches de rousseur. Aujourd’hui, elle doit être retraitée. Si elle vit encore.
Et puis, quand nous avons regardé tout notre soûl, chacun reprend son chemin.
Chaque matin, en ouvrant ses volets, Christian contemple son fief, ainsi qu’il aime à nommer cette ferme camarguaise, moins parce qu’il en a hérité que parce qu’il se sent appartenir à ce pays de terre et d’eau. Depuis la croisée, le marais s’étire à perte de vue, comme écrasé par l’immensité du ciel. Au nord, on distingue d’anciens pâturages, la roselière percée par les roubines, où les pousses de joncs et de roseaux pointent déjà. Ces herbiers immergés abritent une infinité d’oiseaux : hérons pourprés, butors, grèbes, flamants roses, râles d’eau, poules et foulques, busards, rousserolles et mésanges à moustaches, sarcelles, nettes rousses, grandes aigrettes, sans compter la multitude de canards sauvages. Un petit paradis, où Christian mènera son projet à bien… C’est pour ses protégées qu’il a quitté Paris après sa séparation avec Paola, pour elles qu’il a renoncé à son ancienne vie, qu’il se retrouve loin de son fils… pour les oies naines.
Ce matin, il prend juste le temps d’avaler un café. Il a reçu le matériel pour la couveuse hier, et il compte bien la monter avant l’arrivée de Bjorn, qui doit passer lui livrer les œufs.
Le séjour à Paris est déjà relégué au rayon des mauvais souvenirs. Maintenant que son choix est fait, il refuse de se laisser miner davantage par cet imbécile de Ménard. Dès sa descente du train, il lui a suffi de respirer les effluves iodés pour retrouver la foi. Christian est un rêveur obstiné qui oublie parfois d’être pragmatique. Son ex-femme le lui a tant reproché !
Aurélien dort nu, étendu sur notre lit, son corps longiligne, doré par l’été, repose de côté sur la blancheur des draps. Son visage au nez osseux, aux lèvres boudeuses et aux longs cils se dessine de profil parmi les boucles brunes de ses cheveux dénoués, il a la beauté d’un homme heureux. La lumière du dehors le gêne, il grogne, se cache sous l’oreiller.
Cette nuit, nous avons dormi comme chaque nuit. Mes fesses collées contre son ventre, ses bras chauds et lourds pesant sur ma poitrine. Son corps enroulé, immobile autour de moi, m’intimant l’ordre délicat de ne pas bouger. Je suis pleine de lui, de ses caresses, de nos baisers échangés, peau contre peau… Un couple dont le désir dure. Je ne peux pas m’expliquer cette chance. Ses jambes s’agitent, il ouvre un œil, marmonne d’une voix rocailleuse :
– Ça va ma chérie ? Pas trop stressée pour ton premier jour ?
Il a pris ma main et nous avons marché en silence. C’était un dimanche terriblement ordinaire. Mais je portais un indicible secret. J’avais peur, j’avais le vertige, je ressentais une chose inconnue. Il n’avait pas l’air de s’apercevoir de mon trouble et avançait d’un pas régulier vers la maison, où nous attendait le dîner, préparé par ma mère, en compagnie de mon frère. « Papa, j’ai peur. » Il s’est penché un peu vers moi, si frêle comparée à lui, très petite pour onze ans, tout en continuant de marcher. « Peur de quoi ?
– J’ai peur de ne pas aimer Dieu. »
La messe était encore gravée dans nos esprits. Communier, ne pas communier. Nous avons continué à avancer sous l’ombre des lampadaires. Lui, grand et moi, si petite. Il s’est contenté de serrer un peu plus fort ma main dans la sienne, grosse, musculeuse. « C’est normal, mon enfant. Ça arrive, dans la vie d’un croyant. Parles-en à ton aumônier. Ne t’inquiète pas. Il ne faut pas que tu aies peur pour cela. Dieu est amour. Moi, je suis là. Tu ne crois plus en Dieu ? Prie ! Aime Dieu et tu seras sauvée. Heureux ceux qui doutent, ma fille… »
Mais il n’a rien dit. Que se passerait-il si je cessais vraiment de l’aimer, comme je le craignais ? La fin du monde et ma damnation ? Plus de Notre-Père. J’ai regardé le mien ouvrir le portail de l’immeuble de sa main forte et sûre – parfois il a des larmes dans les yeux, on ne sait pas pourquoi. Il a eu un geste vif pour m’inciter à me dépêcher, j’ai eu un peu peur. Et puis, j’ai fini par douter de moi plutôt que de lui. Lui, qui me faisait réciter le Notre-Père. Doucement, à toute vitesse, dans l’ordre, dans le désordre, avec ou sans options. « Notre Père, qui “êtes” ou qui “es” ? On lui dit “tu” ou on lui dit “vous” ?
C’était dans mes rapports avec le sexe opposé que la timidité me desservait le plus. Si j’invitais une fille à sortir et qu’elle m’éconduisait, je ne lui posais plus jamais la question. Son excuse pouvait être sincère : peut-être était-il vrai que sa mère était hospitalisée, que son père s’était brisé les deux jambes et que sa sœur adorée était coincée au XXIIIe siècle après avoir participé à une expérience secrète de voyage dans le temps organisée par le gouvernement. En réalité, je me disais que, en me regardant, la fille voyait l’image de mon père. Dès lors, il lui semblait plus sage de mettre le feu à ses cheveux que d’accepter mon invitation à aller danser puis à boire un milk-shake au Dairy Queen.
Et puis, en dernière année de lycée, arriva Gerda Cerra. J’avais déjà été attiré par des filles, charmé par elles, fasciné même, mais aucune ne m’avait jamais ensorcelé. Je n’avais jamais été amoureux. En fait, je pensais qu’il était impossible de tomber amoureux si l’on était né après 1890. Menue, gracieuse, jolie, Gerda avait une voix douce qui donnait à chacun de ses mots une tonalité intime et romantique. Lorsqu’elle me dit : « Tu as quelque chose qui pend au bout du nez », mon cœur s’envola. Et, surtout, son assurance me semblait surnaturelle.
Le fait que je la courtise, timide comme j’étais, de la terminale à la demande en mariage, prouve l’attrait puissant qu’elle exerçait sur moi, d’autant plus qu’elle m’avait éconduit quatre fois.
La première fois, lorsque je lui proposai de l’emmener au cinéma, elle prétexta travailler ce soir-là au pressing. Avant, si une fille plâtrée des pieds à la tête plaidait l’immobilité comme excuse pour décliner une invitation à sortir, j’en concluais qu’elle me trouvait repoussant et, par conséquent, je lâchais l’affaire. Mais, une semaine plus tard, je retentai ma chance avec Gerda.
Cette fois, elle m’informa que le soir en question elle travaillait au cinéma, derrière le bar. Il me semblait pourtant qu’elle avait un boulot au pressing. Soit elle n’allait pas vraiment « travailler » au cinéma, soit elle ne se rappelait pas son précédent mensonge.
Maria passe ses journées à la bibliothèque de sciences humaines située à l’angle de la 118e Rue et d’Amsterdam Avenue, plongée dans des documents en provenance d’un lieu et d’un temps reculés. L’automne touche déjà à sa fin et elle en est arrivée au point où elle doit s’en remettre à des rituels pour avancer. Elle porte toujours le même caban et la même écharpe rouge vaporeuse. Elle s’arrête toujours dans le même delicatessen et commande toujours la même chose au grand costaud planté derrière le comptoir, un bialy au beurre et un café, léger et sucré. Elle a toujours les mêmes provisions dans son sac à main : un sachet de noix de cajou, une barre chocolatée et une bouteille d’eau.
Sa place jouxte une fenêtre où il lui arrive de prendre une pause et de regarder l’air froid affûter les angles des immeubles. Elle a décidé que tous les campus étaient les mêmes – donnaient tout à la fois une sensation de possible et d’inertie. Elle pense aussi que, à y regarder de près, tous les étudiants de troisième cycle dégagent la même aura de privilège et de pauvreté mêlés.
Quand ils me demandent si j’ai remarqué des changements de comportement, je leur réponds donc, sans entrer dans les détails, que les étrangers sont toujours imprévisibles.
Une fois par semaine, les Administrateurs se réunissent dans la « bibliothèque » de l’hôtel. Il reste quelques livres sur des étagères et, bien que personne ne les lise, ils contribuent à créer une ambiance studieuse et méditative. La bûche placée dans l’âtre n’est jamais allumée. La cheminée est considérée comme un risque d’incendie ; après avoir été utilisée en toute sécurité pendant des années, elle est maintenant condamnée.
Mon oncle et sa femme Dawn font partie du Conseil d’administration. Compte tenu des liens entre l’hôtel et les étrangers, il serait difficile de les exclure. Les autres ont été choisis parmi les membres actifs de la société civile. M. Wooten, sur lequel on peut toujours compter. L’ingénieur de la centrale hydroélectrique, M. Bennett, qui est aussi notre président. M. Hughes de l’épicerie voisine, de l’autre côté de la rue. Le pêcheur retraité que j’inscris dans le registre, à sa requête, sous le nom de « M. Fish ». M. Byrd est celui que je connais le mieux. C’est le bouquiniste installé dans la vieille grange – trois étages de planchers grinçants dédiés aux polars.
Au début, quand je suis venu vivre à l’hôtel, Dawn m’a emmené chez Byrd’s Books en espérant que je noie mon chagrin dans celui des autres. J’ai eu ma première conversation avec M. Byrd dans la librairie et il m’a tout de suite plu. L’éclat de ses yeux cherchait à m’inclure. Il a pressé ses grosses mains sur le comptoir en verre et m’a demandé si j’aimais les polars. Je lui ai répondu que je n’en avais jamais lu – un aveu décevant, même à mes propres oreilles.
Le bruit du jeu de course automobile qui provenait du téléviseur à l’étage la fit sortir de ses pensées. Il était presque midi. Même si Sandra avait pris le relais dans leur famille, Mathilde n’avait rien perdu de sa fougue dans l’accomplissement de sa mission. Il n’était pas question qu’elle ne prenne pas toutes ses responsabilités à cœur. Elle monta aussitôt préparer un lunch pour Kevin.
— Où ça ? fit-elle répéter Ivy.
— À Singapour.
Singapour.
Pétrifiée, elle regarda sa petite-fille avec insistance. Elle était en pleine préparation d’un civet de lapin. Elle s’était figée un couteau en l’air, un oignon à demi émincé devant elle. Trop absorbée par les événements, Ivy n’avait pas remarqué combien elle était bouleversée. Elle semblait dans le même état : arborant d’ordinaire un teint crème, elle était d’un rouge enfiévré. Cela faisait des semaines qu’elle n’avait pas dégagé une telle énergie. Elle ôta sa veste et sa casquette, toutes deux mouillées par la pluie, et les pendit au portemanteau. Sa chevelure noire aussi était trempée. Lui tournant le dos, Mae posa sa main, celle avec laquelle elle tenait le couteau, contre sa poitrine pour s’aider à se ressaisir. Ivy poursuivit, lui expliquant qu’une couchette lui était réservée six jours plus tard.
— Quand Gregory me l’a annoncé, je ne savais pas quoi en penser. Mais aujourd’hui (elle fronça les sourcils), je suis un peu moins perdue. C’est comme si c’était un nouveau départ.
Tout ça est-il bien vrai ? Pas tout à fait, mais c’est trop proche de la vérité pour être rassurant. Là où jadis les communautés existaient par les maisons mitoyennes serrées, avec leurs portes d’entrée constamment ouvertes, on peut regretter qu’aujourd’hui les soirées soient rythmées par le bruit du verrou qu’on tourne et de la chaîne qu’on tire.
Certains quartiers s’en sortent mieux que d’autres. Celui d’Ethel Hurst n’en faisait pas partie. Je trouvai sa maison près d’une usine délabrée, dans l’ombre d’un pont en fer rouillé. En face, il y avait une épicerie. Je savais qu’elle était tenue par des Indo-Pakistanais parce que la vitrine était cassée malgré la grille en fer, et aussi parce qu’elle était encore ouverte à l’heure où je garai la Fiesta. Ce n’était pas un endroit où j’aurais laissé ma voiture personnelle.
Ethel habitait une de ces maisons mitoyennes de l’époque victorienne que les experts-comptables et les producteurs de disques s’arrachent, et que les agents immobiliers (dont la langue diffère de celle du reste de l’humanité) décrivent comme « charmantes ». Je verrouillai la voiture et ouvris le portillon. Il donnait sur un carré de verdure orné de magnifiques rosiers. N’étant pas jardinier, je n’aurais pas su les nommer, mais j’appris plus tard qu’ils étaient de la variété Madame Antoine Meilland, dont les fleurs sont d’un jaune subtil bordé de rose ; Piccadilly, avec des fleurs rouge et jaune ; et Wendy Cussons, d’un rose tirant sur le rouge et dont le parfum exquis, selon les mots d’Ethel, prouvait l’existence de Dieu.
Ethel ouvrit la porte et me fit entrer dans un couloir minuscule au point que même un agent immobilier aurait réfléchi à deux fois avant de le qualifier de « charmant ». De façon surprenante, Ethel portait un jean et un pull large.
Et puis il y avait Terry.
La fille de Masao Tanaka était aussi belle que rebelle. Si Jonas manquait à l’appel, c’est elle qui aurait dû accompagner son frère au fond de la fosse. Aussi Jonas avait-il rempilé, cette fois à bord d’un submersible unipersonnel. Là encore, le destin voulut qu’il croise le chemin de la plus parfaite machine à tuer jamais produite par l’évolution. Le fils de Tanaka avait trouvé la mort entre les crocs d’une de ces créatures, tandis qu’une autre, une énorme femelle enceinte, était parvenue à quitter le purgatoire de ces eaux chaudes. Au final, Jonas avait été contraint de tuer ce spécimen qu’il espérait sauver, et ses exploits avaient fait de lui une légende. Autrefois victime du mépris et des quolibets de ses pairs, le paléobiologiste avait immédiatement été réhabilité, au point de devenir une célébrité mondiale : L’homme qui avait terrassé le meg. Les talk-shows, les émissions spéciales, les reportages… tous se l’arrachaient, et chacun voulait jeter un coup d’œil à la fille de la créature, retenue captive dans le lagon Tanaka.
Terry et lui s’étaient mariés. Masao Tanaka avait fait de son nouveau gendre un associé de l’Institut et, un an plus tard, l’exposition vivante la plus populaire au monde avait ouvert ses portes à Monterey.
Aller là où le sang avait jailli. La nausée monta dans son ventre, dans sa gorge. Seul l’air pouvait le délivrer de la nausée. Le sauver ou le mettre face à la mort.
Shane entreprit de s’asseoir sur son lit. Ses chaussures de sport ne devaient pas être bien loin. Il se chaussa en forçant pour faire passer ses talons dans les renforts. « Chui con. Même plus la force de mettre des souliers », songea-t-il. Il se leva d’un coup et plaça ses deux mains sur les montants du cadre de sa porte. De « la » porte. « Allez, sortons de cette piaule chiante », se dit-il.
L’air extérieur se précipita à sa figure. Et cette lumière, c’était trop. Shane se mit à marcher jusqu’au bout de la rue. Il avait l’impression d’être un gros insecte auquel on aurait pelé les yeux. Il devait avoir deux bulbes rouges géants à la place de… Émilie disait toujours qu’il avait les yeux tristes comme ceux d’un p’tit chien. Elle avait d’ailleurs l’habitude de mettre ses index sur les coins naturellement abaissés des paupières de Shane pour les remonter. « J’te fais un lifting », disait-elle. « Tu veux que j’aie un lifting ? » rigolait alors Shane. « Mais non, j’adore tes beaux yeux de p’tit chien. Je t’adore. »
Aller voir Émilie. C’était la seule solution pour s’apaiser. Shane marchait maintenant dans l’herbe haute qui foisonnait bien loin des pâtés de maisons. Shane savait qu’il devait marcher encore, avant de rejoindre Émilie. Il décida de marcher sur la track qui traversait la ville. Peu lui importait qu’un train lui passe dessus.
Arrivé presque à la limite de la ville, Shane regarda autour de lui. Rien ne distinguait l’endroit si ce n’était des bouts de rubans jaunes attachés à des arbres bordant la track. Le corps de Shane se mit à trembler. Un froid rigoureux s’était emparé de tous les organes de son abdomen et les secouait sans merci. Il contempla le chemin de fer jusqu’à son point le plus éloigné, qui se perdait à l’horizon. Le soleil se couchait tout au bout, laissant glisser sa lumière le long du métal. Shane sauta hors du chemin et se mit à ratisser le boisé.