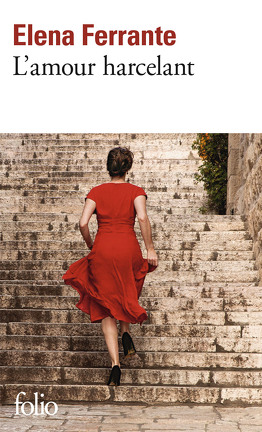Ajouter un extrait
Liste des extraits
Je tirai la porte du guichet et j'y introduisis le rayon de la torche. Je m'accroupis, genoux contre la poitrine, tête inclinée. Penchée de la sorte, je rampai en descendant trois marches glissantes. J'acceptai, au long de ce parcours, de me raconter tout : tout ce que les mensonges recelaient de vrai.
Afficher en entierI
Ma mère s’est noyée la nuit du 23 mai, jour de mon anniversaire, dans le bras de mer qui fait face à la localité qu’on appelle Spaccavento, à quelques kilomètres de Minturno. Le lieu même où, à la fin des années cinquante, quand mon père vivait encore avec nous, nous louions pendant l’été une pièce chez des paysans pour y passer le mois de juillet, dormant à cinq dans quelques mètres carrés surchauffés. Tous les matins, nous les filles, nous gobions un œuf frais, coupions vers la mer au milieu des hauts roseaux, à travers des sentiers de terre et de sable, et nous allions nous baigner. La nuit où ma mère est morte, la propriétaire de cette maison, qui s’appelait Rosa et avait alors plus de soixante-dix ans, entendit frapper à la porte mais n’ouvrit pas par peur des voleurs et des assassins.
Ma mère avait pris le train pour Rome deux jours avant, le 21 mai ; elle n’était jamais arrivée. Les derniers temps elle venait chez moi passer quelques jours au moins une fois par mois. Je n’étais pas contente de la sentir dans la maison. Elle se réveillait à l’aube et, selon son habitude, elle astiquait de fond en comble la cuisine et la salle de séjour. Je cherchais à me rendormir mais je n’y arrivais pas : raidie entre les draps, j’avais l’impression qu’en s’affairant au ménage elle transformait mon corps en celui d’une petite fille toute ridée. Quand elle arrivait avec le café, je me resserrais dans un coin pour éviter qu’elle ne m’effleurât en s’asseyant sur le bord du lit. Sa sociabilité m’agaçait : elle sortait faire les courses et traitait familièrement des commerçants avec lesquels je n’avais pas échangé deux mots en dix ans ; elle allait se promener en ville avec des connaissances à elle, faites par hasard ; elle devenait l’amie de mes amis, et elle leur racontait les histoires de sa vie, toujours les mêmes. Avec elle, je ne savais être que contenue et insincère.
Elle s’en retournait à Naples dès ma première ombre d’impatience. Elle rassemblait ses affaires, donnait un dernier coup à la maison et elle promettait de revenir bientôt. Moi je faisais le tour des pièces en arrangeant à mon goût ce qu’elle avait disposé selon le sien. Je redonnais à la salière le compartiment où je la mettais depuis des années, je restituais au détergent la place qui m’avait toujours paru convenable, je bouleversais l’ordre qu’elle avait mis dans mes tiroirs, je rendais au chaos la pièce où je travaillais. Et l’odeur de sa présence – un parfum qui laissait dans la maison un sentiment d’inquiétude – au bout de quelque temps passait aussi comme, l’été, l’odeur d’une pluie de courte durée.
Souvent elle manquait le train. D’habitude elle arrivait avec celui d’après ou même le jour suivant, mais je ne parvenais pas à m’y faire et ma préoccupation était toujours identique. Je lui téléphonais avec anxiété. Lorsque enfin j’entendais sa voix, je lui faisais des reproches empreints de dureté : pourquoi donc n’était-elle pas partie, pourquoi ne m’avait-elle pas avertie ? Elle se justifiait sans empressement et, amusée, se demandait ce que j’imaginais qu’il pût lui arriver, à son âge. « Tout et n’importe quoi », répondais-je. Je m’étais toujours figuré une trame de guets-apens noués exprès pour la faire disparaître du monde. Quand j’étais petite, je passais le temps de ses absences à l’attendre à la cuisine, derrière les vitres de la fenêtre. Je priais qu’elle réapparût au bout de la rue comme une figure dans une boule de cristal. Je respirais sur la vitre en la couvrant de buée, pour ne pas voir la rue sans elle. Si elle tardait, l’anxiété devenait tellement irrépressible qu’elle éclatait en tremblements de mon corps tout entier. Alors je m’enfuyais dans un débarras sans fenêtres et sans lumière électrique, juste à côté de leur chambre à elle et à mon père. Je fermais la porte et je restais dans le noir, à pleurer en silence. Le cagibi était un antidote efficace. Il m’inspirait une terreur qui tenait en respect mon anxiété sur le sort de ma mère. Dans la nuit noire, asphyxiée par le DDT, je subissais l’agression de formes colorées qui, l’espace de quelques secondes, me léchaient les pupilles en me coupant le souffle. « Quand tu reviendras, je te tuerai », pensais-je, comme si c’était elle qui m’avait laissée enfermée là-dedans. Mais ensuite, à peine j’entendais sa voix dans le couloir, je me glissais dehors en toute hâte pour aller lui tourner autour avec indifférence. Ce cagibi me revint à l’esprit quand je découvris qu’elle était partie normalement mais n’était jamais arrivée.
Dans la soirée je reçus le premier appel téléphonique. Sur un ton tranquille, ma mère me dit qu’elle ne pouvait rien me raconter : avec elle, il y avait un homme qui l’en empêchait. Puis elle se mit à rire et elle raccrocha. Sur le moment, c’est la stupeur qui l’emporta. Je pensai qu’elle voulait plaisanter et me résignai à attendre un deuxième appel. De fait je laissai les heures passer en conjectures, inutilement assise à côté du téléphone. Ce n’est qu’après minuit que je m’adressai à un ami de la police, qui fut très gentil : il me dit de ne pas m’agiter, qu’il s’en occuperait lui. Mais la nuit s’écoula sans qu’on eût aucune nouvelle de ma mère. De certain il n’y avait que son départ : la veuve De Riso, une femme seule du même âge qu’elle, avec qui depuis quinze ans alternaient des périodes de bon voisinage et des périodes d’inimitié, m’avait dit au téléphone qu’elle l’avait accompagnée à la gare.
Pendant qu’elle faisait la queue pour le billet, la veuve lui avait acheté une bouteille d’eau minérale et un magazine. Le train était bondé mais ma mère avait quand même trouvé de la place à côté de la fenêtre, dans un compartiment bourré de soldats en permission. Elles s’étaient saluées en échangeant des conseils de prudence. Comment était-elle habillée ? Comme d’habitude, avec des vêtements qu’elle avait depuis des années : jupe et veste bleues, un sac à main de cuir noir, de vieilles chaussures à talons moyens, une petite valise usée.
À sept heures du matin, ma mère téléphona de nouveau. Pour toute réponse à la grêle de questions que je fis pleuvoir sur elle (« Où es-tu ? D’où téléphones-tu ? Avec qui es-tu ? »), elle se contenta de me débiter à voix très haute, en prenant goût à les scander, une série d’expressions obscènes en dialecte. Puis elle raccrocha. Ces obscénités provoquèrent chez moi une régression désordonnée. Je retéléphonai à mon ami, en le stupéfiant par un obscur mélange d’italien et d’expressions dialectales. Il voulut savoir si ma mère était particulièrement déprimée ces derniers temps. Je n’en savais rien. J’admis qu’elle n’était plus comme autrefois, tranquille, paisiblement amusée. Elle riait sans raison, elle parlait trop ; mais les personnes âgées sont souvent comme ça. Mon ami en convint lui aussi : avec les premières chaleurs, les vieux faisaient des choses bizarres, c’était courant ; il ne fallait pas s’inquiéter. Mais moi, je continuai à m’inquiéter et je passai la ville au peigne fin en cherchant surtout dans les endroits où je savais qu’elle aimait se promener.
Le troisième appel arriva à dix heures du soir. Ma mère parla confusément d’un homme qui la suivait pour l’emporter roulée dans un tapis. Elle me demanda d’accourir à son aide. Je la suppliai de me dire où elle se trouvait. Elle changea de ton, répondit qu’il ne valait mieux pas. « Enferme-toi, n’ouvre à personne », recommanda-t-elle. Cet homme voulait me faire du mal à moi aussi. Puis elle ajouta : « Va dormir. Maintenant je vais prendre un bain. » On n’entendit plus rien.
Le jour suivant deux garçons virent son corps qui flottait à quelques mètres de la rive. Elle n’avait sur elle que son soutien-gorge. On ne trouva pas la valise. On ne trouva pas le tailleur bleu. On ne trouva même pas la culotte, les bas, les chaussures, le sac à main et les papiers d’identité. Mais elle avait au doigt sa bague de fiançailles et son alliance. Aux oreilles, elle portait les boucles que mon père lui avait offertes un demi-siècle auparavant.
Je vis le corps et, en face de cet objet livide, je sentis que peut-être je devais m’y agripper pour ne pas finir Dieu sait où. Il n’avait pas été violé. Il présentait seulement quelques ecchymoses, dues aux vagues d’ailleurs légères qui l’avaient poussée durant toute la nuit contre des écueils à fleur d’eau. Il me sembla qu’autour des yeux elle gardait les traces d’un maquillage qui devait avoir été très marqué. J’observai longuement, avec malaise, ses jambes olivâtres, extraordinairement jeunes pour une femme de soixante-trois ans. Avec un égal malaise, je me rendis compte que le soutien-gorge n’avait pas grand-chose de commun avec ceux, tout usés, qu’elle portait habituellement. Les bonnets étaient faits d’une dentelle finement travaillée et montraient les mamelons. Ils étaient réunis par trois V brodés, griffe d’une coûteuse boutique napolitaine de lingerie pour dames, celle des sœurs Vossi. Quand on me le rendit en même temps que ses boucles d’oreilles et que les bagues, je le respirai longuement. Il avait l’odeur piquante de l’étoffe neuve.
Afficher en entier