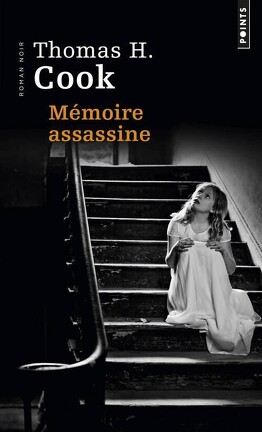Ajouter un extrait
Liste des extraits
De cela, je m'étais toujours souvenu : les rideaux à fleurs de leur chambre à l'étage, bien fermés; le nouveau ballon de basket de Jamie à la lisière du jardin, luisant sous la pluie ; le soutien-gorge blanc traînant dans l'herbe derrière la maison, le reste de nos vêtements, mouillés et immobiles, suspendus à la corde à linge.
De cela aussi, je me souvenais : deux hommes assis côte à côte, à l'avant d'une voiture, celui qui est au volant est le plus jeune, le plus petit, et nu-tête ; l'autre porte un feutre gris, respire fort, et fume. C'est le plus âgé qui parle le premier en ôtant ses lunettes à monture d'acier dont il essuie les verres avec un mouchoir blanc tandis qu'il se retourne sur son siège pour me faire face. Avant Rebecca, j'étais incapable de me rappeler ce qu'il m'avait dit alors, ce qui ne m'empêcha pas, au fil des années, d'échafauder toutes sortes de suppositions, répliques sans doute glanées à la télévision ou au cinéma qui ne me semblaient jamais sonner tout à fait juste.
Avant Rebecca, je ne savais même plus combien de temps j'étais resté assis à l'arrière de cette voiture, pourtant j'ai toujours gardé le sentiment d'avoir vu la lumière changer, phénomène qui n'avait pu se produire que très lentement, à mesure que le soir tombait. Je me souvenais de la grisaille qui s'intensifiait autour des arbres dénudés de l'automne. Je revoyais même les ombres qui s'étiraient et s'élargissaient pendant que les heures passaient, mais étant donné l'épaisse couverture nuageuse de cette fin d'après-midi-là, cela ne pouvait pas correspondre à la réalité. Pourtant, cette fausse impression d'ombres qui s'agrandissent perdura au fil des années, forte, tenace, alors que d'autres choses, infiniment plus importantes, en vinrent à se brouiller et à s'effacer.
Et, surtout, je me souvenais de la pluie. Elle était tombée sans discontinuer ce jour-là, les flaques devenant de plus en plus vastes, l'eau dévalant, tels de minuscules ruisseaux de montagne, les caniveaux incurvés de nos rues de banlieue. C'était une pluie d'automne, froide, drue, de celles qui nous trempent et nous glacent jusqu'aux os. Toute la fournée, assis à mon pupitre, à l'école, je l'avais écoutée tambouriner sur les vitres de ma classe. Dehors, elle jetait de grands voiles gris sur le terrain de jeux et la cour, et avait fini par former de sombres flaques sous le portique, sous les balançoires à bascule et les cages à écureuil ruisselantes d'eau. Elle me retint à l'intérieur alors que je voulais qu'on me laisse sortir, et je me revois observer avec mélancolie le terrain de softball détrempé, les nuages noirs au-dessus, la pluie fine et vigoureuse. Aujourd'hui, quand j'y songe, je suis frappé par le fait que presque toutes les impressions que j'avais gardées de cette journée-là relevaient de l'enfermement.
Ce jour-là : le 19 novembre 1959.
La voiture dans laquelle j'étais assis dans le soir tombant était bleu foncé, et imprégnée d'une odeur douceâtre, mais poussiéreuse, vraisemblablement due à la fumée de cigarettes et de cigares accumulée, avec le temps, dans le capitonnage. Il y avait un emblème en chrome sur le capot : un oiseau aux ailes ouvertes, une représentation répandue à l'époque. Je me souviens de cet oiseau car je concentrais mon attention dessus de temps en temps, préférant le regarder, lui, plutôt que les deux hommes qui demeuraient silencieux sur les sièges avant. Il était très beau, du moins c'était mon impression à l'époque, une pointe scintillante et argentée, une vision de libération, une créature prenant son envol. Je trouvais bizarre de la voir fixée à quelque chose, d'autant plus au capot plat et métallique de la voiture dans laquelle j'étais assis, et que la pluie martelait en grosses gouttes qui s'écrasaient sur les ailes déployées, mais immobiles, de l'oiseau.
La voiture était à l'arrêt dans l'allée de chez moi. J'ignore de quelle marque elle était, mais j'ai toujours imaginé qu'il s'agissait d'une Ford ou d'une Chevrolet. Le flanc de ses pneus était noir, son intérieur bleu foncé. À la place de l'habituelle radio à petits boutons chromés, il y avait une étrange boîte en métal dotée d'un micro noir qui pendait au-dessus du plancher. De temps à autre, elle émettait des grésillements, mais je ne me rappelle pas avoir entendu de voix. Dans mon souvenir, aucun des deux hommes ne décrocha jamais le micro. Ils semblaient vissés à leurs sièges avant, raides, muets, lourds, comme des statues.
Je restais silencieux derrière eux, mes petites jambes repliées sous moi sur la banquette arrière. Entre le garage et l'angle de la maison, je voyais un coin du jardin, ainsi que la barrière en bois construite par mon père avant ma naissance, et une partie des montants des balançoires en fer, pour lesquelles mon frère et ma sœur étaient devenus trop grands, mais sur lesquelles, à mes moments perdus, il m'arrivait encore de m'asseoir. Au-delà, il y avait la corde à linge qui ployait lourdement sous sa charge de vêtements imbibés d'eau, et, dessous, l'entortillement blanc du soutien-gorge de ma sœur.
La maison avait une façade en brique rouge, un style néo-Tudor, un étage, un toit à pignons et des volets extérieurs vert foncé purement décoratifs. Une allée rectiligne cimentée menait à l'entrée. Aux deux portes d'entrée, en fait. L'une était vitrée, entourée d'un cadre en aluminium, et l'autre en bois plein, peinte en blanc et munie d'un heurtoir en laiton en forme de main tenant une petite boule de métal. Je revois la délicatesse avec laquelle les doigts effilés enserraient la sphère, comme s'ils s'apprêtaient à la lâcher.
Il y avait d'autres éléments décoratifs. Les fleurs, par exemple, que ma mère avait plantées, non seulement tout autour de la maison, mais aussi en deux plates-bandes circulaires de part et d'autre de l'allée en ciment. Elle cultivait des roses, des tulipes et des azalées de différentes couleurs, et je la revois penchée gauchement, presque accroupie, au-dessus de ces fleurs, vêtue d'une vieille blouse rouge, retournant la terre avec une petite pelle. Elle avait trente-sept ans, mais, sur les photographies, elle paraît beaucoup plus âgée. Elle était maigre et blonde ; elle avait les traits anguleux. Dans mon souvenir, elle est grande, alors que, en réalité, elle mesurait un mètre soixante-deux. Avant Rebecca, je ne me souvenais pas du timbre de sa voix, sinon qu'il était assez haut perché, ni du contact de sa main, sinon qu'il me semblait vague, hésitant, ni d'absolument rien du cœur qui battait sous la vieille blouse rouge, ni même du fait que, selon le rapport du coroner, il pesait approximativement cinq cents grammes.
Ainsi donc, pendant toutes les années qui suivirent sa mort, ma mère demeura pour moi une image évanescente, une silhouette sculptée dans le sable, éphémère et fugace.
Sa sœur Edna, c'est une autre histoire, et ce fut elle qui finit par venir me récupérer dans la voiture, les deux hommes me confiant à elle naturellement, sans même lui demander de justifier de son identité.
Ce qu'elle aurait pu faire, évidemment. C'était une femme prudente, scrupuleuse, qui, sachant ce qu'on attendait d'elle ce jour- là, n'aurait pas manqué d'apporter son permis de conduire ou sa carte de bibliothèque. Mais aucun des deux hommes assis à l'avant de la voiture ne prit la peine de lui demander qui elle était. Le plus jeune se contenta de déclarer : « Vous devez être sa sœur », puis, avec un signe de tête dans ma direction, il ajouta : « C'est bon, vous pouvez l'emmener. »
Ce fut donc ma tante qui vint me chercher ce jour-là. Mon père l'avait toujours surnommée « la tantine à marier » ou « la vieille fille », mais je doute qu'il ait cherché à être cruel en employant de telles expressions. Elle avait quarante-deux ans alors, et elle était célibataire. C'était aussi simple que cela. D'aucuns auraient pu être motivés par d'autres intentions, utiliser ces mots pour faire remarquer que ma tante avait échoué dans sa principale mission d'attirer et de garder un homme. Mais mon père admirait sa solitude, je crois, de même que sa capacité à supporter une subtile dose de mépris.
Ce jour-là, elle portait un épais manteau en tissu, et ses cheveux bruns étaient tirés en arrière et noués en un petit chignon qui semblait accroché, telle une baie gorgée de jus, à son chapeau de pluie noir à large bord.
La portière arrière de la voiture s'ouvrit toute grande, et je me glissai hors de la banquette pour m'en remettre aux bons soins de ma tante. Elle ne me serra pas dans ses bras, mais me prit par la main, et s'éloigna d'un pas rapide à travers le jardin détrempé par la pluie jusqu'à sa voiture, me tirant sans ménagement, de sorte que je trébuchais et manquais sans cesse de tomber en trottinant à son côté.
Tandis qu'elle me faisait asseoir promptement sur le siège passager de sa vieille Packard verte, je jetai un coup d'œil vers chez moi, le ballon de basket de Jamie dérivant soudain dans mon champ visuel comme une toute petite planète orange. Tandis que la voiture s'éloignait, je me mis à genoux sur mon siège et me retournai pour regarder, par la vitre arrière zébrée de pluie, la maison où j'avais vécu toute ma vie. Elle se dressait dans tout son abandon, dans tout son accablement, dans toute sa désolation. Je suppose que, à ce moment-là, j'avais une vague idée de ce qui s'était passé entre ses murs au cours des dernières heures. Mais tout ce qui avait eu lieu auparavant, la longue marche que nous avions tous faite jusqu'à ce jour de novembre, me demeurait hors de portée.
— Regarde devant toi, Stevie, m'intima sèchement ma tante. Pas en arrière.
Avant Rebecca, je ne l'avais jamais fait.
Mais, aujourd'hui, je pense que la mémoire est le lot de consolation qui nous est dévolu pour compenser la mort de chaque jour, le lieu auquel nous accédons pour reconstruire et réécrire notre vie, pour nous donner une seconde chance. Peut-être que, sur la fin, c'était là tout ce que chacun de nous voulait : avoir au moins une seconde chance. Mon père, ma mère, Laura, Jamie et moi enfermés tous ensemble dans cette maison de McDonald Drive. De la rue, elle ne ressemblait aucunement à une prison, mais je sais à présent que c'en était une, et que, même si je ne les entendais pas à l'époque, les bruits de mon enfance étaient ceux de grilles coulissantes et de portes métalliques.
Tante Edna avait déjà sûrement perçu tout cela, et, redoutant le pire, elle me recommandait de ne jamais regarder en arrière. C'était une femme d'âge moyen le jour où elle m'entraîna du jardin à sa voiture, mais moi, j'avais l'impression qu'elle était très vieille. Arrivés chez elle, elle me prépara un dîner léger composé de poulet et de riz blanc. Je m'assis à la table, mangeant du bout des dents, silencieux, frappé de stupeur par ce que je savais déjà. Je me souviens qu'elle m'étudia longuement, comme si elle cherchait ses mots. Puis elle renonça, et grommela, tout simplement :
— Je trouverai une solution.
Mais elle ne la trouva jamais, et je pense que son échec était dû en partie au fait que, somme toute, je l'effrayais. En tout cas, il est certain que pendant les deux petits mois où je vécus chez elle, elle m'observait parfois d'un air froid et distant, avec une indéniable appréhension, et, pour moi, dans ces moments-là, elle tentait de discerner le mauvais grain qui, présumait-elle, ne manquerait pas de germer en moi un jour, le tison ardent dans les ruines encore brûlantes de ma famille, qui projetait toujours des étincelles dans l'air enfumé, épais, âcre, inflammable.
Un jour, en fin de soirée, je redescendis à la cuisine, pris dans le tiroir le grand couteau à découper et me dirigeai vers la coupe à fruits posée à côté du vieil évier en étain. À peine avais-je fait quelques pas que je vis tante Edna surgir de l'obscurité de la pièce contiguë. Elle regardait le couteau, pas mon visage, et je devinais qu'elle luttait contre l'envie irrésistible de me l'arracher des mains.
— Range ça, ordonna-t-elle.
— J'avais envie d'une pomme, répondis-je.
— II est trop tard pour manger, déclara-t-elle sur un ton égal. C'est mauvais pour l'estomac.
Un bref instant, nous nous fixâmes, tendus et palpitants, le grand couteau toujours fermement serré dans ma main.
— Range-le, Stevie, répéta-t-elle.
J'obéis aussitôt, bien entendu, mais je n'ai jamais oublié le regard de tante Edna à ce moment-là, son air d'avoir senti une vapeur nocive dans l'air qui m'entourait.
Des années plus tard, quand je racontai cet incident à ma femme, elle déclara seulement « C'est d'un macabre ! », et se remit à travailler. Je sais maintenant que, au lieu de m'opposer une gentille fin de non-recevoir, elle aurait dû accuser le coup, se tourner vers moi et me demander : « Elle avait raison, Steven ? Toi aussi, tu as cela en toi ? Comment faire pour l'en extirper ? »
Pendant des années, je me suis imaginé que ma mère aurait dû exiger les mêmes réponses de mon père, comme si cette franche discussion aurait pu, à elle seule, nous sauver tous.
Afficher en entier