Commentaires de livres faits par Rebecka13
Extraits de livres par Rebecka13
Commentaires de livres appréciés par Rebecka13
Extraits de livres appréciés par Rebecka13
volent à l'envers
On les prends pour des oufs
Mais il vaut mieux siffler en verlan
et voler à l'envers
Qu'être triste à l'endroit.
Ma sœur, mon cobaye préféré
Installé dans un petit coin, les mains sur les genoux, le corps bien droit, les chaussettes remontées, les doigts légèrement écartés, je prends le moins de place possible, absolument immobile. La fraîcheur du vestibule tente un assaut. Je ne frissonne pas, je contrôle le froid, car je veux rester là, à le regarder soigner. Fasciné par ce que j’observe, malgré mes six ans et mon poids dérisoire : quand tout commence, la chaleur me vient de l’intérieur, elle monte, puis m’enveloppe. Selon moi, tous les hommes sont capables de contrôler leur température tout comme leurs douleurs. En apparence, lui ne souffre jamais. Je le regarde appuyer sur les membres blessés, s’arrêter, puis reprendre. Attentif aux gémissements de ses clients, l’air grave mais assuré, mon père, rebouteux, plonge son regard dans leurs yeux. Leurs mirettes rétrécies par la douleur pétillent à la faible lueur de la lampe à pétrole distillant une lumière blonde. Elle parcourt la table et fait virevolter les ombres animées, les promenant jusqu’à nous. D’un petit coup, d’un mouvement que l’on remarque à peine, et pourtant qui demande au corps et à l’esprit entier de se mobiliser, ce qui fait mal se soumet. Le feu crépite sans discontinuer dans la cheminée où pendent les instruments de cuisson en cuivre. Vers dix-neuf heures, ma mère vient mettre la soupe aux choux à cuire, l’odeur du repas donne faim.
Quand la douleur se tait, dans l’âtre, la respiration des flammes s’arrête. La vie, à cet instant fugace, la vie des humains dans la pièce, comme celle des bêtes autour de la ferme, se fige. C’est alors que le client à l’épaule démise se relève, brise le silence, tourne son épaule, bat des bras, dans un froissement de vêtements rêches aux odeurs vigoureuses. Mon père l’arrête aussitôt et lui demande de ne pas bouger, il consolide le bras avec une écharpe qui devra rester en place deux ou trois semaines.
Ce qui se remarque en premier chez les accidentés, lorsque le membre démis se rétablit, c’est leur visage soudain rajeuni. Ils sont entrés mortifiés, ils repartent les traits lissés, allégés de leur souffrance. Ce qu’on lit alors dans leurs yeux s’apparente à l’espérance. Certains ont attendu des jours, parfois même des semaines, voire des années. Malgré le miracle, certains boitent encore, ou se tiennent penchés, par habitude. Ils ne conçoivent plus de marcher sans leur douleur. Les symptômes les ont quittés et cette paix les surprend.
Leurs habits sentent la sueur, la terre, l’étable et les bêtes mouillées. Je perçois de grosses voix derrière le mur, des hommes et des femmes qui patoisent, se saluent en attendant leur tour. Des sabots crissent sur le sol de la courette devant la ferme, alors que déjà un autre blessé a pris place, le regard parfois craintif, le corps calé tant bien que mal sur la chaise en paille.
Le boulanger sent la levure et la farine, le laitier, le lait caillé. Je ferme les yeux et je reconnais les professions de ces gens qui ne déclinent pas toujours leur identité. Si certains sont des habitués, beaucoup sont inconnus et le resteront. Leurs blessures les ont stoppés en plein travail et ils portent les traces de leur journée. Ils attendent dans le vestibule, lorsque vient leur tour, un regain d’énergie les gagne.
Minuscule, recroquevillé sur mon petit banc de bois qui sert à ma mère pour attraper les pots de confiture dans le placard du cellier, personne ne me remarque. Je suis un enfant, c’est-à-dire un être non pensant, incapable de discernement, suivant ce que la majorité des adultes pensent à cette époque. Un être inapte aux souvenirs et à élaborer sa propre pensée, un invisible. Pourtant je n’en perds pas une miette, les gestes de mon père se répètent, il tourne les membres, les étire, les plie d’une certaine façon. Je remarque une pression, puis une autre. J’enregistre le mouvement. Les gens crient peu, retiennent leur surprise, dans un vagissement venant des profondeurs. Le soulagement presque instantané de ceux qui sont passés entre ses mains leur redonne confiance. Pendant qu’il les raccommode, tous parlent avec leur soigneur, des semailles, des travaux à finir le lendemain, de leurs bêtes, de leurs affaires, des ventes et des locations de terre.
Aussitôt rassérénés, ils repartent avec tellement de joie. Mon père n’en éprouve visiblement pas de fierté. Je suis fier à sa place. Sérieux, attentif, ma pensée s’élabore devant tant de misères apparentes qui se succèdent avec l’odeur des métiers de chacun, dans la pièce où nous prenons nos repas.
Encore enfant, je me suis toujours senti comme un adulte devant eux. Je discerne leurs problèmes. J’ignore alors à cette époque que tous les humains ne devinent pas ces choses-là. Pris entre deux eaux, rester le petit garçon de ma mère ou épouser le métier de mon père, je mémorise peu à peu les mouvements et la pratique de ce dernier. J’ai remarqué la similitude des gestes et, au bout d’un certain temps, je ressens le besoin de m’exercer sur un modèle.
Je m’entraîne sur moi, avec la certitude que ce qui se remet peut se démettre et vice versa. Seulement, à ce jeu solitaire, je m’ennuie. Aussi, j’amadoue ma sœur cadette de cinq ans, j’en ai alors à peine dix. Je lui propose de jouer au métier de papa avec elle ! Bien drôle de façon de jouer, non pas à la dînette ou au fermier et à la fermière, mais au rebouteux. Je l’invite à s’asseoir sur la chaise de paille exclusivement réservée aux manipulations.
— Alors ma bonne dame, qu’est-ce que vous nous avez fabriqué là ? On dirait une belle entorse !
— J’ai dégringolé mon escalier, et voilà que je ne peux plus bouger le poignet !
Je frotte, tourne sa main. Mais aussi son bras. Puis quand elle est assez rassurée, d’un petit coup crac !… Je lui démets légèrement les doigts des mains, des pieds. Elle se laisse faire. Seulement un jour, j’y vais un peu trop fort, et son doigt ne veut pas retourner à sa place. La pauvre victime, forcément, hurle de douleur. Mon père arrive aussitôt et en dix secondes le lui répare :
— Mais comment tu as fait ça, c’est pas Dieu possible qu’on s’abîme toute seule sans tomber !
Ma sœur garde le silence et ne me trahira jamais. Pourtant, mon père pourrait la forcer à avouer, avec l’air sérieux qu’il a lorsqu’il examine une blessure et qu’il marmonne dessus. Il contracte ses mains avec autant de force dans les bras qu’un maréchal-ferrant. Lorsqu’il parle, les gens l’écoutent attentivement comme à une homélie ; ma sœur l’adore et il le lui rend bien. S’il m’attrapait, je ne lui résisterais pas. Je suis incapable de mentir à mon père, et ma sœur restera mon cobaye, mais plus jamais je ne lui déboiterai un membre sans pouvoir le replacer.
Quand, dans ma jeunesse, j’affirmais à mon père que je ne reprendrais pas son métier, je me trompais. Car même aujourd’hui, bien qu’à la retraite, ce métier d’orthochiropracteur ne me laisse pas tranquille. Durant des années, j’ai hésité à l’exercer, puis je ne l’ai plus quitté. Cette profession, je l’avais en moi, elle poussait en moi, par mon père et par tous ces gens de la campagne dont il avait acquis l’estime. J’ai approfondi ce métier ensuite, en me formant et en réfléchissant. Depuis des siècles, les vieux et les vieilles ont transmis l’art de « comment remettre en place » ce qui dans le corps a voulu s’échapper.
Les os, ça saute, ça se casse, ça se déboîte. Je les remets bout à bout, mais ça n’a rien à voir avec de la magie. Mon métier, je l’ai acquis par transmission, par l’accumulation d’expériences et par un savoir-faire avec un brin d’intuition. Faut pas croire, un rebouteux ça réfléchit, même si je n’ai que mon certificat d’études. La rebouterie ressemble à un travail de paysan. Finalement, on déparasite, on détache, on replante, on boute, c’est-à-dire qu’on pousse, qu’on repousse, on retient, on met des tuteurs et on aère la peau en drainant les rigoles. En massant profondément comme on remue la terre, des miracles se produisent. Peau qu’on gratte, qu’on bine et qu’on retourne.
Un rebouteux, en présence de quelqu’un qui souffre, ne peut se présenter comme médecin. Mais plutôt comme un paysan du corps. Car comme médecin, il devrait se fonder sur des connaissances figées et un protocole, il ne penserait qu’à démontrer par la preuve. Le monde continuellement en mouvement, en évolution, lui serait inaccessible. Mon métier ne se comprend, ne se reproduit pas en laboratoire. Les blessures sont bien réelles. Je n’invente rien, j’obéis à la parole du corps. Ce que dit le corps, mes mains l’entendent. Elles sont guidées par lui, elles amoncellent une expérience pour l’avenir renouvelé de chacun. Car beaucoup de mes clients atterrissent chez moi quand « ils ont tout essayé ».
Un rebouteux n’invente rien, il obéit au réel devant lui, une entorse, des déboitements qui sont autant de blessures du corps physique. Obéir à une logique m’aurait sans doute amené à tout arrêter. Ça paraît irréel de se servir d’une prière et de quelques gestes pour panser les maux et pourtant, dans la vie, le zona, les brûlures passent sous mes mains. Je ne peux le démontrer, seulement le montrer. Un zona passé par mes mains guérit en deux ou trois séances au maximum, même un zona ancien. Rien à voir avec la science puisque probablement la science ne prouvera jamais l’existence de quelque chose qui dépasse l’humain. Pourtant certains soins sont guidés par quelque chose qui nous vient de l’imperceptible, dont moi-même j’ignore absolument tout. Je n’en veux rien savoir d’ailleurs.
Un rebouteux, selon moi, ça ne pense pas la matière ou l’esprit, ça pense la matière et l’esprit. Les deux sont liés, ils sont constitués du même matériau. Pas de mystère, la seule vérité lorsqu’on a mal, c’est d’être soulagé. Pas de rebouteux sans blessures, pas de bonnes récoltes sans mauvaises récoltes ! La nature et l’homme sont attachés l’une à l’autre.
Les plus sophistiquées de ces éphémères gargotes étaient rehaussées de néons verts et rouges éclairant les dîneurs de lueurs fantomatiques. Les autres se contentaient d'ampoules nues.


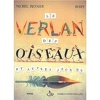



Je sais ce que je veux
PQ triple épaisseur
qui sent la fleur
moutarde à l'ancienne
de Dijon et pas d'ailleurs
jambon spécial minceur
écolo le saucisson
et aussi le beurre
Je ne veux que du riz asthmatique
issu du commerce, étiquetable