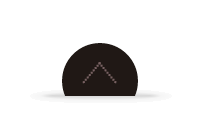Tous les livres de Suzanne Saïd
Lire, aimer, connaître, comprendre la littérature grecque de l'Antiquité suppose une familiarité savante et accessible avec tous les textes, tous les auteurs mais aussi une intelligence de leur modernité : Ulysse, Socrate, Antigone, Oedipe, Electre sont, par certains côtés, nos contemporains. La guerre de Thucydide est une guerre moderne, la cité de Platon est un mythe créateur, les orateurs attiques sont des avocats d'aujourd'hui. La structure historique, choisie volontairement, permet d'appréhender la continuité de la création : l'âge épique autour d'Homère, l'âge archaïque avec l'éclat du lyrisme et les présocratiques, l'âge classique autour des grandes oeuvres "athéniennes " (la tragédie, la comédie, l'histoire, la philosophie, l'éloquence), l'âge hellénistique après les conquêtes d'Alexandre et la naissance des "nouveaux mondes" grecs, l'âge romain jusqu'à la fondation de Constantinople puis le temps de l'avènement chrétien et les Pères de l'Eglise. Le panorama ainsi dessiné est conçu comme une incitation à la lecture des oeuvres constitutives de notre mémoire grecque européenne.
Indispensable pour comprendre les auteurs et apprécier les œuvres d'art, la mythologie grecque est une partie intégrante de notre culture. Depuis le 18e siècle, elle est aussi une science. Ce livre présente les divers aspects de cette réalité difficile à cerner. Clair, concis et rigoureux, il interroge les définitions du mythe, propose une typologie des récits mythiques et présente dans leur diversité les textes qui nous les ont transmis d'Homère (8e siècle avant J.-C.) aux mythographes (Ve siècle après J.-C.). Il dresse le tableau des lectures qu'en ont faites les Anciens, puis de celles qui ont suivi et fait notamment le point sur les " querelles d'Homère " des 17e et 18e siècles. Il analyse enfin les principales théories modernes sur l'origine et la nature des mythes, de James Frazer (1854-1941, l'auteur du Rameau d'or) à Walter Burkert (1931) en passant par Claude Lévi-Strauss (1908). Le livre est en outre enrichi d'un répertoire des écrivains de l'Antiquité ainsi que d'une bibliographie.
Homère : l'aède aveugle qui chante pour les princes ou le poète mendiant qui erre à travers le monde grec. L'Odyssée : un récit d'aventures si célèbre qu'il est devenu un nom commun.
Au-delà des clichés qui hantent la mémoire collective, ce livre fouille au plus profond un « récit primitif » dont la complexité n'a rien à envier aux plus sophistiqués des romans modernes.
Voici que s'éclairent les valeurs du monde d'Ulysse. Et l'on comprend mieux pourquoi, d'Homère à Joyce ;et Kazantzakis, cet être de mémoire, qui ne rêve que de retour, n'a cessé d'incarner l'humanité.
Depuis Bachofen et son livre sur Le Droit Maternel, on s'est beaucoup intéressé à l’État des femmes. Après lui, on ne compte plus les tentatives de retrouver dans le passé lointain de l’humanité ou dans des régions éloignées du globe la réalité d’un pouvoir féminin et l’existence d’une communauté des femmes.
Allant contre quantité d’idées reçues, ce livre propose une exploration de l’imaginaire des Grecs. Il fait apparaître que la réalité de la cité était celle d’un club d’hommes considérant le mariage et la famille comme la pierre angulaire de la société.
Après avoir rappelé ce qui était pour les Grecs une évidence, à savoir l’infériorité naturelle de la femme à partir d’une étude du statut des femelles dans la biologie d’Aristote, il révèle comment les Grecs ont conjuré la double menace d’un pouvoir au féminin et d’une communauté des femmes en la mettant à distance.
Tandis qu’historiens et géographes, d’Hérodote à Strabon, l’ont rejetée chez des sauvages vivant aux confins du monde habité, poètes, orateurs et mythographes l’ont eux aussi repoussée dans la nuit des temps avec les Amazones. Ils ont fait servir la défaite de ces femmes viriles à la gloire des héros ou des peuples qui ont triomphé d’elles. Dans la bouche d’un poète comique comme Aristophane ou d’un philosophe comme Platon, ils l’ont projetée par l’utopie dans un univers de nulle part.
Embrassant toute une série de textes, de l’époque archaïque à l’Antiquité tardive, traversant nombre de disciplines, cet essai limpide et rigoureux montre que le pouvoir féminin est un mythe auquel les Grecs n’ont jamais cru.
Suzanne Saïd est professeur émérite des universités de Paris X-Nanterre et Columbia University. Ses nombreux travaux portent sur Homère, Pindare, la tragédie et la comédie, la poésie hellénistique, l’historiographie (Hérodote, Thucydide et Diodore), la rhétorique, la philosophie, le roman grec, la littérature de l’époque impériale et la réception par les modernes des textes anciens. On lui doit, aux Belles Lettres, Approches de la mythologie grecque (nouvelle édition revue et augmentée, 2008).
De l'épopée homérique (VIIIe siècle avant J.-C.) à Aristote (-384-322), quatre siècles séparent l'âge héroïque des conquêtes d'Alexandre.
La plupart des grands genres littéraires voient alors le jour et connaissent leur apogée : épopée, poésie lyrique, tragédie, comédie, histoire, éloquence, enquête sur la nature et philosophie.
C'est l'époque où se forgent les références essentielles de la culture classique, celles-là mêmes qui ont nourri la culture occidentale jusqu'à nos jours. Trois traits caractérisent ce foisonnement littéraire : son oralité.
Sa destination ciblée à des groupes sociaux déterminés, enfin le fait que la création poétique (poièsis) est d'emblée conçue comme inséparable de l'imitation (mimèsis).
Un malin vaincu par plus malin que lui, une allégorie de l'intelligence en révolte contre le mal métaphysique, où se place le héros civilisateur qui s'oppose au maître des dieux dans le Prométhée enchaîné ? Le livre de Suzanne Saïd s'efforce de répondre à cette question. Il pose le ou plutôt les problème(s) du Prométhée enchaîné.
Problème d'authenticité d'abord : cette tragédie est-elle bien d'Eschyle ? Depuis le début du XXe siècle, la question a souvent été posée.
Ce livre s'interroge sur ses présupposés et sur l'objectivité des arguments avancés dans ce débat d'érudits.
Mais aussi et surtout problème de sens. Au-delà des étiquettes et des clichés, du vil sophiste et de l'odieux tyran, ce livre analyse le savoir et le pouvoir dans le Prométhée enchaîné à partir des mots, des images et des situations dramatiques.
D'un côté un savoir complexe : l'inventeur des arts est aussi un devin inspiré. De l'autre, un pouvoir simplifié à l'extrême qui se confond avec la seule force. Au terme, une illustration des insuffisances du savoir et une démonstration des limites du pouvoir.
Une œuvre archaïque avec une leçon simple servie par un art concret et direct. Car dans le Prométhée comme dans le théâtre d'Eschyle, l'apparence dit toujours la réalité, les images tiennent lieu de théorie, le mythe reflète l'essence des choses.
Oedipe tue son père et couche avec sa mère : c'est l'exemple même de la faute tragique. Mais pourquoi cette faute et quelle en est la nature?
Oedipe est-il un prince orgueilleux, un homme trop curieux, un jeune insolent ou un étourdi aveuglé par la concupiscence et l'ambition ?
Depuis qu'il y a des hellénistes et qu'ils réfléchissent sur la tragédie, la question a été souvent posée.
Ce livre veut chercher ailleurs . D'Homère à la tragédie, de l'échec de l'archer au crime de Médée, l'ouvrage nous invite à suivre l'histoire de la faute dans le vocabulaire grec.
Au terme d'une ambiguïté irréductible.
Tout acte s'inscrit dans deux registres, celui des dieux et celui des hommes, celui des mobiles et celui des résultats.(...)
Impossible dialogue, au cœur de tous les gestes qui rendent Œdipe aveugle ou condamnent Agamemnon vainqueur à l'égorgement.