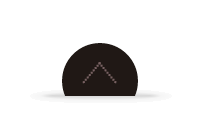Tous les livres de Nathalie Viet Depaule
Quelle a été la place des catholiques dans la République depuis la séparation des Eglises et de l'Etat en 1905 ? L'expression de leurs croyances a-t-elle été réduite à la sphère privée ? Se sont-ils retranchés dans une opposition frontale à l'Etat ? Ont-ils investi la société pour façonner, au travers de conflits multiples avec les courants laïques, socialistes ou libéraux, le visage de la République française ? Quelle part ont-ils prise à la modernisation de notre modèle démocratique ? Pour la première fois, un ouvrage dresse le tableau d'ensemble de l'engagement catholique dans la France du XXe siècle. Des paysans aux intellectuels, de l'usine à l'hôpital, de l'intimité familiale à l'espace politique, ce livre donne au débat sur religion et politique l'épaisseur d'un siècle d'histoire. Inédite par son ampleur, rigoureuse par sa méthode et novatrice dans ses interprétations, cette synthèse historique rend compte d'un paradoxe : comment les catholiques ont-ils pu participer à la construction d'une République dont ils étaient supposés, au début du siècle, combattre les valeurs et les principes ?
Créé sous l'Occupation par le cardinal Suhard, le séminaire de la Mission de France a formé des prêtres pour riposter à la déchristianisation. Leur mission les a conduits à privilégier le travail. Du prêtre-ouvrier au médecin, de l'ouvrier agricole au cuisinier, du psychologue à l'artiste peintre, du chauffeur routier à l'ingénieur, ces hommes ont adapté leur apostolat aux mutations de la société, des Trente Glorieuses à la mondialisation. Hantés par la prégnance de l'incroyance chez leurs contemporains, ils ont forgé une identité missionnaire par leur insertion dans les agglomérations industrielles et les campagnes à l'abandon, de Marseille au Limousin, étendant leur champ d'action jusqu'au Tiers Monde, du monde arabe au Brésil et à la Chine. Ces prêtres se sont engagés dans les luttes de leur temps. Au cœur des affrontements de la Guerre froide ou de Mai 68, opposés à la guerre d'Algérie, acteurs des syndicats et des mouvements associatifs face à la misère du monde, des prisons aux sans-logis, ils ont payé le prix de leurs convictions qui les plaçaient en porte-à-faux aussi bien vis-à-vis de l'autorité religieuse que civile. Dénoncés par les intégristes, ils ont fait l'objet de mises au pas par Rome jusqu'au Concile Vatican Il et, par leurs actions perçues comme politiques, ont été jusqu'à enfreindre l'ordre légal. Profondément d'Eglise, héritiers de la spiritualité de Thérèse de Lisieux et de Charles de Foucauld, ils n'ont eu de cesse de faire valoir leur singularité auprès des évêques au risque d'apparaître comme les seuls ténors de l'apostolat missionnaire. Face aux défis d'une société marquée par la sécularisation, les prêtres de la Mission de France ont inventé en communauté avec des laïcs, au nom de l'évangélisation, une riposte originale. Ce livre donne à comprendre comment le catholicisme actuel résulte d'une histoire faite d'oppositions autour des valeurs qui définissent " l'être chrétien " aujourd'hui.
S'il est acquis que les religions contribuent à la justification de l'ordre établi, elles peuvent aussi jouer comme une force de changement. À partir d'analyses de cas empruntées à l'histoire de l'Eglise catholique, mais aussi à celle d'autres religions, ce livre examine des contestations internes qui ont eu pour enjeux de mettre en question les relations traditionnelles entre des agents religieux, des laïcs et des institutions et de redéfinir la place des Eglises ou des organisations religieuses dans certaines sociétés. Le point de vue adopté dans cet ouvrage prend le parti de comprendre les subversions religieuses en ce qu'elles engagent pleinement les esprits et les corps. Ces tentatives de transformation sont à l'origine de multiples conflits. Bien qu'elles se soient heurtées à des résistances au nom de valeurs doctrinales, à des oppositions entre clercs et laïcs et à la prétention hégémonique des institutions promptes à recourir à des mesures disciplinaires, elles ont, sinon réussi à subvertir les pouvoirs religieux en place, du moins infléchi des pratiques et induit des changements durables. Il n'en reste pas moins que, de façon surprenante, les détenteurs de la domination religieuse peuvent aussi sortir affermis de ces confrontations. Le paradoxe de la subversion religieuse est qu'elle contribuerait peut-être au renforcement interne des institutions qu'elle prétendait mettre en cause.
Les Éditions du Cerf comptent dans le paysage éditorial français, et pas seulement dans le domaine de l'édition religieuse. Fondées en 1929 par deux religieux dominicains dans le prolongement du succès de la revue La Vie Spirituelle, elles ont rapidement acquis, par leurs périodiques et par leurs livres, une réputation enviable dans l'aile marchante de l'Église de France : mouvement ecclésiologique (collection "Unam Sanctam" du père Congar) ; mouvement biblique (Bible dite de Jérusalem) ; mouvement patristique (collection "Sources chrétiennes") ; mouvement liturgique (revue La Maison-Dieu) ; mouvement théologique (collection "Cogitatio Fidei"). Elles ont été ainsi un des vecteurs majeurs en France de l'aggiomamento conciliaire voulu par Jean XXIII. Mais leur histoire n'a pas été un long fleuve tranquille : les Éditions du Cerf ont traversé bien des orages du fait de leurs positions d'ouverture sur les grandes crises du XXe siècle : condamnation par Rome de l'Action française, guerre d'Espagne, Seconde Guerre mondiale, guerre froide ou guerre d'Algérie. C'est ce parcours mouvementé, conjuguant histoire générale et histoire religieuse, que retrace ce livre, rédigé de première main par un universitaire familier de tels événements, avec les archives des provinces dominicaines françaises. Il éclaire tout un pan de l'histoire du catholicisme en France au XXe siècle.
C'est à partir de la guerre et des profonds bouleversements qu'elle a entraînés que des séminaristes et des prêtres ont ressenti le besoin impérieux de quitter les lieux habituels du ministère sacerdotal. Soudainement confrontés à la coupure radicale entre le monde ouvrier et le monde clérical, ils ont pris conscience qu'il leur fallait être prêtres autrement. Sans schéma préconçu, ils ont progressivement réalisé leur "intuition" en renonçant aux formes traditionnelles du ministère sacerdotal pour aller en usine ou sur les grands chantiers, non pour être parmi les ouvriers, mais pour se faire ouvriers pour la vie. Dire des prêtres-ouvriers qu'ils ont voulu être prêtres et ouvriers situe l'objectif principal du livre : comprendre à partir d'une trentaine d'entretiens les conditions dans lesquelles des candidats au sacerdoce, déjà transformés malgré eux par le séminaire, se sont convertis une seconde fois pour apprendre à être ouvriers. Comment ces prêtres ont-ils voulu briser la barrière du prêtre séparé qu'ils avaient d'abord appris à être en s'exposant aux risques physiques, à la fatigue et à la dureté du travail ? Comment ont-ils exprimé une double fidélité, à l'Evangile et à la classe ouvrière ? Comment expliquer la répression exercée par Rome dès 1949 et qui a frappé les prêtres-ouvriers au 1er mars 1954 ? Pourquoi l'interdiction du travail en usine et de tout engagement syndical a-t-elle été vécue par eux comme une condamnation irrémédiable, qui les a mis dramatiquement devant "un choix impossible" ? Le livre s'achève par la question importante de la transmission du modèle de prêtre-ouvrier qui s'est trouvée fragilisée par toute une série d'obstacles institutionnels et de transformations sociales et religieuses. Un type de sacerdoce prophétique s'était néanmoins suffisamment imposé pour susciter de nouvelles vocations, au prix d'inévitables repositionnements des prêtres-ouvriers dans une Eglise post-conciliaire plus ouverte aux classes populaires, mais toujours aussi soucieuse de contrôler les forces internes de changement. Prêtres et ouvriers s'adresse à ceux qui ont été et sont encore les acteurs et les témoins de cette innovation pastorale. Plus largement, à tous ceux qui désirent mieux connaître ce moment de l'histoire du catholicisme et qui trouveront par des outils appropriés (notices, documents, glossaire, index) les moyens d'une nécessaire mise en contexte. On pourra faire aussi une lecture de ce travail dans le prolongement d'une sociologie de la conversion et de l'incorporation de la culture religieuse.
Les auteurs du Maitron nous entraînent à la découverte des itinéraires de ceux qui firent l'Orly des années du Front populaire.
Écrire l'histoire du christianisme contemporain, c'est chercher à le comprendre dans sa diversité confessionnelle, tout en mesurant son rôle dans la construction d une politique et d'une culture de la modernité, qui se sont constituées en prenant leur autonomie par rapport à lui, sans que tout lien soit rompu entre notre monde sécularisé et son passé chrétien. C'est observer cet objet aux contours indécis, dont nous affirmons tantôt le déclin inéluctable, tantôt l'omniprésence au sein de nos sociétés. Depuis plus de quarante ans, Étienne Fouilloux parcourt ce territoire en voyageur infatigable, passionné d'archives inédites. De la genèse de l'oecuménisme au genre biographique, de l'histoire des intellectuels chrétiens à celle du concile Vatican II, il a construit ce qu'il désigne lui-même comme une « histoire non théologique de la théologie », attentive aux acteurs et à leurs mobiles, sans jamais céder sur la rigueur scientifique qui fonde le « regard éloigné » de l'historien. Des inventeurs du catholicisme social aux écrivains convertis, des croyants mobilisés dans les tranchées aux prêtres-ouvriers en usine, des abbés philosophes aux bâtisseurs d'églises, les auteurs de ce livre ont suivi la voie tracée par Étienne Fouilloux, attentifs comme lui aux mots qui circulent entre l'univers chrétien et l'univers laïque, la création et la mémoire, la morale et les droits de l'homme, le deuil et la patrie. Ils ont ainsi souhaité apporter leur contribution à une histoire du christianisme contemporain, en hommage à celui qui a plus que tout autre contribué à la renouveler.
Dans les années trente, les Eglises prennent conscience du "fossé" qui les sépare des ouvriers. De multiples initiatives verront alors le jour pour tenter de le combler, lors du Front Populaire puis à la Libération, notamment en raison des liens tissés dans la Résistance. S'appuyant sur des archives récemment mises à la disposition du public et sur des témoignages, et complétant l'historiographie existante, les contributions réunies dans ce livre rendent compte de ce foisonnement, des espoirs et des conflits suscités. Cet ouvrage est issu du colloque organisé par les Archives de France, du 13 au 15 octobre 1999, au Centre des Archives du monde du travail à Roubaix.
" Pourquoi es-tu devenu prêtre-ouvrier ? " Il fallut cette question, lancée par un de ses petits cousins, un soir de réveillon, pour que Bernard Cagne se décidât à écrire. Il en fit un défi à relever et devint, presque malgré lui, le scribe de son itinéraire. Il choisit pour donner sens à ses souvenirs la forme épistolaire : deux longues lettres adressées à François, ce petit cousin, curieux du passé de son aîné et ignorant des contextes des années 50. Avec simplicité, précision et enthousiasme, il raconte rétrospectivement les différentes étapes, s'attachant à décrire les moments et les épisodes qui ont été déterminants pour lui. Il se remémore son expérience singulière et sait montrer, documents d'époque à l'appui (mis en annexes), qu'elle est indissociable de la vie des hommes qu'il a côtoyés. Bernard Cagne a toujours eu besoin d'agir, de se saisir des circonstances pour se mettre, au nom de ses convictions, au service des hommes. Et c'est bien de toute cette vie engagée que les deux lettres écrites par Bernard Cagne témoignent. Leur lecture nous dévoile non seulement un parcours singulier, mais nous fait aussi découvrir une personnalité qui, puisant sa détermination dans l'Évangile, chercha toujours à faire advenir un monde meilleur où chaque homme puisse avoir sa place. Elle nous donne aussi à comprendre une des expressions du catholicisme français au cours du XXe siècle à travers les relations complexes entre l'Église et la société.
Le 1er juillet 1943, le cardinal Suhard, archevêque de Paris, fonde la Mission de Paris en créant une équipe de prêtres déchargés de toute fonction paroissiale. C'est l'une des initiatives qu'il prend - celle qui va lui tenir particulièrement à cœur - pour répondre à la question qui le taraudait : " Je n'ai pas à chercher bien loin le sujet de mes méditations. C'est toujours le même : il y a un mur qui sépare l'Eglise de la masse. Ce mur, il faut l'abattre à tout prix pour rendre au Christ les foules qui l'ont perdu... Mais comment faire ? " Presque soixante ans plus tard, cinq prêtres-ouvriers de la Mission de Paris témoignent. Ils ont décidé, ensemble, d'évoquer leurs itinéraires missionnaires. Partis " sans bagage et sans esprit de retour ", ils ont fait le pari sacerdotal de s'immerger totalement dans le monde ouvrier de l'immédiat après-guerre. Leur " naturalisation " en terre ouvrière les a conduits à instaurer un nouvel esprit apostolique, ouvert et adapté aux réalités de l'époque. En 1954, la hiérarchie catholique les a contraints au choix " impossible " de quitter l'usine. Déchirés, ils ont refusé de se soumettre, continuant à partager la condition ouvrière, devenant des hommes parmi les hommes. Des documents, pour la plupart inédits, viennent en annexes spécifier les contextes de ces témoignages.
Dans le mouvement ouvrier, il n'est de richesses que d'hommes et de femmes. Comment faire l'histoire des courants de pensée et des organisations sans savoir qui relaie les idées, implante les partis et les syndicats, anime les grèves et participe aux congrès ? Considérant les militants comme les acteurs majeurs de la vie sociale et politique, les auteurs de cet ouvrage s'interrogent sur leurs biographies et leurs itinéraires. A ce titre, le Mailron, dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français (Ed. ouvrières/Ed. de l'Atelier), le plus grand dictionnaire biographique en langue française, n'est-il pas le cadre privilégié pour observer les rapports entre le personnel et le collectif, entre la biographie et l'histoire sociale ? Selon Michelle Perrot, " Le Maitron est parcouru par un sens de l'histoire dont le mouvement ouvrier serait porteur, une croyance aux masses, à la base, aux vertus de l'effort accumulé, des sacrifices répétés, des actes additionnés dont la confluence changerait un jour le cours des choses. " Parce qu'il est une œuvre vivante, toujours remise à jour, le Maitron ne peut que s'enrichir des évolutions de l'historiographie dont témoigne cet ouvrage et servir les militantismes d'aujourd'hui.
Yvon Tranvouez occupe une place à part dans l’histoire religieuse contemporaine. Cela tient autant de sa position – brestoise ! – que de sa patte – une écriture historique personnelle, précise, polie par le sens de la formule. Et des idées, toujours des idées…
Ses collègues et amis, en lui offrant ce Bon Dieu sans confession, s’en remettent volontiers à la photographie de couverture pour expliquer ce titre tranvouezien. Qu’y voit-on ?
Été 1967, à Keraudren. Le chanoine Élard, supérieur du petit séminaire, décide de capter et de fixer un entracte. Le cliché, exclusivement ecclésiastique, hésite entre le portrait de groupe et la scène de genre. On active la fin d’une session d’extérieur. On pose devant l’objectif. On sourit sans trop regarder. Entre soi, la scène est parfaitement modeste, bonhomme et bienveillante.
Soleil trompeur ? La sagesse finistérienne impose de remiser le mobilier extérieur en prévision du futur grain ou de l’humidité de la nuit. Mais les chaises qu’on range annoncent tout autant la prochaine fermeture du petit séminaire brestois qui, aux portes de « la Terre de prêtres », devait pourtant constituer une vitrine attirant le Léon.
Il y a tout juste 50 ans, l'Eglise catholique repensait sa relation au "monde" au cours du concile Vatican II et autorisait à nouveau des prêtres à entrer au travail en usine et sur les chantiers. Après la brusque interruption de 1954, l'espoir renaissait. C'est pour marquer cet événement et dire la pertinence de l'intuition des prêtres-ouvriers que l'Équipe nationale (ENPO) a voulu organiser en décembre 2015 un colloque à la Bourse du Travail de Saint-Denis (93). Sous la direction de Tangi Cavalin et Nathalie Viet-Depaule (IMM/CEMS/EHESS), diverses contributions, lors du premier jour du colloque, ont analysé les enjeux d'histoire religieuse, sociale et culturelle que soulève la présence en usine de prêtres à partir de 1965. La seconde journée, philosophes et théologiens ont tenté de ressaisir les caractéristiques de notre société moderne pour mettre en valeur les éléments susceptibles de structurer un ministère presbytéral nouveau dans une Église qui se voudrait servante de l'humanité. Les actes de ce colloque, enrichis de productions apportées lors de manifestations régionales célébrant ce même cinquantenaire, seront d'un apport essentiel pour maintenir ouverte la réflexion avec tous ceux et celles qui se sentent concernés, en Église et dans notre société, par l'avenir de ce que fut et est encore l'intuition des prêtres-ouvriers.
L'idée de ce livre s'est cristallisée au cours d'une réunion entre des religieux dominicains et des hommes qui, l'ayant été, avaient, comme Bernard Gardey, quitté l'Ordre. Ils se demandaient comment transmettre l'essentiel de leurs expériences acquises à prix fort sans pour autant se complaire dans la description de leurs états d'âme. Gardey se mit au travail en puisant dans les traditions orales ou écrites de sa famille et dans ses archives personnelles. Il exhuma des documents dont les plus importants restaient inédits. Il en est un peu comme du carottage des glaces du Groenland qui nous renseigne sur nos climats d'il y a 100 000 ans. D'ailleurs, il ne s'agit pas de rappeler des événements, de démonter des mécanismes ou de mettre au clair des séquences. Il suffit de restituer certains climats d'un siècle qui en compte beaucoup et d'atroces. Parvenu au grand âge, l'auteur aimerait communiquer aux plus jeunes des raisons de vivre. Mais ce livre n'est pas le " manuel du bonheur sans effort ".