Commentaires de livres faits par Gwen42doline
Extraits de livres par Gwen42doline
Commentaires de livres appréciés par Gwen42doline
Extraits de livres appréciés par Gwen42doline
La Nouvelle-Orléans, 1840
― Il n’y a aucun problème avec le comte DeVereaux, déclara fermement Magdalena.
Les pieds solidement posés sur le parquet, le dos bien droit, la jeune fille était assise sur le sofa du grand salon de la demeure familiale, une imposante bâtisse ceinturée d’une véranda à colonnes, typique des maisons de planteurs de La Nouvelle-Orléans.
Jason Montgomery regarda sa fille unique, soupira puis secoua la tête avec tristesse. Il détestait lui faire de la peine, mais comment l’éviter ?
La voir si belle avec sa somptueuse chevelure sombre illuminée d’une mèche rouge feu ramassée en un lourd chignon sur la nuque, ses quelques bouclettes rebelles sur le front, lui serra la gorge. Tout à coup, il eut peur et frissonna : elle allait gâcher sa vie s’il n’intervenait pas ! Il devait se montrer ferme.
Sa seule enfant… De tout temps, il avait été enclin à l’indulgence vis-à-vis d’elle, voire complaisant, ce qui n’entamait en rien sa lucidité de père et d’homme : elle était vraiment belle. Son visage, sa silhouette possédaient une perfection presque irréelle. Sa peau avait la douceur et le grain sans défaut de l’albâtre poli, ses prunelles la couleur de l’ambre. Magdalena était dotée d’une classe innée, d’une volonté de fer et d’une intelligence hors du commun. Elle bénéficiait de surcroît de la grâce d’une gazelle : le moindre de ses mouvements était naturellement élégant et lorsqu’elle se décontractait, elle devenait douce, tendre, faisant montre d’une séduction empreinte de la naïveté des jeunes filles de son âge. Tout le problème venait de là : elle était jeune, impressionnable et passionnée.
Il lui avait cependant appris à être forte. Son héritière se montrerait digne de Jason Montgomery, le souverain d’un petit royaume, celui de cette plantation de Louisiane. Tous les hommes de cet État, d’ascendance française ou anglaise et désormais citoyens américains, le respectaient car il était sage, éduqué et puissant. Il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour façonner sa fille à son image.
Et voilà que maintenant, elle usait à son encontre des armes qu’il lui avait données !
― Tu n’aimes pas le comte parce qu’il est français, l’accusa tranquillement Magdalena.
― Ce n’est pas parce qu’il est français que je n’aime pas le comte. C’est parce qu’il est…
Jason s’interrompit juste à temps. À aucun prix Magdalena ne devait s’imaginer qu’il perdait l’esprit, ce qui eût été le cas s’il s’était expliqué. Il tenait à ce qu’elle respecte ses opinions sans les discuter et se plie à son autorité parce qu’il était son père.
― J’ai choisi de vivre ici, reprit-il, où la majorité de mes associés sont français. Oui, il avait choisi cet endroit pour cette raison. La population de l’État se composait de descendants des anciennes colonies ; parmi eux figuraient des Français, des Anglais, des hommes et des femmes venus des îles, les créoles. Des sang-mêlé, certains âgés, à la peau café au lait, d’autres, jeunes, des beautés sombres dotées de certains pouvoirs… qui savaient tout du monde des ténèbres.
Il leva son poing serré et l’agita devant sa fille.
― Je suis ton père ! Tu ne reverras pas Alec DeVereaux. J’ai décidé que tu épouserais Robert Canady, et c’est ce que tu feras dans les prochains mois. Dès que les détails de la cérémonie seront réglés !
― Non ! s’écria Magdalena en se levant.
La passion et la colère brûlaient dans ses yeux. La beauté et la grâce de ses mouvements n’étaient jamais aussi évidentes que lorsqu’elle était ainsi furieuse.
― Je ne le ferai pas, père. Je… je…
Soudain, elle tremblait, sanglotait…
― Tu ne m’avais jamais traitée ainsi ! Tu m’as appris à réfléchir et à…
― Mais tu ne réfléchis pas ! Si tu te donnais la peine de le faire ne fût-ce qu’une seconde, tu te poserais des questions sur DeVereaux ! Tu demanderais à rencontrer ses parents, tu chercherais des preuves de ce qu’il prétend être ! Tu t’efforcerais de savoir d’où il vient !
― Papa, tu t’exprimes comme un benêt arrogant ! Mais écoute-toi donc ! Tu m’as dit qu’ici c’étaient les États-Unis d’Amérique !
Dans ce pays, on ne fait ni la révérence à des rois et à des reines, ni de courbettes à des altesses. Un homme peut y forger sa propre destinée…
― … et les filles sottes s’y pâment devant d’énigmatiques hommes aux titres ronflants !
― Je ne suis pas sotte, papa. Je ne me suis jamais pâmée devant quiconque et les titres ne m’ont jamais impressionnée. Pourquoi serait-ce le cas ? Après tout, on appelle mon père le baron du Bayou, et ça me suffit.
Magdalena venait de s’exprimer sur un ton primesautier. Elle redevint sérieuse.
― Tu ne connais pas DeVereaux, papa. Alec est si clair, si net !
Il a ouvert pour moi une porte sur le monde. Il me permet de voir très loin, m’aide à comprendre l’Histoire, les événements passés et à venir… et je suis amoureuse de lui parce qu’il…
― Non, Magdalena !
― Si. Je suis amoureuse de lui parce qu’il est brave, infiniment sérieux quand il le faut et fier, tendre…
― Il fait ce qu’il faut pour te séduire.
― C’est un honnête homme, papa. Il souhaite m’épouser.
― Jamais ! cria Jason. Jamais, m’entends-tu ? Jamais !
Il marqua un temps, puis appela :
― Tyrone ? Accompagnez ma fille jusqu’à sa chambre. Et qu’elle n’en sorte pas !
Le serviteur qui allait et venait dans le vestibule sans perdre un mot de la dispute était un Noir extraordinaire, né dans le bayou, et affranchi. Ses parents avaient émigré des îles, et ses ancêtres étaient originaires du sud de l’Afrique. Il mesurait près de deux mètres et, de la tête aux pieds, n’était qu’une masse compacte de muscles luisants.
Il s’approcha de Magdalena, l’air triste.
― Je suis désolé, mademoiselle.
La jeune fille regarda le beau visage à l’expression navrée du bras droit de son père. Le seul défaut de Tyrone, estimait-elle, était son absolue loyauté envers Jason Montgomery. Si elle se rebellait, il la porterait jusqu’à sa chambre.
Elle se retourna vers son père sans parvenir à croire qu’il puisse se montrer aussi intransigeant, aussi haineux vis-à-vis de l’homme qu’elle aimait.
― Pas de rois, pas de reines, père ! Nul devoir d’obéissance à des hommes ou des femmes qui se piqueraient de nous donner des ordres ! Ici, c’est l’Amérique. Personne ne me fera baisser la tête.
Cela dit, elle pivota sur ses talons et se dirigea vers l’escalier d’une démarche empreinte d’orgueil, suivie de Tyrone.
― Magdalena ! la rappela Jason.
Jason Montgomery… Elle le considérait comme son meilleur, son plus cher ami.
Elle se retourna.
― Et l’amour, ma chérie, qu’en fais-tu ? N’accepterais-tu pas de te soumettre à la volonté d’un père si elle n’a que l’amour pour origine ?
― Je t’aimerai aussi longtemps que je vivrai, papa, mais il existe des amours autres que l’amour filial. Et c’est pour ces amours-là que je dois te défier.
― D’ici à deux mois, tu seras mariée à Robert Canady.
― Non, père.
― Si, mon enfant.
Magdalena releva un sourcil avec élégance.
― Comptes-tu m’enfermer dans ma chambre jusque-là ?
― Ma fille, aussi sûr que chaque soir tomberont les ténèbres, je le ferai, je te le jure !
Magdalena continua à fixer son père, implacablement digne.
― Ne m’appelle plus « ma fille », lâcha-t-elle à mi-voix avant de recommencer à gravir les marches.
Cette fois, elle ne regarda pas derrière elle. Il lui semblait que son cœur se fissurait. Elle aimait tant son père… cet homme grand et mince à la barbe poivre et sel… Il avait toujours été là pour elle, la grondant parfois mais la plupart du temps gentil, adorant son domaine et ses livres plus encore, consacrant des heures et des heures à l’étude. Des amis lui rendaient souvent visite, certains d’entre eux amusants, d’autres carrément excentriques, et il s’enfermait avec eux dans la bibliothèque. Tous ces personnages étaient aimables avec Magdalena, et enclins à l’étudier comme ils étudiaient les vieux documents. Depuis toujours, ils lui prodiguaient de la chaleur humaine, peut-être par mimétisme avec l’adoration que lui vouait son père. Celui-ci et ses amis l’avaient encouragée à apprendre à réfléchir, à décider par elle-même.
Et voilà que tout à coup elle se sentait au bord des larmes.
Les autres pères choisissaient les maris de leurs filles, mais pas Jason ! Pas cet homme qui depuis qu’elle était enfant agissait à la fois comme un parent et un ami. Pas celui qui représentait tout pour elle !
Comment se faisait-il que soudain il ne comprît plus ? Lui-même avait connu l’amour, autrefois. Il lui avait si souvent parlé de sa mère… Avec tant d’intensité et de passion qu’elle parvenait à restituer le passé. Jason avait adoré Marie d’Arbanville, une Française, une vraie Parisienne. Il l’avait enlevée et amenée chez lui, pour l’installer à La Nouvelle-Orléans. Sans doute avait-il élu cette ville, supposait Magdalena, parce que la jeune épousée s’y sentirait presque chez elle.
Tout cela semblait n’avoir plus d’importance, désormais. Si Jason avait aimé, il l’avait oublié.
Comme elle-même oubliait avoir eu un penchant pour Robert Canady… Le cœur battant soudain à tout rompre, elle songea à ce bel homme, un jeune veuf doté d’une moustache blonde, d’une chevelure rousse bouclée et de sublimes yeux bleus. Charmant, réfléchi, parfois trop sérieux, elle l’aimait beaucoup. Elle l’avait presque aimé tout court et aurait pu l’épouser. Celui auquel l’avait promise son père aurait été son mari sans qu’elle en souffrît, si un autre n’avait pas surgi dans sa vie.
Oui, elle serait devenue Mme Canady.
Mais il n’en était plus question maintenant.
Alec DeVereaux l’avait émue, remuée jusqu’au plus profond d’elle-même en lui murmurant à l’oreille. Il l’avait bouleversée avec la sensualité de son regard, lui avait fait entrevoir un amour qui la transporterait.
Depuis son arrivée à La Nouvelle-Orléans, depuis qu’ils avaient dansé ensemble au bal du gouverneur, ri, plaisanté, badiné, elle savait qu’il n’y aurait que lui dans sa vie.
Personne d’autre n’avait ces prunelles de feu, cette capacité à lui chuchoter des mots qui l’embrasaient, lui donnaient si faim de lui.
Tremblante, elle entra dans sa chambre, referma la porte et s’y adossa. Elle avait dit à Alec qu’elle le rejoindrait ce soir, qu’elle traverserait le bayou, courrait si vite vers lui dans la nuit qu’elle volerait presque.
Elle irait le retrouver comme promis.
Son regard balaya la pièce, s’arrêta sur le balcon. Il fallait se hâter.
Ouvrant son lit, elle créa sous les draps une forme humaine avec les oreillers et les couvertures, puis revint vers la porte sur la pointe des pieds pour écouter. Elle perçut un léger mouvement : Tyrone s’appuyait au mur, dans le couloir. Sans doute allait-il rester là toute la nuit pour la garder.
Elle décrocha sa cape de velours de la patère puis se dirigea sans bruit vers la porte-fenêtre donnant sur le balcon.
« Magdalena ! »
Elle se figea… c’était comme si Alec avait chuchoté son prénom d’une voix enrouée de désir, comme s’il se trouvait tout près d’elle et l’appelait.
La brise nocturne souleva sa chevelure et la soie bleue de sa robe.
« J’arrive, mon amour. »
Elle se pencha par-dessus la rambarde de fer forgé du balcon et attrapa l’une des branches d’un vieux chêne, celle qui lui avait si souvent servi quand, enfant, elle s’échappait pendant la nuit. Eh bien, elle allait à nouveau l’utiliser.
C’est sans difficulté qu’elle descendit le long du vénérable arbre puis sauta par terre. Par la fenêtre du salon elle aperçut son père assis devant la cheminée, tête penchée en avant, épaules voûtées ; il était manifestement malheureux. Cela lui fit mal : elle l’aimait tant. Mais…
« Mon amour… Mon amour… »
Le murmure, de nouveau. Comme une caresse dans son esprit.
Elle tourna le dos à la maison et se hâta en silence vers les écuries. Une fois à l’intérieur, elle sella Démon, son étalon favori, et le sortit de son box en le tenant par la bride.
Les nuages se dissipèrent. La lune était pleine, ce soir. Elle montait doucement dans le ciel de velours noir, légèrement voilée d’une brume rougeâtre presque irréelle. Peut-être le signe annonciateur d’une tempête, mais le spectacle était superbe. Un peu effrayant aussi : on eût dit la lune baignée de sang.
À bonne distance de chez elle, Magdalena se raisonna : aucune peur ne pouvait altérer son amour. Dès qu’il aurait compris à quel point elle aimait Alec et appris qu’elle avait compromis son honneur avec lui, son père serait condamné à se résigner. Il accepterait leur mariage.
Elle se mit en selle puis poussa Démon au galop à travers champs. À l’approche des marécages, elle le remit au trot, veillant à ce qu’il suive bien la rive. Elle connaissait parfaitement le chemin à emprunter. Le bayou près duquel elle était née n’avait pas de secrets pour elle et ne l’effrayait pas. Elle ne craignait pas davantage les créatures nocturnes.
Alors que Démon paraissait trotter sur des sabots ailés, Magdalena avait l’impression d’être guidée par la lune rouge. Elle se désolait encore pour son père en atteignant Stone Manor, la vieille demeure acquise par Alec à son arrivée à La Nouvelle-Orléans. Dans l’éclat rougeâtre de la lune, la maison semblait incandescente. Les hautes colonnes du perron, d’ordinaire blanches, étaient cramoisies, striées de traînées couleur de sang. La fumée qui s’échappait de la cheminée était constellée d’étincelles écarlates.
Il l’attendait…
Oui, il l’attendait…
Debout devant la fenêtre de sa chambre, Alec DeVereaux éprouva une soudaine impatience qui rigidifia son corps. Puis il frissonna et se mit à transpirer.
Cela faisait une éternité qu’il l’attendait. Il avait su qu’il l’aimerait à la seconde où il l’avait vue, alors qu’elle riait loin de lui, à l’autre bout de la salle de bal. Plus tard dans la soirée, il avait posé ses mains sur elle, la tenant contre lui pendant qu’ils dansaient, et il avait eu envie d’elle. Follement, passionnément. Un besoin si ardent qu’il excédait le simple désir.
Oui, il avait eu envie d’elle, au point de passer des nuits blanches. Il aurait pu la prendre, la posséder tout de suite : il était devenu maître dans l’art de la séduction.
Mais il fallait au préalable qu’elle lui rende son amour. Alors il avait attendu. Jusqu’à ce soir. Ce soir, enfin !
Elle arrivait. Voilà qu’elle apparaissait dans le clair de lune, chevauchant Démon, son étalon couleur de ténèbres. Elle levait les yeux vers la maison et il brûlait d’impatience de caresser son visage.
Le cheval noir traversa la pelouse trop haute, galopant droit vers la bâtisse. Fasciné, Alec ne la quitta pas du regard quand elle mit pied à terre. Il l’entendit parler à Thomas, sous la véranda, puis perçut le son léger de ses pas lorsqu’elle gravit l’escalier.
Quand il ouvrit la porte de sa chambre, elle était là. Il leva la main pour la toucher et repoussa sa capuche, dévoilant sa chevelure.
― Tu es venue… murmura-t-il en reculant.
Il l’entraîna dans son domaine. Sa main dans la sienne lui semblait si petite, délicate, élégante.
Il lui retira sa cape qu’il laissa choir sur le parquet et dévora Magdalena du regard, détaillant sa silhouette svelte, la finesse de son cou, la naissance de ses seins, la grâce de ses mouvements quand elle pivota pour se diriger vers les flammes qui s’élevaient dans la cheminée de marbre.
Elle tendit les mains vers la source de chaleur. Il la rejoignit et la prit par les épaules, en un geste à la fois possessif et tendre. Le parfum de sa chevelure le grisait.
― Où ton père pense-t-il que tu es ?
― Au lit, profondément endormie.
Il distingua la veine qui palpitait sur sa gorge ; il l’effleura d’un baiser.
Elle se retourna prestement vers lui.
― Alec, je ne pouvais lui mentir plus longtemps ! s’exclama-t-elle avec fougue. Nous nous sommes disputés et…
― C’est bien.
― Je lui ai dit que nous voulions nous marier.
― J’en suis heureux, ma beauté.
Elle soupira puis l’entoura de ses bras.
― Il doit s’incliner. Parce que je t’aime.
― Vraiment ? Es-tu sûre de m’aimer ? Tu n’imagines pas combien cela compte pour moi. Tu ne peux pas en avoir la moindre idée.
Désorientée comme il lui arrivait parfois de l’être avec Alec, elle s’écarta de lui et le regarda. Mon Dieu ! quel homme extraordinaire ! Haute stature, impressionnante carrure, taille fine et hanches étroites, cheveux aile de corbeau, yeux de jais, mâchoire volontaire… Toutes les femmes qui avaient dansé avec lui en Louisiane le considéraient comme le plus dangereux séducteur qu’elles eussent jamais vu.
Son père avait dit vrai : elle en savait peu sur lui, seulement ce qu’il lui avait dit, une grande partie de sa famille avait péri lors de la Révolution française, mais certains membres en avaient réchappé, bravant la menace de la guillotine. Lui-même avait participé à la bataille de La Nouvelle-Orléans. Il n’était qu’un gamin à l’époque, un fuyard à la solde du pirate Jean Lafitte. Il avait beaucoup voyagé, s’était battu en duel à l’épée et au pistolet, gagnant une réputation de tireur d’élite.
Pour Magdalena, tout ce qu’il était, tout ce qu’il avait accompli faisait de lui un homme magnifique.
Il s’éloigna tout à coup d’elle pour se diriger vers une petite table sur laquelle se trouvaient une bouteille de vin et deux verres. Il les remplit, lui tournant le dos.
Elle en profita pour examiner la chambre, son domaine privé.
La courtepointe de satin noir avait été repoussée au pied du lit. Sa couleur contrastait avec le blanc immaculé des draps. Plusieurs oreillers jonchaient la partie haute de la couche. Dans un seau d’argent sur la table de nuit refroidissait une bouteille. Du champagne, supposa Magdalena. Du champagne français.
Il n’essayait pas de lui cacher pourquoi il lui avait demandé de venir : il portait une robe d’intérieur noire serrée à la taille
d’un lien de satin rouge. Elle doutait qu’il eût gardé d’autres vêtements dessous. Toutefois, il se maintenait à bonne distance d’elle…
― Peut-être ton père a-t-il raison, Magdalena… Peut-être ne devrais-tu pas m’aimer.
― Toi, m’aimes-tu ? chuchota-t-elle.
Il se retourna et déclara d’un ton empreint de solennité :
― Je t’aime de tout mon cœur. Je t’aimerai toute… Non, je t’aimerai éternellement.
― Dans ce cas, rien ne pourrait m’empêcher de t’aimer.
― Eh bien… Et si j’étais un monstre ?
― Parce que tu es français ?
Il eut un petit sourire et elle se sentit fondre.
― Non, Magdalena. Parce que je suis un être des ténèbres. J’erre dans la nuit… J’ai déjà tué…
― Maints hommes ont déjà tué ! coupa-t-elle.
De nouveau, il eut ce sourire ambigu. Ses yeux étaient dardés dans ceux de Magdalena, qui avait l’impression que le feu qui en émanait la brûlait jusqu’au fond de l’âme et portait son sang à l’ébullition. Elle se sentait vulnérable, affamée et… délectable.
Elle voulait cet homme comme jamais elle n’avait rien voulu de toute son existence et le désirait si ardemment qu’elle en avait mal. Il fallait qu’il la touche, pose ses mains sur son corps, ses lèvres sur les siennes, puis qu’il embrasse jusqu’à la plus infime parcelle de sa peau. Elle le voulait en elle, ne plus faire qu’un avec lui.
Elle respirait avec peine. Du bout de la langue, elle s’humecta les lèvres. Comme animés d’une volonté propre, ses doigts montèrent vers les boutons de sa robe et commencèrent à les détacher.
― Ma belle amie… Ma petite chérie… susurra Alec.
Un souffle qui se mua en léger son flotta dans l’air puis se posa sur Magdalena et l’enveloppa, brume rougie par le reflet des flammes, blanchie par instants, au gré du clair de lune.
― Tu serais bien incapable de voir le Mal s’il se dressait en face de toi… ajouta Alec dans un chuchotis.
― Je sais qu’il n’y a pas de mal en toi.
Bouton après bouton, elle se délivra de son corsage, puis laissa tomber le vêtement de brocart sur le sol.
Frissonnante, en corset et jupon, elle resta debout devant Alec. La brume rouge agissait sur elle comme un baume apaisant. Elle avait l’impression de l’entendre murmurer et éprouvait le besoin de la sentir courir sur sa peau, tout comme elle avait besoin du regard d’Alec sur elle.
« Tu ne réfléchis pas », lui avait dit son père.
En effet, elle ne réfléchissait pas, mais elle n’avait pas pour autant perdu sa capacité d’analyse : Alec lui semblait bien étrange, ce soir, comme tenté de la repousser. Pourtant, cela ne la gênait pas. Elle connaissait la différence entre le Bien et le Mal et, Dieu lui vienne en aide, elle aspirait au Mal. Aimer à ce point pouvait-il être mal ? se demandait-elle tout de même.
Alec traversa la pièce et vint placer un calice d’argent rempli de vin entre ses doigts. Qu’il soit soudain si près d’elle lui permit de lire un infini tourment dans ses yeux, mais aussi une passion dévorante. Il baissa la tête et une mèche sombre tomba sur son front. Les yeux rivés aux siens, elle porta la coupe à ses lèvres et but. La brise enfla soudain, formant dans la pièce des spirales écarlates, des vagues rouges.
― Que se passerait-il si j’étais le Mal incarné, Magdalena ?
― Tu ne l’es pas.
― Je n’ai jamais voulu l’être.
La brume s’éleva. Le calice avait disparu de sa main, constata-t-elle. Elle ne se rappelait pas l’avoir posé sur la table, pas plus qu’elle ne se rappelait s’être défaite de ses sous-vêtements… Elle cilla en se rendant compte de sa nudité. Seuls les lambeaux de brume l’habillaient de voiles mouvants et vaporeux.
Il tendit les mains vers elle, sans détacher son regard couleur de nuit du sien.
Elle désirait cet homme depuis le premier instant, mais ignorait d’où lui venait cette folle attirance. Maintenant, elle savait.
Un corps de dieu grec, aux muscles durs sous une peau de satin, des épaules d’athlète… et un sexe dressé, frémissant, symbole de la virilité absolue… qu’elle ne parvenait plus à quitter des yeux alors que la brise s’amplifiait encore.
― Cela m’est égal, ce que tu peux être ! Cela m’est égal !
― Je pourrais te faire souffrir.
― J’ai déjà l’impression d’être au bord de l’agonie…
Elle était sincère. Il lui semblait ne pas pouvoir en supporter davantage. L’attente devenait au-dessus de ses forces, elle la vivait comme un supplice.
Se jetant dans les bras d’Alec, elle l’étreignit et pressa sa bouche contre la sienne. Jusque-là, elle avait donné si peu de baisers… cependant, elle en était assez experte pour forcer des lèvres réticentes, faire naître l’excitation du bout de la langue.
Il la souleva dans ses bras en sachant qu’il venait de perdre le combat qu’il livrait contre lui-même.
Il lui rendit son baiser, fouillant sa bouche avec fièvre, autorisant toutes les ardeurs à sa langue, jusqu’à ce qu’il ait fait du feu qui couvait dans le corps de Magdalena un brasier que lui seul éteindrait. Puis il avança vers le lit et, alors qu’il la portait, elle songea qu’il se mouvait dans un silence absolu, comme la nuit lorsqu’elle tombe, douceur sombre et veloutée.
Il la déposa sur les draps. Sous son dos, elle sentait leur fraîcheur et sur son ventre la chaleur du corps ensorcelant de cet homme. Elle baissa les paupières quand il posa les mains sur elle, quand ses doigts se livrèrent sur sa peau à une danse érotique qui lui arracha de petits cris. La moiteur qui s’échappait d’elle, telle une sève, attisait le désir d’Alec, elle s’en rendait compte. Son sexe se pressait contre son ventre palpitant. Elle entendait son cœur battre si fort qu’elle le croyait sur le point de se briser et celui d’Alec lui faisait écho. La brume rouge les effleurait, ondoyait autour d’eux. Les seins douloureux, durcis, Magdalena oscillait avec délices sous les coups de langue et les petites morsures que leur infligeait Alec.
Elle s’arqua lorsqu’il insinua ses doigts en elle. Il avait basculé sur le côté et se tenait plaqué contre son flanc, en appui sur un coude. Sa paume caressait son mont de Vénus, déclenchant des sensations ensorcelantes. Les jambes ouvertes, elle lui offrait son intimité sans retenue, ahanant à chaque vague de plaisir, des vagues qui la submergeaient, refluaient et se renouvelaient sans cesse.
― Peux-tu m’aimer ? Peux-tu aimer une bête ? lui demanda-t-il soudain.
Elle dut attendre que cède le raz-de-marée de la jouissance, qu’il la dépose sur une plage calme, avant de répondre :
― Ô mon Dieu, mais pourquoi ne me crois-tu pas ? Je t’aime ! Je n’aime pas une bête, mais un homme ! Un homme qui sait me faire rire, me fait me sentir vivante et avide de désir à un point que j’ignorais qu’il pût être atteint ! J’aime un homme qui a eu une existence riche, qui s’est battu, qui a appris. Un homme qui commande, écoute, qui est fort et tendre. Je t’aime, Alec.
Pourquoi lui posait-il ces questions ? Magdalena ne comprenait pas. Elle le voulait, voulait de la brume rouge et que soit tenue la promesse de l’extase qu’il lui avait fait entrevoir.
Elle aspirait à le serrer dans ses bras, à chasser la douleur qu’elle lisait dans ses yeux, à lui assurer que…
― Une bête, répéta-t-il. Je ne sais même pas si Dieu se souvient que j’existe.
Elle attira son visage vers le sien, chercha sa bouche et le fit taire d’un baiser enfiévré. Puis elle amena sa main sous son sein gauche, pour que la communion entre leurs deux cœurs s’intensifie.
― Dieu a appris l’amour aux humains, et je t’aime. Il n’existe aucun mal que je ne puisse anéantir.
― Magdalena…
― Une bête… Pourquoi donc te qualifies-tu de bête ?
― Un vampire, assena avec autorité Charles Godwin, le professeur d’allemand.
Il était venu ce soir-là à la Maison Montgomery avec Gene Courtemanch, le vieux médecin créole, et le jeune Robert Canady, qui aimait follement la superbe fille de Jason Montgomery. Pour Canady, tout cela était nouveau, et il écoutait avec scepticisme. Dans le passé, les puissances des ténèbres avaient torturé Godwin et Courtemanch. Des années auparavant, ils avaient organisé une milice de surveillance avec Jason Montgomery. La belle Marie Laveau était morte depuis longtemps, mais les forces occultes demeuraient, et cela ne changerait jamais. Magdalena avait toujours été en danger.
― Oui, un vampire, c’est ce que je crois, dit Jason d’un ton empreint de douleur.
Il avait envoyé chercher ses amis dès que Magdalena s’était retirée dans sa chambre. Sachant que le Mal rôdait, il n’avait jamais relâché sa vigilance et, avec le concours de Godwin et Courtemanch, restait sur le qui-vive en permanence. Tous trois avaient prié pour que rien n’advienne, et voilà que maintenant, hélas ! leurs pires craintes s’avéraient.
― Nous devons le trouver dès l’aube, dit Courtemanch. Ainsi, peut-être étalerons-nous la vérité au grand jour.
― Messieurs, lança fermement Robert Canady, je ne peux cautionner l’action inconsidérée et folle que vous projetez ! Nous serons tous pendus haut et court ! Même si je suis prêt à donner ma vie pour votre fille, Jason, je préférerais que mon sacrifice serve à quelque chose ! Le comte est un nouvel arrivant. Il est mystérieux, dites-vous. Soit. Mais il s’est conduit jusqu’ici en parfait gentilhomme et…
― Seriez-vous sot, jeune homme ? rugit Godwin.
L’homme à la moustache et aux cheveux blancs éructait de fureur.
― Ce comte vous arrache la femme que vous aimez ! ajouta-t-il.
Robert laissa échapper un lourd soupir.
― J’aime Magdalena, oui, Dieu m’en est témoin. Mais je ne puis assassiner un homme parce que lui aussi l’aime, et que cet amour semble payé de retour.
― Ne comprenez-vous donc pas… commençait Jason quand des pas lourds et précipités résonnèrent dans l’escalier.
Tyrone fit irruption dans le salon.
― Monsieur Montgomery ! Monsieur Montgomery ! Elle s’est jouée de nous !
― Comment cela, elle s’est jouée de nous ?
― La forme couchée dans son lit, ce sont ses oreillers et ses couvertures… Elle, elle est partie.
― Quoi ? Partie ?
― On y va ! hurla Godwin. Tyrone, il faut y aller. Apporte les épées, les pieux, vite ! Avec l’aide de Dieu, nous arriverons à temps !
― Messieurs, intervint de nouveau Canady, même si elle a choisi cet homme, nous ne pouvons commettre un assassinat ! Personne ne semblait l’entendre, constata-t-il avec horreur.
Ces trois vieux fous ne se rendaient-ils donc pas compte de la monstruosité qu’ils s’apprêtaient à commettre ? S’il en était un parmi eux qui se sentait atrocement trahi, c’était lui ! Il aimait Magdalena, elle devait devenir sa femme et il souffrait comme un damné.
Mais elle lui préférait le Français. Elle aimait le Français !
― Sacrebleu, Robert, vous ne voyez donc rien ?
― J’entends délirer de vieux messieurs qui…
― Ce que vous devez voir, c’est la lune, la brume rouge ! Avez-vous levé les yeux ? Le ciel pleure des larmes de sang, mais vous ne comprenez rien !
― Vous le devriez pourtant, assena Godwin.
― Oh oui ! Pour l’amour du Ciel, vous le devriez, renchérit Courtemanch.
― Il est… commença Jason.
― … un vampire, acheva Courtemanch. Au nom de tous les saints, entendez-moi ! L’amant de Magdalena est un vampire !
Son amant se dressa au-dessus d’elle, tellement beau, tellement puissant, viril… Dans ses prunelles couleur de nuit luisait un étrange feu.
― Un vampire, chuchota-t-il.
Magdalena sourit, puis secoua la tête.
― Non. Quelqu’un t’a amené à croire que tu étais le Mal.
― Je suis une créature des ténèbres.
Elle se sentit trembler : Alec la regardait avec tant de gravité…
― Peut-être l’amour pourrait-il me libérer. C’est ce que dit la légende, c’est ce qui est gravé sur une très ancienne pierre tombale, celle de la sépulture d’une créature comme moi… Or, je t’aime de tout mon être. J’ai patienté un siècle avant d’entendre ton doux murmure, avant de goûter ce bonheur. Mais j’ai si peur que la légende ne soit qu’un mensonge ! J’ai si peur de te faire souffrir !
Magdalena s’assit et posa l’index en travers des lèvres de son bien-aimé.
― Cesse de dire des sottises. Tu ne peux pas être le Mal, tu ne le peux pas ! D’ailleurs, c’est bien simple, je ne le croirai jamais.
Elle le poussa sur le côté, se mit à genoux sur le lit et se pressa contre son torse, lui dévora le visage de baisers, la gorge, la poitrine. Du bout des doigts, elle caressa sa peau satinée… jusqu’à ce qu’il geigne et l’étreigne de toutes ses forces.
― Magdalena, je suis porteur du feu de l’enfer, de la damnation…
― Eh bien, donne-les-moi, mon amour, parce que je ne te quitterai pas. Personne ne m’enlèvera à toi. Peu m’importe ce qu’il adviendra…
C’était vrai. Peu lui importait. Le monde n’existait plus pour elle. Il se limitait à Alec, à l’univers de sensualité dont il lui avait ouvert la divine porte.
― Embrasse-moi, murmura-t-elle.
Il obéit avec avidité, fouillant la chevelure de Magdalena de ses doigts fébriles, puis sa bouche se détacha de celle de la jeune femme pour glisser vers sa gorge.
Magdalena se sentait monter vers l’extase et brûlait de découvrir l’instant magique quand elle sursauta légèrement, étonnée : elle percevait le contact des dents d’Alec sur son cou.
Une sensation de piqûre… Une infime et brève douleur…
Un spasme de plaisir d’une puissance inouïe se confondit avec la douleur. Son corps tout entier vibrait, chaviré de bonheur. La jouissance… c’était donc cela…
Elle ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre les cieux de velours noir sur lesquels passaient de translucides nuages rouges.
Tout à coup, elle crut voir des étoiles filantes, des comètes… puis tout devint sombre. Le phénomène ne dura que quelques secondes. Les étoiles revinrent et, avec elles, la jouissance et cette douleur… cette si délicieuse douleur…
Alec était en elle, possédait sa chair et son âme. Buvait son sang, sa vie. Il lui avait dit être un vampire.
Un vampire…
Elle sut soudain que si elle touchait sa gorge, ses doigts seraient maculés de sang. Cependant, il n’était pas le Mal ! Son cœur se refusait à le croire. Si Alec avait dit vrai, elle n’aurait pas éprouvé une telle exaltation des sens.
Il lui sembla qu’elle allait mourir de plaisir.
― Je t’aime, Alec.
Il releva la tête, la fixa de ses yeux d’ébène polie animés d’une lueur incandescente. Éperdue de bonheur, elle détailla son visage si parfait, commença à répondre au sourire qui naissait sur ses lèvres, un sourire tellement empreint d’érotisme…
Soudain, il s’effondra sur elle.
Pourquoi Alec était-il tout à coup immobile, lourd ?
Magdalena le repoussa doucement mais il ne bougea pas et resta allongé, face contre le matelas.
Elle découvrit alors le pieu enfoncé dans son dos, tellement profondément que la pointe devait sortir de sa poitrine.
Un éclair d’acier s’éleva puis s’abattit sur sa nuque, là où elle aimait tant nouer ses doigts… Avec un bruit sourd, le corps d’Alec tomba sur le parquet.
― Vampire ! hurla quelqu’un.
Magdalena hurla en retour, un cri venu du fond de ses entrailles. La lame frappait et frappait encore…
Seigneur ! Ils le décapitaient !
Instinctivement, elle ferma les yeux. Le sang d’Alec coulait sur elle, chaud, épais. Elle recommença à crier.
On écarta le corps d’elle. Instantanément, elle rampa jusqu’à la tête du lit et se recroquevilla contre le bois, incrédule, en hurlant comme une possédée. Son père ! C’était son père qui était là ! Accompagné de ses amis, le frêle Courtemanch et Godwin aux cheveux de neige… Robert Canady se trouvait là aussi. L’air grave, triste, la fixant d’un regard débordant d’amour, il vint vers elle, bras ouverts.
Un cauchemar. Bien sûr, il s’agissait de cela. Elle ne pouvait être en train de vivre cette abomination.
Mais alors, comment se faisait-il que le sang de son amant coulât sur elle, se mêlant au sien qui s’échappait de sa gorge ? Peut-être la scène à laquelle elle assistait était-elle trop horrible pour atteindre sa conscience… Elle rêvait.
Pourtant, le sang… Il existait vraiment.
Mon Dieu ! La mort d’Alec était réelle.
Robert l’enveloppa de ses bras, la serra contre lui en prononçant son prénom comme une litanie. Magdalena avait froid, tremblait, mais ne voulait pas de son réconfort. Elle voulait continuer à hurler.
Robert resserra son étreinte.
― Maintenant, elle est un vampire elle aussi ! s’exclama Godwin, les mains toujours crispées sur son épée.
― Laissez-la tranquille ! ordonna Robert. Au nom du Ciel, souhaitez-vous lui faire encore plus de mal ?
Sa voix était un grondement féroce, autoritaire.
― Elle est ma fille, elle est vivante et elle n’est pas un vampire ! rétorqua Jason. Je peux l’aider ! La soulager !
La… soulager ?
Non. Rien ni personne ne la soulagerait, songea Magdalena dans un éclair de lucidité. Après cette nuit, plus rien ne serait jamais pareil. Elle avait connu l’amour, et voilà que ces hommes qualifiaient son amant de monstre. Son Alec, qui gisait inerte à quelques mètres d’elle, couvert de sang, la tête coupée. Et Courtemanch comme Godwin voulaient se servir du pieu et de l’épée contre elle.
Cela lui importait-il ? Elle n’en savait trop rien. Elle avait vécu des moments tellement magiques… et celui qui avait créé la magie était mort.
Qu’ils la tuent ! La vie ne l’intéressait plus.
D’ailleurs, elle la fuyait, cette vie : elle s’en allait avec son sang qui coulait de son cou. Elle se sentait devenir de plus en plus faible et aspirait à la mort pour être délivrée de cette agonie du cœur bien pire que tous les châtiments corporels.
Elle essaya de se libérer des bras de Robert, de s’approcher une dernière fois de son aimé, mais son père s’interposa.
― Non, Magdalena. Ne regarde pas.
Mais elle regarda quand même. Mon Dieu ! Le corps d’Alec…
il avait disparu. Il n’y avait plus de corps, plus de sang. Là où était étendu son amant quelques instants plus tôt, le parquet semblait s’être consumé ; ne restaient que des cendres formant le dessin d’une silhouette humaine.
Magdalena se remit à hurler.
Puis, peu à peu, son cri s’amenuisa, s’éteignit, emportant le monde avec lui.
― Elle est morte ! Elle va devenir l’une de ces créatures ! assena Godwin.
― Mais non ! Elle dort, corrigea Jason.
― Oui, du sommeil de la mort.
― Elle dort ! tonna Robert Canady.
― Le sommeil de la vie, assura Jason. Elle est mon enfant, ma chair, mon sang et je la sauverai, dit-il en prenant sa fille dans ses bras.
Il l’emporta, l’éloignant de tous, même de Robert et sortit du manoir blanc que l’étrange clair de lune teintait de rouge. Il trébucha, faillit tomber, se rattrapa et reprit sa marche. La couleur rouge de la lune semblait se dissiper. Il leva les yeux et se rendit compte que le ciel pâlissait. L’aube pointait.
Le soleil ! La lumière du jour revenait !
Il se mit à courir, portant toujours sa fille.
Magdalena était étendue dans un monde déroutant, fait de glace et de ténèbres. Il fallait qu’elle s’efforce de chasser la sensation de froid, d’obscurité qui l’enveloppait comme un linceul, elle le savait. Des gens l’appelaient, mais leurs voix paraissaient si lointaines… Elle entrevoyait un rayon lumineux, si loin lui aussi… Elle ne pouvait l’atteindre.
On la portait, se rendit-elle compte.
Crier… Courir vers la lumière…
Impossible.
Qu’on la laisse partir ! supplia-t-elle in petto.
Sa prière muette se perdit dans l’immensité des ténèbres, le vide, la solitude… l’univers au-delà de la mort.
De nouveau, elle éprouva une sensation très étrange : elle avait l’impression que le froid ne la fuirait jamais et pourtant, elle percevait comme de la chaleur autour d’elle. Les ténèbres semblaient tout à coup différentes, des ombres grises atténuaient leur noirceur.
Du temps… Elle avait besoin de temps…
Il y eut d’autres ombres, de la lumière, puis il fit encore noir… Les ombres revinrent, alternant sans répit avec la lumière et l’obscurité.
Il y eut les nuits, qui succédèrent aux nuits.
Puis elle sentit les mains de son père et sut qu’il était auprès d’elle. Un liquide chaud coulait dans sa gorge ; peu à peu, elle déglutissait et se ressaisissait. La réalité reprenait ses droits.
Le temps passa. Elle recouvra des forces, parvint à redresser la tête et à serrer la tasse entre ses doigts, à toucher ceux de son père. Elle était couchée dans son lit, dans sa chambre, son domaine apaisant et rassérénant. Les flammes des bougies dansaient doucement devant ses yeux, leur faible lueur ne les blessait pas. Elle buvait, encore et encore, incapable de déterminer ce que son père lui donnait, mais elle se rendait compte que cela l’aidait, l’arrachait au froid qui l’avait paralysée jusqu’aux os.
Enfin, elle reprit ses esprits et posa des questions.
― Qu’est-ce, père ? Que suis-je en train de boire ?
― Du sang, répondit Jason d’un ton égal. Elle renversa la tête sur son oreiller et pleura. Sans larmes.
― Oh ! père, pour l’amour de Dieu…
― Non, ma chérie. Pour l’amour de mon enfant. Chut ! Dors, maintenant.
Elle referma les yeux et s’enfonça dans une détresse pire que la mort. Cependant, comme l’avait ordonné son père, elle s’endormit.
Le cœur lourd, Jason quitta sa chaise et remonta les couvertures sous le menton de sa fille : elle avait tellement besoin de chaleur !
Il descendit au rez-de-chaussée où ses amis l’attendaient et alla s’appuyer au manteau de bois sculpté de la cheminée : il éprouvait le besoin de se soutenir à quelque chose pour supporter les regards inquisiteurs de ses amis.
C’est soigneusement qu’il choisit ses mots avant de les prononcer.
― Je crois qu’elle va vivre.
Il s’interrompit, hésitant. Mon Dieu ! Pourvu qu’il prononce les bonnes paroles…
― … elle va vivre, et je pense qu’elle va avoir un enfant.
Allemagne, septembre 1944
L’obus explosa à dix pas de la ligne de défense.
Ils auraient dû être habitués au fracas du canon depuis qu’ils croupissaient dans ce trou infâme, et pourtant, ils ne purent s’empêcher de sursauter.
Ils campaient ici depuis près de deux semaines en attendant les renforts. Le bruit courait que les hommes d’Airborne ne tarderaient pas à se montrer, mais à mesure que l’attente se prolongeait, les soldats commençaient à perdre patience. Seul leur jeune lieutenant restait convaincu que les renforts avaient été effectivement envoyés en temps et en heure. Simplement, ils n’avaient pas encore réussi à atteindre leur position. Son instinct, qui ne l’avait jamais trompé, lui disait que les avions avaient déjà largué leur lot de parachutistes. Encore fallait-il que ceux-ci soient arrivés à bon port… Il savait aussi que les pertes risquaient d’être lourdes : parachutes emmêlés dans les branches, hommes abattus pendant que leur voilure flottait dans le ciel d’un bleu absurde, achevés dès qu’ils avaient touché terre ou faits prisonniers. Une farouche détermination de dominer l’Europe animait encore l’armée allemande.
― Nom d’un chien, c’était tout près ! s’exclama Ted Myers en se signant.
Ses yeux bleu pâle bordés de rouge brillaient au milieu de sa figure noircie par la suie. À ses côtés, Jimmy Decker s’était mis à trembler de tous ses membres avant de s’aplatir, secoué de convulsions, contre le muret de terre qui leur tenait lieu de bouclier.
― Myers, emmenez-le à l’infirmerie, ordonna le lieutenant.
― Y a plus d’infirmerie, chef, lui annonça le sergent Walowski, qui s’était assis, dos au mur boueux, et avait extirpé une cigarette de sa poche. Bombardée hier soir.
― Les infirmiers l’ont installée un peu plus loin. Eh bien, Myers, faites donc ce que je vous dis.
Le lieutenant regarda à travers une fissure pratiquée à même la paroi de terre compacte. La nuit ne tarderait pas à tomber. Cela voulait dire qu’ils allaient essuyer un nouveau tir mortel. Ensuite, l’ennemi, tapi dans le sous-bois, tenterait une sortie. Le nombre de ses soldats n’avait pas cessé de diminuer, et les survivants étaient épuisés. Ils avaient tenu le coup pendant presque deux semaines dans des conditions déplorables. Pratiquement tous étaient des tireurs exceptionnels ; ils n’avaient pas cédé d’un pouce et semblaient toujours capables de refouler l’adversaire – les troupes d’élite allemandes qui avaient reçu l’ordre de les débusquer et qui étaient prêtes à sacrifier leur vie à la gloire de la mère patrie. Oh, cela ne durerait pas éternellement, songea-t-il avec amertume. Ne serait-ce qu’à cause de l’écrasante supériorité en nombre des Allemands – on eût dit qu’ils étaient chaque jour plus nombreux. Et quand bien même cinquante ennemis tomberaient sur le champ d’honneur contre un seul de ses soldats, ces derniers finiraient par capituler. À moins que les renforts n’arrivent très vite. Un sifflement strident déchira le silence.
― Couchez-vous ! ordonna-t-il.
Myers, qui entraînait Decker à travers champs vers l’infirmerie, se courba en deux, sans cesser de courir. Au fond de l’excavation creusée par les bombes, les soldats s’aplatirent contre la paroi humide, mais cette fois-ci, l’explosion retentit plus loin que la précédente.
― Restez couchés !
Deux nouvelles déflagrations firent ruisseler une pluie terreuse sur leurs uniformes déjà affreusement sales. Personne ne bougea. Aucun cri de douleur ne fendit l’air lourd, signe qu’il n’y avait pas de blessé.
― Ils vont passer à l’attaque, annonça le lieutenant. Ils vont essayer de nous tomber dessus à la faveur de la nuit. Ne gaspillez pas vos munitions. Ne tirez pas avant que je ne vous aie donné l’ordre.
― Exact ! approuva l’un des soldats. Pas avant qu’on n’ait vu le blanc de leurs yeux !
― Bah, on verra jamais leurs yeux dans cette foutue poussière, répliqua Lansky.
Lansky était le vétéran du régiment. Il venait de fêter ses quarante-cinq ans quand la guerre avait éclaté et avait rejoint l’armée américaine deux jours après que son fils avait été tué en Italie. Les recruteurs n’avaient pas tenu compte de son âge. Lansky faisait partie des cracks. Redoutable chasseur de bisons dans le Montana, il ne manquait pour ainsi dire jamais sa cible.
― Chaque balle compte, précisa le lieutenant.
Il avait la moitié de l’âge de Lansky, mais ce dernier obéissait loyalement aux ordres du lieutenant, lequel le considérait comme un ami. Lansky en avait vu des vertes et des pas mûres lors de la Première Guerre mondiale et en avait retiré une expérience précieuse. Souvent, il suggérait des plans d’attaque intéressants, sans toutefois offenser son supérieur hiérarchique.
À présent, le vétéran fixait son jeune chef.
― Ils arrivent, murmura-t-il. Je le sens.
Le lieutenant répondit par un simple hochement de tête. Un instant après, ce fut un déferlement d’uniformes gris. Les soldats allemands surgissaient de toutes parts en poussant des cris guerriers. Décidément, l’être humain ne changeait pas, se dit le lieutenant. De tout temps, les combattants avaient éprouvé le besoin de pousser des cris féroces avant de se jeter dans la mêlée, ne serait-ce que pour se prouver qu’ils étaient encore vivants.
― Feu ! tonna-t-il.
Le premier rang des assaillants chancela, vacilla, puis s’écroula comme un château de cartes. Mais, presque aussitôt, d’autres soldats jaillirent à travers les brumes du crépuscule.
― Feu !
Les balles rugirent, brisant l’assaut. Telle une armée fantôme, les ennemis continuèrent à se déployer aveuglément autour du fossé, sous une avalanche de balles.
― Feu !
L’odeur âcre de la poudre rendait l’air irrespirable. Dans le noir, ils entendirent des râles d’agonie, tandis que d’autres hommes, blessés, tombaient. Les attaquants étaient maintenant de plus en plus proches.
Un soldat ennemi se matérialisa brusquement dans la nuit. Il sauta dans la tranchée, l’arme pointée sur Lansky. Le lieutenant abattit violemment la crosse de son fusil sur la nuque de l’Allemand, qui s’effondra, inanimé. Peu après, d’autres silhouettes se profilèrent dans la clairière.
― Feu à volonté !
Dans les minutes qui suivirent, un sanglant corps à corps s’engagea. Bientôt, les Allemands seraient dans le refuge, et on ne saurait plus où donner de la tête. Un assaillant reçut une balle en pleine poitrine et dégringola le long de la pente embourbée, écrasant Lansky sous son poids. Lansky venait de repousser le cadavre et recommençait à tirer quand, soudain, un étrange hurlement emplit la nuit.
Ce n’était pas le cri guerrier des ennemis, mais un glapissement bizarre, effrayant, semblable à la clameur qu’auraient pu produire les damnés dans les profondeurs de l’enfer, une sorte d’aboiement si surprenant, si déchirant que, pendant plusieurs minutes, il n’y eut plus le moindre coup de feu. Dans les deux camps, les soldats retenaient leur souffle, muets, et ce silence oppressant paraissait bien plus atroce que le tumulte des combats.
McCoy, un jeune homme originaire de Boston, chuchota :
― Que Dieu nous protège !
Alors, l’enfer se déchaîna. L’étrange aboiement reprit en même temps que les coups de feu, que défenseurs et attaquants échangeaient au milieu des ténèbres. Puis un nouveau vacarme recouvrit tous ces bruits. On eût dit un roulement de cavalerie, comme si un millier de chevaux galopaient dans leur direction. De longs cris de terreur s’élevèrent parmi les Allemands, dans une obscurité d’encre rendue plus noire encore par les nuages de poussière.
― Je vous salue Marie, pleine de grâce… murmura McCoy.
― Par tous les saints ! s’exclama Lansky, alors qu’un soldat allemand dégoulinant de sang émergeait de la brume et venait s’abattre au fond du trou avec un bruit mat.
C’est alors que les créatures firent irruption.
Des loups, à moins que ce ne fût de grands chiens, au pelage argenté, noir ou fauve. En tout cas, des animaux qui ressemblaient à des loups, sauf qu’ils étaient beaucoup plus gros et que leurs yeux, rouges comme des braises, luisaient dans la nuit, tandis qu’ils bondissaient vers les hommes.
― Feu ! Feu ! rugit le lieutenant.
La pétarade de la mitrailleuse lui fit écho, et l’instant d’après, ce ne fut plus qu’un épouvantable bourbier d’uniformes allemands et américains entremêlés, si intimement imbriqués les uns dans les autres que l’on ne pouvait plus les distinguer.
― Feu ! Feu ! Feu !
Ses hommes s’exécutèrent. Il entendit les déflagrations assourdissantes. Près de lui, Lansky fut soudain happé par quelque chose. Aussitôt après, un officier allemand vint s’écraser dans la tranchée, mort, les yeux grands ouverts.
― Lansky !
Le lieutenant tomba à genoux et se mit à ramper dans la boue, décidé à ramener son ami à l’abri. Les balles sifflaient furieusement à ses oreilles tandis qu’il progressait lentement, laborieusement.
Quelque chose le heurta. Quoi ? Il n’en savait rien, mais il sentit un poids terrible dans le dos, puis une piqûre sur la nuque. Oh… qu’était-ce ? Il n’aurait su le dire. Il éprouvait une sensation de brûlure. Non, aucune douleur à proprement parler, à part cette piqûre. Il avait été touché, réalisa-t-il, mais par quoi ? Une baïonnette ? Un de ces loups féroces ? Il respirait, pourtant.
Oui, il était vivant, puisqu’il respirait. Il respirait et continuait à ramper.
Enfin, Lansky lui apparut. Le tireur d’élite était affalé sur la bordure déchiquetée de l’excavation. Il fallait vite le ramener à l’intérieur. Des gouttes de sueur tombèrent devant ses yeux.
Non, ce n’était pas de la sueur. Du sang ! Sa vision se brouillait.
Mais il refusait de mourir là, dans la boue. Tout comme il refusait de perdre la bataille de façon aussi lamentable. Il jeta un furtif coup d’œil à la silhouette inerte de Lansky, aperçut sa main pâle sur le sol noirâtre. Il se redressa, attrapa la main de son ami et l’attira vers lui. Le corps vint d’un seul coup et le jeune lieutenant se recroquevilla, horrifié. Lansky n’avait plus de tête… Un cri d’épouvante mourut dans la gorge du lieutenant. Il se sentait brûlant, mais bientôt, le feu qui le consumait se fondit dans un froid glacial.
« La mort est froide », songea-t-il.
Il agonisait. La vie s’enfuyait de lui en même temps que son sang, qui s’écoulait à travers les lèvres de la petite plaie qu’il avait derrière la nuque. La lumière chiche des étoiles avait complètement disparu, tout comme les bruits. Il n’entendait plus rien, ni râles, ni appels au secours, ni coups de feu. L’air semblait suspendu, immobile. Le silence enveloppait la campagne dans un suaire glacé. Ses forces déclinaient, mais il était toujours conscient.
Toujours vivant.
Pour le moment.
Le temps filait, filait, tel un cours d’eau bruissant dans un paysage figé.
Puis il y eut comme un bruit de pas.
C’étaient bien des pas.
Ils approchaient.
À présent, il les percevait clairement, qui martelaient durement le sol. Quelque chose se posa près de sa tête. Il cligna des yeux. Sa vision rétrécissait jusqu’à n’être plus qu’un minuscule orifice au milieu d’un brouillard rouge et noir.
Oui, indéniablement, quelque chose s’était posé près de lui.
Il rouvrit péniblement les paupières en luttant pour rester conscient, sachant pourtant que la fin était proche.
Enfin, il l’aperçut.
Une botte.
Une botte noire, plantée dans la fange sanguinolente. Sous la couche de boue séchée qui recouvrait le cuir noir, un petit objet scintillait. Avant de refermer les yeux, il reconnut l’insigne.
Une croix gammée.
Ce fut sa dernière pensée – la dernière image qu’il vit.
L’épais brouillard cramoisi engloutit l’univers, puis il n’y eut plus que les ténèbres.
La pleine lune, haute dans le ciel, semblait regarder ironiquement la terre. Il leva brièvement les yeux vers elle. La clarté de l’astre lui facilitait les choses. Il avait choisi le sommet du Campanile pour surveiller la cité. De son perchoir, il observait les déambulations des passants tout en bas, et savourait la beauté du ciel au-dessus de lui. Il sentait sa tension grandir, ses capacités de perception s’accroître. Venise. Le carnaval. La première nuit de fête, les premiers grands bals… Un mardi de folie.
Ce soir. Ils frapperaient ce soir.
Dominos, travestis, gens en costumes aussi poétiques qu’excentriques ou en habits Grand Siècle arpentaient les ruelles, se déplaçaient en gondole ou en vaporetto le long des canaux. Musiciens, comédiens, acrobates donnaient des représentations à chaque coin de rue, sur chaque placette où les badauds s’arrêtaient. Riches et pauvres mêlés étaient bien décidés à profiter de la fête. Cette nuit appartenait aux ombres.
Oui, ils allaient profiter de cette atmosphère fantastique qui baignait la ville pour agir.
Sauf si quelqu’un les en empêchait…
En silence, avec la grâce d’un prédateur nocturne, il quitta son poste de guet, descendit le long escalier en colimaçon du Campanile et se fondit dans la cité.
À l’hôtel Danieli, Jordan Riley ouvrit les persiennes de sa fenêtre et regarda le quai grouillant de monde, le Grand Canal et sa noria d’embarcations diverses. De l’autre côté du canal, le dôme de marbre blanc de Santa Maria della Salute se dessinait sur le ciel sombre. En se penchant sur la droite, de son balcon qui donnait sur la Riva degli Schiavoni, la jeune femme voyait les arbres du square Saint-Marc et l’entrée de la célèbre place.
La nuit résonnait de cris, de rires. Dans un joyeux désordre, la foule était déterminée à jouir de chaque instant passé dans la ville magique, et à profiter de cette période d’avant le carême pour se livrer à toutes les folies. D’autres villes de par le monde célébraient le carnaval, mais aucune ne le faisait avec autant de talent et d’enthousiasme que Venise. Les gens se déguisaient mais demeuraient d’une élégance raffinée, ce qui n’était pas le cas ailleurs.
― Jordan, tu es prête ?
La jeune femme se retourna. Jared se tenait dans l’embrasure de la porte de la chambre. Seule sa voix lui avait permis de reconnaître son cousin. Il s’était déguisé en médecin, un costume très populaire dans la Sérénissime, avec son masque noir doté d’un long nez blanc recourbé. Ces masques, les médecins les portaient au XVIe siècle, lors des épidémies de peste, pour se protéger de la contagion.
Jordan les trouvait effrayants, surtout lorsque celui qui les arborait ajoutait à sa tenue une longue cape noire avec capuche. Nombreux étaient ceux qui adoptaient ce travestissement lors du carnaval, sans doute parce qu’il était facile à réaliser et peu coûteux.
― Alors, Jordan ! Tu es prête ? Je suis sur des charbons ardents à force d’attendre ! C’est le délire, dehors ! J’ai hâte de plonger dans le bain !
Jordan était venue plusieurs fois à Venise, mais jamais lors du carnaval. Cette année, son cousin et sa femme Cindy l’avaient persuadée de les accompagner. Elle ne se sentait pas très à l’aise avec le couple. La cinquième roue du carrosse… Se rendre à un bal sans cavalier, comme elle s’apprêtait à le faire, la mettait mal à l’aise. D’accord, elle parlait un peu italien, mais juste assez pour se faire comprendre dans un café ou un hôtel. Pas de quoi soutenir une conversation. Bien des Vénitiens se débrouillaient en anglais. N’empêche, elle craignait d’être placée entre deux hommes incapables de communiquer avec elle.
― Dieu merci, tu viens, reprit Jared. J’avais peur que tu te défiles.
― Moi ? Et pourquoi ça ? Jamais ça ne me viendrait à l’esprit !
Pur mensonge : elle avait effectivement songé à se dérober. Jusqu’au crépuscule, lorsque les musiciens avaient commencé à jouer un peu partout, les passants à rire à gorge déployée, les premiers déguisements à apparaître. L’excitation était alors montée en elle, balayant ses réticences. Elle irait à ce bal. Il se trouverait bien quelque galant homme qui la ferait danser et avec lequel elle échangerait deux ou trois mots.
― Tu es super, tu sais, Jordan.
― Oh, merci…
Elle avait loué son costume à la dernière minute, mais il était magnifique. Une robe Renaissance rebrodée, ornée de sequins et de fausses pierreries. Les bijoux qui allaient avec étaient également du toc, mais qui s’en rendrait compte ? L’illusion était parfaite. La robe avait été disponible parce que celle qui l’avait réservée un mois plus tôt avait annulé son voyage. Une femme menue, de petite taille. Un vrai coup de chance.
― Ouais, tu es éblouissante, et aussi… bizarrement grande.
― Ce sont les chaussures, dit Jordan en soulevant le bas du jupon.
Jamais elle n’avait marché sur de si hauts talons. Les dames d’autrefois ne se martyrisaient sûrement pas les pieds avec ce genre de souliers. Hélas, la loueuse n’avait rien d’autre à lui proposer. Un anachronisme, mais une concession au charme féminin : une femme sur des talons aiguilles avait quand même plus de charme qu’en mocassins.
― Espérons qu’au cours de la soirée, tu ne vas pas rétrécir comme grand-mère Jay, remarqua Jared.
― Ça n’est pas sympa : tu es tellement grand que tu n’as pas le droit de te moquer de ceux qui n’ont pas hérité des gènes familiaux.
En revanche, si elle était aussi petite que grand-mère Jay, Jordan avait hérité, à l’instar de Jared, de ses yeux verts. Ces prunelles couleur de forêt et le goût des endroits nouveaux, des villes dépaysantes comme Venise, faisaient partie des points communs que partageaient Jordan et son cousin.
― Tu arriveras à marcher sur ces trucs-là ? s’enquit-il.
― Oui, je me suis entraînée.
― Eh, vous deux, remuez-vous ! Il se fait tard !
Cindy venait à son tour d’entrer. Presque aussi grande que Jared, elle formait avec son mari un couple très harmonieux.
― Jordan, tes chaussures sont extra ! Du coup, peut-être les gens ne penseront-ils pas que tu es ma fille…
― Cindy, tu as fini de te payer ma tête !
― Me payer ta tête ? Mais c’est un compliment que je viens de te faire ! Je n’ai que cinq ans de plus que toi, et pourtant il y a des gens qui me prennent pour ta mère, tellement tu as l’air juvénile !
― Arrêtez, les filles, et allons-y. Vous êtes sublimes toutes les deux, O.K. ?
Quelques minutes plus tard, le trio traversait le majestueux hall de réception du Danieli. Sous ses plafonds à caissons vieux de cinq cents ans, les employés zélés et stylés du palace s’activaient, tous masqués, dédiant au passage compliments et gentils souhaits aux clientes. Cette nuit ne serait qu’amabilités et gaieté, se dit Jordan.
Le seuil de l’hôtel franchi, la foule les happa. Avec peine, ils taillèrent leur chemin le long du quai, au milieu des touristes. On entendait toutes les langues. Les queues s’étiraient devant les embarcadères des vaporettos.
Jared fendit la masse humaine, les deux femmes à sa suite, et s’arrêta près de l’appontement privé du Danieli, sur un petit canal perpendiculaire au Grand Canal.
― Attendez-moi là, vous deux. Je m’occupe de notre gondole.
Sa cape fouettant l’air comme des ailes de chauve-souris, il s’éloigna. Jordan le vit parlementer avec l’homme en tenue traditionnelle de gondolier, qui se tenait en équilibre sur la minuscule plate-forme arrière de son embarcation. Autour de lui, les gondoles étaient collées les unes aux autres dans un inextricable méli-mélo.
Ils allaient se rendre au bal en gondole, le sommet du romantisme, songea Jordan : une soirée dans un palais privé ! Le top, vraiment. Agent de voyage qui s’occupait des séjours d’Américains à Venise, Jared n’incluait jamais ce bal à son programme.
S’il s’y rendait en compagnie de sa femme et de sa cousine, c’était parce qu’il était invité. La comtesse Nari Della Trieste triait ses hôtes sur le volet. Il fallait montrer patte blanche pour franchir le seuil de son palazzo et, le lendemain de la fête, les journaux parlaient toujours du plus beau bal de la saison. Jared passait davantage de temps en Italie qu’aux États-Unis.
Son italien était désormais parfait. Il disait préférer ce pays à l’Amérique, s’y sentir vraiment chez lui.
Quel dommage qu’elle ne possédât que quelques bribes de cette belle langue, songea Jordan avec regret lorsqu’un Italien en smoking, un long cache-nez de fourrure grise autour du cou, s’arrêta près d’elle et lui débita d’une voix de velours ce qui devait être un compliment… Elle ne put lui offrir qu’un sourire en retour et il s’éloigna.
― Il va falloir que je te surveille comme le lait sur le feu, commenta Cindy en riant. J’ai cru que le rat allait t’embarquer.
― Le rat ?
― L’homme… Il était costumé en rat. Tu n’as pas remarqué la queue sur ses épaules ? Elle partait de dessous sa veste…
― Oh, mon Dieu… Pourquoi se déguiser en rat ?
― Tu en verras d’autres, et aussi des loups… Les Italiens aiment beaucoup se costumer en prédateurs. Ça leur permet de justifier leur envie de dévorer les petites demoiselles. Or tu es une proie de choix, ma chérie. Je ne… Ah, Jared nous appelle. La gondole est là.
― Non, précisa celui-ci en les rejoignant. Le gondolier me dit qu’avec l’embouteillage qu’il y a sur le canal, nous ne serons jamais à l’heure au bal. Je suggère qu’on embarque devant le square Saint-Marc. Un de ses collègues nous attend. Ensuite, le trajet jusqu’au palazzo se fera sans trop de mal.
― Ça me paraît raisonnable, d’autant que si nous restons ici, notre Petit Chaperon rouge va se faire enlever par un rat ou un loup, dit Cindy.
Jared fronça les sourcils.
― Comment ça ?
Cindy haussa les épaules.
― Nous devons veiller sur notre chère Jordan, sinon elle va se faire croquer ce soir. Elle est délectable, non ?
― Mmm. Exact. À propos, Jordan, ces seins arrogants, ils sont vraiment à toi ?
― Tu es vulgaire, Jared ! Mais, oui, ils sont à moi, rétorqua Jordan en riant. Et toi, qu’est-ce que tu caches sous ta jaquette ?
Cindy leva les yeux au ciel.
― Dieu merci, nous sommes en Italie : peu de gens comprennent ce que vous dites. Mais quand même !
L’éclat de rire fut général.
― On y va ?
De nouveau, ils fendirent le flot de la foule. Jared tenait fermement le bras de sa cousine, qui lui en était reconnaissante.
Ainsi, elle pouvait marcher sans se préoccuper de ses pas et regarder autour d’elle, écouter les sons, humer l’air imprégné d’une forte odeur d’algues. Il faisait frais, la ville était en ébullition, merveilleusement vivante. Des lumières dansaient sur l’eau du Grand Canal, reflets des lanternes des gondoles, des fanaux des barques, des guirlandes accrochées aux façades des palais et des restaurants sur pilotis. La symphonie de couleurs était sublime. Jordan se croyait dans un conte de fées peuplé de créatures fantasmagoriques : les déguisements allaient des animaux mythiques aux créatures de légende. Princes vêtus de doré, reines à faire pâlir d’envie la mère de Peau d’Âne, à la tête ceinte de couronnes à l’ornementation complexe et magnifique, aux épaules ornées de plumes chatoyantes. Le luxe des étoffes, la finesse et la recherche de la coupe des robes, la sophistication des masques de porcelaine aux traits d’une pureté éthérée, tout concourait à offrir un spectacle qui resterait à jamais gravé dans sa mémoire. Dommage qu’il y eût des costumes inquiétants : ces loups, ces rats… Ils pullulaient, nota-t-elle dans un frisson.
Elle ramena son attention sur les touristes non déguisés. C’était à qui brandirait le plus haut sa caméra ou son appareil photo pour prendre le plus d’images possible. Des éclairs de flashes éclataient de tous côtés. Des parents portaient leurs enfants sur leurs épaules tout en pointant l’index sur tel ou tel costume.
Ils atteignaient l’embarcadère du square quand l’impression d’être observée l’incita à tourner la tête. Pourquoi l’aurait-on scrutée, elle en particulier ? se demanda-t-elle tout en cherchant les yeux qui s’étaient rivés sur elle. Ceux du Lion de Venise ? La statue sur son piédestal semblait la fixer. Était-ce du fauve de marbre que lui était venue cette sensation ? Ou bien des gargouilles du palais des Doges, plus loin ?
Allons, ni humain ni créature minérale ne s’intéressait particulièrement à elle. Peu habituée à se trouver dans une foule aussi compacte et aussi agitée, elle avait été la proie d’un mirage.
― Attention où tu mets les pieds, l’avertit Jared en la guidant vers un taxi d’acajou verni à l’emblème du Danieli.
Ah, pas de gondole, mais un canot. D’un luxe désuet, constata-t-elle en s’asseyant sur la banquette extérieure habillée de cuir vert émeraude. Les cloches des églises se mirent à sonner à ce moment-là. Comme s’il avait attendu ce signal, le pilote fit démarrer le moteur et le canot s’engagea dans le Grand Canal à petite vitesse, dessinant derrière lui un sillage qui bien que minime était meurtrier pour les fondations des palais.
Tout en se gorgeant de la splendeur des façades que longeait le taxi, Jordan se remémora ce qu’on lui avait dit du bal de la comtesse Nari, et de la personnalité de celle-ci.
Richissime héritière de plusieurs maris défunts, Nari Della Trieste préférait à toutes ses demeures celle léguée par son premier époux, un palais du XVe siècle qui se dressait sur le Grand Canal.
Le canot accostait précisément au ras de l’escalier en demi-cercle qui descendait jusque dans l’eau. Au-delà de la volée de marches, une grille ouvragée livrait l’accès au palais même. Des valets en livrée portant masque et perruque aidaient les dames à sortir des embarcations sous les flambeaux qui éclairaient le débarcadère.
Jordan et ses cousins longèrent un couloir à voûte croisée qui débouchait dans un gigantesque vestibule, d’où partait un escalier de marbre conduisant à l’étage.
La comtesse accueillait ses invités dans ce vestibule orné de fresques en trompe l’œil.
De taille et d’âge moyens, la comtesse affichait une beauté époustouflante. Son corps fin enchâssé dans une somptueuse robe blanche à paniers ornée de plumes que l’on retrouvait dans sa coiffure et autour de son loup, elle souriait de toutes ses dents parfaites.
Elle embrassa Jared et Cindy sur les deux joues, puis prit les mains de Jordan entre les siennes.
― Oh, Jared ! Che bellezza, la cousine ! Cara mia, vous êtes un rêve ! Euh… vous ne parlez pas italien, n’est-ce pas ?
― No… non, bredouilla Jordan, impressionnée.
― Je parle anglais. Merci d’être des nôtres, merci d’être venue à ma soirée. Vous en serez le joyau.
― Je ne…
― Ne vous inquiétez pas, coupa la comtesse, la plupart des invités parlent votre langue. Mais parfois, il est tellement plus amusant de ne pas se comprendre…
À travers le loup, Nari Della Trieste décocha un clin d’œil complice à Jared. Jordan s’en étonna : il était manifestement l’un des intimes de la comtesse. Comment se faisait-il qu’il ne lui en ait jamais touché mot ? Elle croyait que Jared entretenait simplement des relations d’affaires avec l’aristocrate.
L’évidente complicité qui régnait entre l’hôtesse et ses cousins mit Jordan mal à l’aise, sans qu’elle comprît pourquoi.
― Le buffet est au premier étage, dit Nari Della Trieste en prenant Jared et Cindy par les épaules.
Ses cousins symbolisaient l’image du couple parfait, songea Jordan. Beaux, amoureux, et d’excellente compagnie. Rien d’étonnant à ce que la comtesse les appréciât.
Un serveur passait, un plateau chargé de flûtes de champagne à la main. Nari Della Trieste l’arrêta et chacun se servit.
― Quant à la danse, poursuivit-elle après avoir bu une gorgée de champagne, elle est partout. Dans toutes les pièces de ma demeure. Allez, mes amis, amusez-vous.
La comtesse s’éloigna pour souhaiter la bienvenue à un autre groupe. Jared reprit son épouse et sa cousine par le bras et, flanqué des deux femmes, se dirigea vers le grand escalier.
― Jordan, je te promets de ne pas te laisser seule pendant le dîner, mais j’ai quelques personnes à voir. Des relations de travail, tu sais ce que c’est dans ce genre de raout…
Non, Jordan ne savait pas, mais elle imaginait aisément que l’on profitât de ces soirées pour joindre l’utile à l’agréable.
― Tu entends ça, Jordan ? Il s’excuse par avance de t’abandonner, et il se soucie de moi comme d’une guigne !
― Chérie, tu connais plein de gens, ici, se justifia Jared.
Ils se trouvaient en haut de l’escalier. Cindy balaya du regard la salle bondée de gens costumés et masqués sur laquelle donnait le palier.
― Es-tu sûr qu’on puisse reconnaître quiconque là-dedans ? demanda-t-elle.
Jordan partageait l’avis de sa cousine. Les loups et les masques préservaient un anonymat peut-être excitant pour certains mais, en ce qui la concernait, plutôt angoissant.
Les costumes étaient d’une somptuosité qu’elle n’avait pas vue dans les rues. Extravagants et cependant d’une élégance suprême, ils avaient coûté, c’était patent, des fortunes. Les bijoux qu’arboraient les femmes étaient authentiques. Pas de strass ni de verroterie de couleur, mais des pierres dont la totalité réunie eût rempli la vitrine du plus grand des bijoutiers de la place Vendôme.
Dans sa robe de velours acrylique, avec ses sequins de plastique et ses bijoux de pacotille, Jordan se sentait déplacée. Cette femme, là, à sa droite… sur son corselet étaient cousues de vraies émeraudes à l’éclat incomparable !
― Jordan, navré, mais l’espèce de paon au gros postérieur,
près de la fenêtre, c’est Mme Meroni. Je vais juste la saluer et… Mais viens donc avec moi, si tu veux.
― Ça ira, Jared. Je me débrouillerai.
Cindy s’était déjà éclipsée. Jordan l’apercevait à bonne distance, en grande conversation avec un homme en frac au loup d’argent.
― Tu es sûre ?
― Oui, Jared.
― Bon. Mais fais gaffe aux rats…
― … et aux loups, je sais. Je ne parlerai qu’à ceux qui ont mangé à leur faim.
― À ceux qui sont cacochymes aussi : un mariage avec un vieux loup richissime ferait de toi une ravissante héritière…
― J’essaierai de ne pas oublier cet excellent conseil.
Jared opina en riant, puis s’éloigna.
Il la vit se diriger lentement vers le buffet.
Elle était petite, menue, parfaite. Une vraie tanagra. Ses longs cheveux noirs retenus sur le front et les tempes par une fine tresse serrée, selon le style Renaissance, coulaient sur ses épaules. La teinte cramoisie de sa robe rehaussait le jais de sa chevelure et la nacre de sa carnation. Pas une tanagra, rectifia-t-il, mais une Botticelli. Les autres femmes pouvaient bien porter des toilettes d’une richesse et d’une recherche rares, la plus belle et la plus élégante, c’était elle.
À l’instar de nombre d’invités, elle tenait son masque au bout d’une baguette, le plaquant de temps à autre sur son visage, mais le laissant de côté le plus souvent pour boire du champagne et avoir le regard libre de toute entrave. Un regard qui survolait sans cesse l’assemblée, ne s’arrêtant que de brefs instants sur quelqu’un en particulier. Elle ne connaissait manifestement personne, et découvrait de surcroît la difficulté que présentait le fait de tenir le masque tout en buvant et en grignotant des crevettes empalées sur des bâtonnets.
Il quitta la galerie circulaire, son poste d’observation, et descendit dans la salle sans quitter la jeune femme des yeux.
Il la rejoignit devant le buffet et l’aborda en anglais.
― Bonsoir. C’est sans doute cavalier de ma part de vous adresser la parole sans que nous ayons été présentés, mais il m’a semblé qu’il y avait urgence, que vous aviez besoin d’un chevalier servant pour vous sortir d’affaire…
― Pardon ?
― Vous avez un problème qui nécessite une assistance immédiate.
Sur ces mots, il lui prit la flûte des doigts.
― Voilà. Maintenant, vous pouvez tranquillement déguster les amuse-gueules.
Elle leva sur lui ses grands yeux verts, et il y discerna une étincelle amusée, ainsi que de la reconnaissance.
― Merci, mais je dois me montrer prudente, fit-elle en souriant. J’ai promis à mon cousin de me méfier des rats, des loups et autres prédateurs nocturnes.
― Sauf s’ils sont vieux et milliardaires.
― C’est ça.
Elle le détailla de la tête aux pieds.
― Vous êtes un loup.
Du bout du doigt, elle montra le masque de cuir repoussé, duquel saillaient des pommettes, un nez, une bouche entrouverte aux lèvres relevées sur des dents pointues, puis la cape doublée de fourrure.
― Peut-être suis-je un loup riche, mais jeune ? Tentez donc le coup, essayez-moi… Dansons ensemble.
― Oh, je ne…
― Détendez-vous. Nous sommes à Venise et c’est le carnaval.
Elle marqua une hésitation, puis hocha la tête.
― D’accord.
La minute suivante, ils se trouvaient au milieu de la piste de danse aménagée sur la terrasse qui donnait sur l’arrière du palais, au-dessus d’un étroit canal. Le clair de lune métamorphosait l’eau en miroir dans lequel se reflétaient les couples. L’orchestre jouait une valse. Jordan, peu au fait des danses de salon, craignait de lui marcher sur les pieds. Mais lui savait valser. Et il était même un expert ! À croire qu’il avait passé sa vie à faire tournoyer des demoiselles. Néanmoins, elle avait quelque difficulté à suivre.
― Vous êtes un peu trop grand pour moi, remarqua-t-elle, se sentant presque soulevée par ses bras puissants.
― Vous êtes un peu trop petite pour moi, repartit-il en riant, mais on va s’en accommoder.
Puis, après l’avoir fait virevolter, il demanda :
― Vous êtes américaine, n’est-ce pas ?
― Oui. Cela s’entend, je suppose.
― L’accent américain est plus révélateur qu’un tatouage sur le front. D’où venez-vous ?
― Charleston, Caroline du Sud. Et vous ?
― Actuellement, je suis italien. J’aime ce pays. Les Italiens sont les gens les plus chaleureux du monde.
― Mais où êtes-vous né ?
Il réfléchit rapidement. Il n’allait pas lui dire la vérité. Pas ce soir, tout au moins. Ultérieurement, il aviserait. Trop se dévoiler aujourd’hui serait une erreur.
Or les erreurs, il les accumulait, songea-t-il. Jamais il n’aurait dû lui parler, encore moins danser avec elle. Dans un moment… Eh bien, il aviserait aussi. Les yeux de la jeune femme l’avaient captivé, attiré comme une flamme attire un papillon de nuit. Ses sens étaient éveillés.
Elle détenait le don de le charmer, corps et âme. Enfin, « âme », façon de parler…
― Alors, monsieur le Loup ? D’où êtes-vous originaire ?
― Pardon ? Oh, je… je viens de très loin. Et ce n’est… Oui ?
On lui tapait sur l’épaule. Les derniers accents de la valse s’étaient éteints et le pianiste de l’orchestre plaquait les premiers accords d’un nouveau morceau.
― Oui ? répéta-t-il.
Un homme en costume victorien, manifestement anglais, lui demanda l’autorisation de lui emprunter sa cavalière. Il ne put refuser. Il recula et garda les yeux rivés sur la jeune femme pendant les longues minutes où l’Anglais la fit évoluer sur la piste.
Ses pieds la torturaient. Danser sur des talons hauts était un supplice. Mais comparé au plaisir qu’elle éprouvait, ce désagrément était mineur. Cette soirée à laquelle elle avait hésité à participer se révélait follement distrayante. D’abord, il y avait le Loup, cet homme énigmatique et tellement séduisant. Compte tenu de son masque, elle savait peu de chose de ses traits, mais les pressentait superbes. Le reconnaîtrait-elle si elle le rencontrait après cette nuit magique ? Probablement, ne fût-ce qu’à cause de sa haute taille et de sa carrure athlétique. Et puis il y avait son parfum… Il s’était gravé dans sa mémoire.
Elle espérait danser de nouveau avec lui, mais un Arlequin l’enleva à l’Anglais, puis ce fut un Joker, comme sur les cartes à jouer. Ce dernier la complimenta de façon appuyée. Quels beaux cheveux couleur de nuit… Et ces yeux verts… Oh, et son cou de cygne, il le mettait dans tous ses états…
― Vous devenez un peu trop pressant, monsieur, dit Jordan en s’écartant de lui.
Il la ramena contre sa poitrine.
― Cette peau diaphane sous laquelle se dessinent vos veines… On les voit palpiter, on entend battre votre pouls…
Jordan essayait de se défaire de l’étreinte du Joker quand un invité en costume de cuir noir figurant la Mort, posa sa faux contre un mur et vint l’arracher aux bras trop audacieux.
Il était espagnol. Grand, plein de charme. Lui aussi lui dédia force compliments, mais dans un registre courtois. Il la trouvait rayonnante d’énergie, dit-il. Selon lui, de la lumière irradiait de son corps. Jordan ne put faire autrement que de le remercier en rougissant. Cet homme-là ne portait pas de masque, mais avait enduit son visage de fond de teint gris perle brillant, qui faisait paraître encore plus sombres ses yeux noirs. Très sexy, vraiment. Décidément, les beaux hommes ne manquaient pas chez la comtesse Nari. Cindy avait eu raison de lui dire de se méfier des prédateurs. Ils étaient légion.
Elle bavardait avec l’Espagnol de choses et d’autres lorsqu’une clochette tinta. Des invités, la plupart de sexe masculin, tous en noir, se regroupèrent sur la terrasse autour d’un nain, qui se mit à taper dans ses mains pour captiver son auditoire. Le silence s’étant fait autour de lui, il clama :
― Oyez, oyez, gentes dames et beaux messieurs ! Le jeu va commencer !
Une pause pour ménager ses effets, puis :
― Il y a bien, bien longtemps, Odo, comte du château, avait une fille mais pas de fils. Décidé à remédier à cela, il amena en son fief, lors du carnaval, une femme d’une beauté sans pareil.
Elle allait lui donner un descendant mâle, foi d’Odo !
Le nain prit par le bras une invitée en costume moyenâgeux et lui demanda si elle acceptait de tenir le rôle de l’épouse. Elle acquiesça en riant.
― Odo fit ce qu’il fallait pour engendrer ce fils, mais en vain !
La beauté ne porta pas d’enfant. Alors Odo lui donna le baiser de la mort !
Hissé sur la pointe des pieds, le nain embrassa voracement la femme dans le cou, puis la lâcha. Elle s’effondra à ses pieds comme une poupée de chiffon.
― Veuf, Odo se remaria. La nouvelle épousée faillit aussi à sa mission. Son ventre resta plat…
Le nain attira une autre invitée, une femme âgée et corpulente.
― Et Odo donna encore le baiser de la mort !
La femme tomba, mais le nain la retint de façon à amortir sa chute.
― Odo prit encore une épouse !
Une troisième dame s’effondra à ses pieds.
― Hélas, les compagnes se succédaient dans le lit d’Odo comme dans celui de Barbe-Bleue, et aucune ne lui donnait d’héritier. Il songea donc à sa propre fille.
L’assemblée autour du nain se mit à murmurer. Un homme se fraya un passage au milieu des hôtes et se plaça au premier rang. Il portait des vêtements noirs si près du corps qu’ils semblaient avoir été peints sur lui, révélant son impressionnante musculature.
Jordan ne se rendit compte qu’il se dirigeait vers elle qu’à la dernière seconde. Il s’immobilisa.
― Je suis américaine, souffla-t-elle en faisant un pas en arrière.
― Aucune importance, assura-t-il en tendant la main vers elle.
Elle secoua vigoureusement la tête. Elle ne voulait pas participer au jeu, seulement regarder.
― L’héritier qu’aucune n’avait été capable de concevoir, sa belle et glorieuse enfant allait le lui donner ! reprit le nain. Odo offrit son âme au diable. En échange, celui-ci devait trouver un géniteur qui engrosserait la demoiselle et accepterait de prendre le nom qui menaçait de tomber en désuétude. Ah, ah ! Que se passa-t-il ? Où se trouvait le diable ?
L’homme aux vêtements évoquant une seconde peau se mit à tourner autour de la terrasse, feignant de chercher le diable.
L’hilarité gagna les invités parmi lesquels il se faufilait. Les femmes gloussaient, les hommes riaient aux éclats…
Jordan ne voyait rien de comique dans cette situation… mais elle remarqua soudain le geyser couleur rubis qui jaillit au-dessus de la tête de l’une des femmes.
Non, pas au-dessus. À la place.
Et le liquide qui retombait en myriade de gouttelettes, c’était du sang !
Elle plaqua la main sur sa bouche, mais ne parvint pas à s’empêcher de hurler.
Le comparse du nain, l’homme à l’étrange tenue, se rua sur elle et l’agrippa par le poignet. Elle se débattit, hurla de plus belle, mais l’homme l’entraîna vers l’arrière de la terrasse. Terrorisée, elle s’imagina dans le noir à la merci de ce… ce quoi, mon Dieu ? Un assassin, un sadique ! Et il n’était pas seul ! Tout à coup, les invités se déchaînaient, glapissant comme des bêtes, s’agitant en tous sens, fauves hystériques, démons enragés…
Des capes se soulevaient, révélant des membres s’achevant sur des pattes griffues, les bouches grandes ouvertes montraient des crocs luisants de bave…
Elle ne voulait plus voir, et pourtant elle ne parvenait pas à détourner le regard. Une danse macabre, une orgie de violence, de sang…
L’homme se penchait sur elle, quand il disparut, comme soufflé par une rafale de vent.
Le Loup surgit devant Jordan. L’homme qui l’avait agressée protestait dans une langue inconnue et le Loup lui répondait.
Des sons chargés de haine et de fureur s’échappaient de sa gorge.
Puis l’homme le frappa. Le Loup riposta avec une effroyable férocité. Du tranchant de la main, il sectionna la tête de l’homme qui tomba sur sa poitrine. Le cou brisé, l’homme s’affaissa sur le dallage de la terrasse. Jordan recula jusqu’à la rambarde de pierre. Le palais était devenu une annexe de l’enfer. Des bêtes, des créatures dantesques surgissaient dans tous les coins. Toutes arboraient des crocs rouges de sang, et de l’écume rouge cernait leurs lèvres.
Tétanisée, Jordan se penchait en arrière, prête à sauter dans l’étroit canal, lorsque le Loup la prit par la taille et d’un bond la fit passer par-dessus la rambarde.
La jeune femme eut l’impression d’être avalée par un trou noir. La chute fut brève, et pourtant elle eut le temps de distinguer du brouillard autour d’elle. Puis ses pieds heurtèrent durement quelque chose. Sur quoi était-elle tombée ? Elle aurait pu se tuer… ou disparaître définitivement dans ce trou envahi de brouillard.
Elle se trouvait dans une barque.
― Rame ! Rame ! cria le Loup au batelier assis sur le banc. Vite !
Le batelier rama. La barque s’écarta de l’appontement et s’éloigna sur le canal. Le Loup sauta sur le quai, déclenchant un mouvement de balancier. Jordan s’accrocha au plat-bord et dirigea son regard sur le quai.
Le Loup avait disparu, comme absorbé par la brume.
Le premier, c’est l’instinct naturel, qui porte les deux sexes à s’unir, dans l’espoir de s’aider mutuellement, et de trouver dans cette réciprocité de secours plus de forces pour supporter les incommodités de la vie et les infirmités de la vieillesse.
Le second est le désir d’avoir des enfants, moins il est vrai pour laisser des héritiers de ses biens et de ses richesses, que pour donner à Dieu des serviteurs croyants et fidèles. Telle était, avant tout, l’intention des saints Patriarches de l’ancienne Loi, lorsqu’ils prenaient des épouses. Nos Saints Livres ne nous laissent aucun doute sur ce point. Et c’est pourquoi l’Ange Raphaël, apprenant à Tobie le moyen de se défendre contre les violences du démon, lui disait : « Je vous montrerai qui sont ceux sur qui le démon a de la puissance.
Ce sont ceux qui entrent dans le mariage, sans penser à Dieu et à son amour, uniquement pour satisfaire leurs passions, comme des animaux sans raison.
On doit considérer la sexualité d’un regard droit et franc, avec un œil pur et limpide : dans sa structure essentielle, elle est œuvre de Dieu. Ce regard simple et lumineux semble bien difficile à nos contemporains.
L’erreur janséniste a infecté les trois derniers siècles. Nous commençons seulement à nous dégager non de sa théologie, la chose est faite depuis longtemps grâce aux condamnations de l’Église au XVII e siècle, mais de son climat pessimiste et étroit.
Il est aisé de préciser en quoi consiste pour l’homme son bonheur : la jouissance, le plaisir et la joie, l’absence de toute souffrance physique ou morale, l’estime des autres, la réussite de ses entreprises, la réalisation de ses souhaits, l’affection dont il est l’objet, l’agrément de la vie sociale, l’aisance ou l’abondance de ses moyens financiers. Il n’a qu’un souhait : voir durer toujours cette condition heureuse.
Intentionnellement nous n’avons pas cherché à hiérarchiser moralement tous ces rêves de bonheur en lesquels se repose l’espoir humain. Ils jaillissent spontanément en nous au gré des incidents et des circonstances de la vie et chacun de nous en poursuit l’obtention.
La naissance de l'amour entre deux êtres constitue un événement mystérieux. Voici une ville de 100.000 habitants. Elle possède une jeunesse masculine et féminine de 20 à 25 ans d'environ 7.500 unités, soit 4.000 jeunes gens et 3.500 jeunes filles, puisque à cet âge, comme en font foi les statistiques, le pourcentage de population masculine dépasse encore sensiblement la féminine.
"C'est le monde à l'envers ! " me suis-je écrié, en recevant de Sylvie Simon la demande de rédiger une préface à son dernier ouvrage. Elle est connue d'un immense public d'amateurs éclairés, qui attendent avec impatience chacune de ses publications, alors que mes lecteurs ne dépassent guère le cercle encore très restreint des adeptes de l'homéopathie séquentielle.
Et encore un livre sur les vaccinations ! Elle en a écrit tant et tant ! Pourquoi cette redondance ?
Ce double étonnement s'évanouit dès la lecture des premières pages : le lecteur comprend bien vite qu'il ne s'agit pas ici de littérature. Sylvie Simon ne nous promène pas dans la fiction. Elle se meut sur un champ de bataille bien concret, dont elle connaît bien les mines et les barbelés. Elle n'a que faire des belles paroles de préfaciers courtisans. Elle demande de l'aide, et l'appui d'hommes de terrain. Car tout ce qu'elle écrit est vrai, mais seuls le savent ceux qui le vérifient dans la réalité.
Toutes ces années qu'elle a consacrées à promener sa plume alerte sur des milliers de pages, habile à dénoncer les plus criants méfaits de la médecine moderne, je les ai passées, en homme de terrain, à réparer les dégâts occasionnés par mes confrères bien intentionnés. L'enfer, dit-on, est pavé de bonnes intentions. Le geste médical le plus adulé et vanté, la vaccination, qui s'est mué de nos jours en survaccination, est de tous les actes médicaux celui qui mène le plus sûrement à l'enfer de la santé perdue.
Depuis plus de trente ans, je passe le plus clair de mon temps à tenter de rétablir l'équilibre énergétique gravement compromis de malades de tous âges, atteints des pathologies chroniques les plus diverses, et je puis assurer qu'aucun traitement ne rétablit la santé, tant que le carcan vaccinal n'a pas été pulvérisé. La vaccination est la plus grande imposture de toute l'histoire de la médecine, et, j'en suis convaincu, la plus nocive. Elle a méchamment saboté, à l'échelle planétaire, l'écologie ténue de l'infiniment petit qui établit l'harmonie à tous les étages de la vie.
— Monsieur le comte James de Torrington est appelé à la barre des témoins, annonça un huissier.
Une rumeur étouffée monta parmi la foule lorsqu'un homme grand et mince traversa la salle d'un pas déterminé.
Avec ses larges épaules, son allure de sportif et son air d'autorité naturelle, le comte en imposait tout de suite. Et comme il était séduisant avec son visage hâlé, son front haut, son nez légèrement aquilin, sa mâchoire volontaire et ses pénétrants yeux gris !
Après avoir vérifié son identité, le juge commença d'une voix monocorde :
— Jurez-vous de dire la vérité, toute la vérité... D'un geste machinal, le comte rejeta en arrière ses souples cheveux bruns avant de lever la main.
— Je le jure, déclara-t-il d'une voix timbrée.
Le silence s'était fait dans la salle. Personne ne voulait perdre une miette de cette audience. Ce n'était pas tous les jours qu'un aristocrate anglais se trouvait cité devant les tribunaux même à titre de témoin !
Une simple plaque sur la façade du carmel de Bethléem indique que Mariam Baouardy - soeur Marie de Jésus Crucifié - a fondé ce couvent, y est morte et a été béatifiée le 13 novembre 1983 par le bienheureux Jean-Paul II. Rien d'ostentatoire, une invitation à passer le portail pour découvrir ou plutôt rencontrer cette jeune Arabe chrétienne, témoin de l'humilité et de l'abandon confiant à l'Esprit Saint.
Ce que nous savons de Mariam nous a été transmis par ses soeurs carmélites et les lettres qu'elle a dictées à de nombreux correspondants. Sa vie spirituelle débordante et le déploiement du surnaturel ont parfois été un frein pour entrer dans le coeur de son message. A ne relever que cet aspect de sa vie, nous risquerions de rester sur le seuil et de ne pas entrer dans le coeur de son expérience spirituelle.
Nous proposons donc un parcours en quinze étapes à la rencontre de cette amie intime de l'Esprit Saint. Son humilité et sa spontanéité nous guideront sur ce chemin. Avec son coeur et son esprit d'Orientale, «le petit rien de Jésus», comme elle aimait à se nommer, nous invite à voyager en Terre Sainte et à y retrouver nos racines.
Ces racines sont vives et fécondes, elles ne sont pas seulement dans les livres d'histoire mais dans la présence des chrétiens en Orient. Mariam, jeune sainte de Galilée, est une soeur aînée pour les chrétiens vivant au Proche-Orient. Elle les encourage sur leur difficile chemin de fidélité à l'Évangile. Sa vie au carmel de Pau (France) la rend proche des chrétiens d'Occident. En offrant à l'Occident les richesses de la tradition orientale et en invitant les chrétiens occidentaux à soutenir leurs frères orientaux par la prière, elle est comme un pont entre l'Orient et l'Occident.
Cet itinéraire nous fera découvrir l'oeuvre de l'Esprit dans un coeur qui se laisse guider par lui et s'abandonne entre ses mains. Son aventure est éclairée par la tradition carmélitaine née sur les pentes du mont Carmel. Fondée sur l'oraison et la méditation silencieuse de la Parole de Dieu, à l'école de la Vierge Marie, cette tradition a rejoint les racines culturelles et spirituelles de Mariam. Prophète en son temps, elle a ouvert des voies sur lesquelles les croyants d'aujourd'hui peuvent s'engager avec confiance.
Son accent oriental se dévoilera à travers les images, les paraboles et la place importante donnée au surnaturel. Que cela ne déconcerte pas le lecteur occidental ! La Bible et les évangiles nous livrent en abondance des récits en forme de paraboles. Ils nous invitent ainsi à recevoir un enseignement où se croisent le coeur et l'esprit. Les Orientaux, familiers de ce mode d'expression, y puiseront une sève qui nourrira leur intelligence spirituelle et fortifiera leur fidélité au Christ.
Ces méditations sont offertes à tous ceux qui, en Orient et en Occident, veulent cheminer à l'école de l'Esprit Saint. Que Mariam accompagne chacun sur ce chemin de lumière !
La communauté dont on ne connaît pas le fondateur ! C'est ainsi que beaucoup désignent la Communauté de l'Emmanuel. Implantée sur les cinq continents, elle compte aujourd'hui 9 000 membres, dont 225 prêtres, une centaine de séminaristes et plusieurs évêques, anime 70 paroisses et de nombreuses initiatives apostoliques dans le monde.
Qui est donc ce fondateur qui a toujours préféré rester dans l'ombre plutôt que d'occuper le devant de la scène ? Prier 15 jours avec Pierre Goursat est l'occasion de présenter l'itinéraire humain et spirituel de cet humble laïc qui était à la fois un homme de prière et d'action, un contemplatif et un évangélisateur. Avant de fonder la Communauté de l'Emmanuel il y a quarante ans, Pierre Goursat a vécu une longue période de préparation intérieure, a travaillé comme critique de cinéma, a rencontré les personnalités les plus diverses.
Animé d'une grande charité, il était proche des petits et des pauvres. Embrasé d'un ardent zèle missionnaire, il a cherché à mettre en oeuvre les moyens adaptés à son époque pour annoncer à tous la Bonne Nouvelle, avec une attention particulière pour ceux qui ne connaissent pas le Christ ou sont éloignés de l'Église. Avec la créativité et la liberté que donne l'Esprit Saint, Pierre Goursat a suscité dans le sillage du concile Vatican II une nouvelle génération de laies et une forme nouvelle de prêtres diocésains, engagés avec des familles et des laïcs consacrés au service de l'Église et de la société.
Pierre Goursat a peu écrit, mis à part quelques articles publiés dans la revue II est vivant dont il fut le fondateur et le directeur de la rédaction à ses débuts. Il est par contre intervenu dans différents rassemblements du Renouveau charismatique et a donné de nombreux entretiens et conférences aux membres de la Communauté de l'Emmanuel dont il était soucieux de la formation pastorale et spirituelle.
Avec humour et simplicité, Pierre Goursat transmettait à ses auditeurs ses intuitions et le fruit de son expérience, leur communiquant la flamme qui l'habitait. Le plus souvent, il s'adressait à des personnes dont il était proche, parlant dans un style oral, direct, très familier, que nous avons voulu conserver. Les citations reproduites dans ce livre proviennent des archives de la Communauté de l'Emmanuel (parfois simplement appelée «la Communauté»).
Nous espérons que cet ouvrage permettra à un grand nombre de découvrir un chemin de vie chrétienne, profondément spirituel et incarné, accessible à tous, porteur d'un message actuel et original, enraciné dans la tradition de l'Église.
Dietrich Bonhoeffer est né à Breslau (aujourd'hui Wroclaw, en Pologne), le 4 février 1906. Son père, Karl Bonhoeffer, était professeur de psychiatrie et de neurologie, et sa mère, Paula von Hase, était issue de l'aristocratie. Dietrich et Sabine, sa soeur jumelle, sont les sixième et septième d'une famille de huit enfants. Plus tard, grâce au mari de Sabine, Gerhard Leibholz, d'origine juive, Bonhoeffer prendra conscience du sort fait aux Juifs en Allemagne, et il s'engagera en leur faveur.
En 1912, la famille Bonhoeffer déménage à Berlin. De 1923 à 1927, Dietrich fait des études de théologie à Tübingen, à Rome et à Berlin. Sa thèse de doctorat, Sanctorum communio, articule une analyse sociologique et une compréhension théologique de l'Eglise. En 1928, il accomplit une année de vicariat dans la paroisse allemande de Barcelone. Il s'y forme au travail de jeunesse ; ses succès témoignent de l'ascendant que, jusqu'à sa mort, il ne cessera d'exercer sur ses étudiants et ses jeunes collègues. Assistant à l'Université de Berlin en 1929-1930, BonhoefFer complète sa formation par une année d'études (1930-1931) aux États-Unis (Union Theological Seminary). Ce nouveau séjour à l'étranger contribue à l'ouverture d'esprit du jeune théologien allemand, marqué jusque-là par une certaine amertume envers le Traité de Versailles et la France : grâce à sa rencontre avec le pacifiste français Jean Lasserre, il surmonte sa rancoeur et affirme désormais l'unité (et l'unicité) du peuple chrétien, contre le «nationalisme» et la «haine de races ou de classes». (...)
La famille de Marillac occupe une place importante dans le Royaume de France. Guillaume, le grand-père de Louise, fut surintendant des finances. Son oncle et tuteur, Michel, deviendra le Garde des Sceaux sous Richelieu. Il en sera destitué après la journée des Dupes, dont il est l'un des principaux instigateurs avec son demi-frère le maréchal de Marillac.
Louise naît le 12 août 1591. Le nom de sa mère est inconnu. Son père Louis est veuf. Il épousera trois ans plus tard Antoinette Le Camus, veuve et mère de trois jeunes enfants.
Dès son plus jeune âge, l'enfant est confiée au monastère royal de Poissy, proche de Paris, où les religieuses dominicaines élèvent quelques filles de la noblesse. Louise y recevra une éducation tout à la fois spirituelle et humaniste : elle apprend à lire et à écrire, à connaître Dieu et à prier.
Vers l'âge de 12 ans, elle est placée dans un foyer de jeunes filles à Paris, tenu par une «maîtresse habile et vertueuse» (GO 7). Il est difficile de savoir qui a décidé du changement : est-ce son père en prise avec de graves difficultés financières, est-ce son tuteur, peu après la mort du père survenue en 1604 ? Le mode de vie est bien différent : ce foyer vit difficilement. Louise y découvre la pauvreté et apprend ce qui est nécessaire à toute femme pour tenir son ménage.
En 1606, Louise de Marillac participe à la longue procession qui conduit les religieuses capucines dans leur nouveau monastère, rue Saint-Honoré à Paris. En elle, surgit le désir de se consacrer à Dieu dans cette vie de pauvreté et de travail manuel. Comme toute fille au XVIIe siècle, elle ne peut décider seule de son choix de vie : elle doit obtenir l'autorisation de son tuteur. Michel de Marillac l'envoie au Provincial des capucins, le père de Champigny Celui-ci oppose un refus à sa demande, alléguant sa mauvaise santé. Il lui déclare : «Dieu a d'autres desseins sur vous» (GO 9). Le désarroi de la jeune fille est grand. Selon les coutumes du XVIIe siècle, son tuteur décide alors de la marier...
Précaires, Precarius, vous dis-je, obtenu par prière (T.I. 225).
Dieu est fort, on sait ça. Mais c'est comme s'il n'était pas fort. Dieu est faible dans le monde, voila le scandale qu'ils n'acceptent pas. Incapables d'être les témoins de la justice et de la tendresse car Dieu ne les possède pas eux-mêmes, ils utilisent tous leurs talents de metteurs en scène, de bricoleurs pour fabriquer des triomphes de pacotille (VI. 131).
Parfois quelqu'un pousse un cri : Dieu ! Mais Dieu n'est que dans le cri. Malheur à celui qui dit t'avoir rencontré ! Sa mort seule serait la preuve : la rupture avec l'ordre du malin, c'est-à-dire avec l'ordre de l'argent. Ainsi qu'une mère qui enfante signe son propre arrêt de mort, quiconque te fait naître en vérité marche vers son déclin. Ton irruption est à double sens : tu es l'inconnu, la fête et l'eue homo (M.B. 219).
Jean Sulivan ne paraît pas d'emblée un maître de prière. Comment écrire un ouvrage sur sa prière et se mettre à son école ? Prier ne semble en effet ni sa préoccupation personnelle ni le ton de ses écrits. Priait-il d'ailleurs ? Il s'est réalisé dans l'écriture et a, décidément, quitté la pratique pastorale usuelle. On le voyait, sur Rennes, davantage dans les lieux de conférences et dans les cinémas que dans les églises. Il paraît avoir, assez tôt, cessé de confesser, de célébrer, de prier peut-être ! Désormais, disait-il de son travail d'écriture : mes lecteurs, ma paroisse.
Il témoignait ainsi du même investissement radical que celui de son ami Henri Le Saux, quittant à 38 ans son rôle de cérémoniaire au monastère de Kergonan, dans lequel il s'était totalement investi, pour devenir moine mendiant et presque gyrovague, à l'école des sannyasins hindous. Il se rapproche encore des prêtres-ouvriers - il le fut quelques mois à l'usine Renault - dans leur désir d'aller se fondre dans l'expérience des hommes. Il porte en lui l'effort conscient de vivre une telle expérience, la volonté de se rendre fraternel, par une immersion en terre d'humanité. Lui, ce sera le continent de la littérature. Le cardinal Roques, son archevêque de Rennes, l'avait en quelque sorte détaché pour l'écriture, parce qu'il pressentait l'inquiétude et l'inassouvi d'une passion qui l'absorbait.
(...)
Passer quinze jours avec l'abbé Franz Stock, curé de la communauté allemande de Paris pendant la deuxième guerre mondiale, c'est découvrir et rencontrer un prêtre allemand qui, amené à devenir aumônier des prisons où étaient incarcérés des ennemis de son pays, nous livre dans la France occupée un témoignage de fraternité universelle. Il nous trace un chemin de paix et de réconciliation.
Franz Stock ne nous laisse pas un traité de spiritualité. En artiste qu'il est, en plus de quelques écrits où il livre l'essentiel de ses raisons de vivre et de témoigner, quelques tableaux et dessins nous disent que, pour lui, le Christ est le centre de sa vie et que le combat contre le mal est le lot de tout chrétien.
Franz nous laisse très peu d'écrits parce que, par tempérament, il n'aime pas étaler ses sentiments et, étant surveillé par la Gestapo dès son arrivée à Paris, il reste très prudent. Cependant, nous disposons de son précieux journal d'aumônier de prisons, dans lequel, jour après jour, avec une grande précision, il rend compte de ses visites aux résistants et des dernières paroles des fusillés qu'il accompagnait au supplice.
Comme il l'a appris de la bouche même de Romano Guardini, maître à penser de la jeunesse allemande des années vingt, les saints dont le monde a besoin aujourd'hui ne font pas des choses extraordinaires. Ils agissent. Ils témoignent dans leur vie quotidienne de manière évangélique. «Mes enfants, nous devons aimer, non pas avec des paroles et des discours, mais par des actes et en vérité» (1 Jn 3,11-21).
Une parole lui revenait sans cesse à l'esprit : «Là où tu es, fais ton devoir, joue le rôle qui t'attend, ne va pas chercher ailleurs, répond à l'appel de tes frères.»
Répondre à l'appel de ses frères, jusqu'à prendre de grands risques en communiquant aux familles de prisonniers, résistants ou otages, des nouvelles de leur mari, de leur père, de leur frère. Ce ne fut pas facile pour lui de transgresser la loi, de désobéir au règlement des prisons, de poser des actes de désobéissance. Cette consigne impérative, Streng verboten (strictement interdit), régnait partout dans la France occupée pour condamner tout acte de résistance, et pourtant, Franz l'a fait pour sauver des vies et donner la primauté à l'humain. Avant d'être allemand, il est prêtre du Christ. A sa manière, il résiste à un régime qui mettait à mal la dignité humaine. Attentif aux hommes, attentif aux événements, attentif à Dieu, il se laisse conduire par l'Esprit.
L'abbé Stock fut réaliste et inventif pour prendre sa part de «la grande oeuvre» à laquelle il s'est senti appelé : la réconciliation franco-allemande.
Dès 1926, il a voulu l'entreprendre, après la fameuse Rencontre européenne de jeunes à Bierville, «La Paix par la jeunesse», confirmée par son séjour en Corrèze dans une famille ouvrière et chrétienne, comme la sienne. Et, peut-être déjà avant, quand sa famille a subi, suite à la mobilisation de son père, les dures conséquences de la guerre 1914-1918. La Providence, le menant à Paris, allait lui permettre de consacrer sa vie à l'idéal entrevu et vécu dans l'enthousiasme de sa jeunesse.
Neuf grossesses l'avaient éreintée dans son corps et dans son âme. Lorsqu'elle parlait son visage devenait anguleux. Elle avait des mains petites et inertes, qui ne savaient pas tenir un bébé dans les bras pour le réconforter. Même ses cheveux avaient perdu toute viridité, sortes de fils de lin sans couleurs qui étaient au toucher comme le duvet des petits oiseaux de passage. J'aurais aimé caresser ces cheveux, mais elle ne me laissait pas faire. Elle disait qu'elle avait déjà assez donné. Elle éprouvait les mêmes ressentiments que peuvent nourrir certains travailleurs qui estiment qu'ils n'ont pas été payés suffisamment. Elle ne souriait jamais. D'ailleurs elle ne pleurait pas non plus, comme si elle avait avalé toutes ses larmes ou qu'elle les avait cousues sous sa peau, et ses yeux avaient bien du mal à s'ouvrir sous leurs membranes gonflées.
Mon père Hildebert de Bermersheim était une divinité tortueuse et distante.
Il possédait de nombreuses terres aux environs d'Alzen, dans le comté de Sponheim, mais sans avoir le titre de baron. Les barons le traitaient toutefois comme leur égal et enviaient ses chevaux provenant d'une race de Morée, et qui portaient une crinière cuivrée. Les cheveux de mon père étaient du même rouge que la terre de ses chevaux, et contrairement à ceux de ma mère, ils n'étaient pas encore blancs.
C'était un homme au tempérament sanguin, à l'humeur chaude et avide de vivre. Ma mère qui était, au contraire, mélancolique, au sang lent et muqueux, avait eu sur lui le même effet qu'un linge mouillé peut avoir sur la peau vive. Je les ai rarement vus ensemble. Mon père était occupé à la chasse et il parcourait ses terres en long et en large, en se faisant baiser le manteau par ses métayers. Il n'était pas orgueilleux, pourtant.
Il savait qu'au-dessus de lui se trouvaient le roi Henri, l'archevêque de Mayence et un Dieu dont il se sentait le sujet. Il ne connaissait ni le nombre ni le nom des serviteurs de sa maison.
Quant à la destinée de ses enfants, il considérait qu'il avait fait ce qu'il fallait : parmi ceux qui avaient survécu, l'un était chanoine à Mayence, un autre à Thaley, et l'une était moniale à Saint-Disibod.
Il aurait pu me trouver aussi une situation. Mais il n'aimait pas m'avoir dans ses pattes avec mon bavardage.
Peut-être parce qu'on lui avait dit que j'étais de constitution fragile et que je ne dépasserais probablement pas la pueritia. Mon père n'aimait pas les malades. Les blessés et les estropiés se tenaient loin de notre porte. C'est peut-être pour cela qu'il ne me regardait pas, mais on ne pouvait pas lui en tenir rigueur : quel adulte regarde les enfants ?
Un jour, pourtant, il fut pris de fièvre. Il s'agitait dans son lit comme s'il voulait attraper des mouches. Je le veillai durant ces jours-là, en lui baisant les mains et en caressant ses cheveux aux reflets cuivrés qui avaient une odeur différente de celle de ma mère ou de la nourrice. Comme si l'odeur de ce père me parlait d'un ailleurs que je ne connaissais pas, puisqu'on me gardait toujours enfermée à la maison à faire la malade, blottie au calme, à l'abri du sang.
À travers ses errances, ses doutes et les écueils rencontrés en chemin, Françoise Cambayrac nous fait partager tout ce qu’elle a appris de ces drôles de maladies nouvelles en recrudescence, ces maladies qui embarrassent tant le corps médical car elles n’ont pas de signature biologique et ne répondent à aucun traitement (fibromyalgie, fatigue chronique, spasmophilie, électrosensibilité, maladies auto-immunes, allergies, Alzheimer, autisme...). Leur explosion n’est pourtant pas due à la fatalité : leur cause, dans de nombreux cas, est une intoxication de l’organisme par le mercure contenu dans nos amalgames dentaires !
Vous verrez très clairement que des solutions existent, elles sont répertoriées et détaillées, et chacun peut les mettre en oeuvre. Ce magnifique bouquet de témoignages de personnes guéries en atteste, et permettra à tout lecteur de faire les bons choix.
Des millions de personnes souffrent aujourd'hui sans connaître la véritable cause de leurs maux. Les médecins, démunis devant l'absence de marqueurs connus et de réponses aux traitements classiques chez ces patients qui ne guérissent jamais, n'ont souvent d'autre issue que de conclure à des perturbations psychologiques. La tentation est grande de taxer ces malades d'hypochondrie, de les faire culpabiliser et de s'en débarrasser en les envoyant chez le psy.
Alors que des solutions médicales existent et que des guérisons sont possibles, le diagnostic même, qui permettrait d'identifier l'origine de la maladie, est ici tabou. Les médecins sont maintenus dans l'ignorance de ce qui, ailleurs (dans plus de trente pays), est parfois non seulement connu, mais reconnu, et véritablement soigné. Vous pensez sans doute que cela est impossible chez nous, dans un pays qui s'enorgueillit d'avoir aujourd'hui le meilleur système de santé du monde ?
C'est pourtant la vérité. J'ai rassemblé dans cet ouvrage les preuves scientifiques permettant de faire toute la lumière sur la question. Ces publications, écartées par nos experts français, sont reconnues par le reste de la communauté scientifique internationale et intéresseront tout le monde : professionnels de santé et patients confondus. Quel est donc le sujet de ces études, et la clé de ces maladies mystérieuses ?
Il s'agit de l'intoxication massive et chronique aux métaux lourds - et principalement au mercure - de millions de Français, mercure dont les sources de pollution sont diverses et ont de multiples conséquences gravissimes sur notre santé.
Comment se fait-il que les informations recensées ici ne soient pas enseignées à la faculté ? La toxicité du mercure est pourtant connue depuis l'Antiquité, de nombreux textes anciens y font référence.
Si j'ai pu écrire ce livre, démêler le vrai du faux et approfondir la question, c'est que j'y ai été initiée indirectement par un médecin français spécialisé en médecine environnementale, qui m'a soignée et guérie, avec une parfaite maîtrise du sujet. J'ai recueilli assidûment et passionnément les propos de ce chercheur d'exception en santé publique, hélas aujourd'hui disparu : le docteur Jean-Jacques Melet. Ce scientifique rigoureux et intègre n'a pas pu, de son vivant, faire entendre sa voix, l'establishment médical n'a eu de cesse de le réduire au silence et de le déconsidérer.
Il m'a semblé impossible, après sa mort, de ne pas communiquer publiquement ce qu'il m'a transmis sur la justesse de son combat et l'efficacité incontestable, preuves chiffrées à l'appui, de solutions thérapeutiques existantes, qui permettraient à une partie de la France malade d'aujourd'hui de redresser la tête. J'ai fait personnellement l'expérience d'une guérison acquise sur trois générations : une famille entière dont six malades. Comment supporter de voir se dégrader la santé de nos concitoyens et admettre que tant de vies basculent vers le drame quand on connaît les outils de diagnostic, les protocoles de guérison, les informations pour convaincre, et qu'on dispose de preuves irréfutables ?
Je ne suis pas scientifique, mais le présent ouvrage n'a pas été écrit à la légère et repose sur les bases fiables de travaux reconnus - articles parus dans des journaux scientifiques internationaux, expertises de l'INSERM, questions écrites de députés et de sénateurs français, rapports et avis officiels... Toute personne soucieuse de s'assurer de la véracité de mes propos pourra se reporter aux références citées en fin d'ouvrage.
Il faut soulever la lourde chape qui pèse sur le sujet et rendre accessible à tous l'ensemble des informations susceptibles d'améliorer la santé des millions d'intoxiqués. Voici les éléments décisifs qui vous permettront de vous forger une opinion.
Onguent à la rose : p147
"Dans 1/2 litre d'eau, faites infuser 20gr de pétales de rose et 5g de sauge.
Laissez réduire sur le feu sans bouillir.
Dans une autre casserole, faites fondre 20g de cire d'abeille dans 10g de saindoux, en mélangeant avec une cuillère en bois.
Retirez du feu.
Tout en mélangeant, ajoutez 12 cuillérées à soupe de l'infusion de rose et de sauge.
Tournez jusqu'à ce que le mélange, en refroidissant, fige et devienne onctueux.
Mettez dans un petit pot de verre.
Cette recette d'Hildegarde ( à conserver au réfrigérateur par précaution), soigne aussi les douleurs musculaires.
Le saindoux peut être remplacé par de la vaseline pour une meilleure conservation. "
Huile parfumée : p164
"Mélangez 5cl de jus d'aloès, 5cl d'huile (d'onagre ou de bourrache), 3 gouttes d'huile essentiele de lavande.
Massez la tête jusqu'au cou.
Gardez aussi longtemps que possible, par exemple la nuit en couvrant la tête avec un bonnet."
— J’ai quelque chose à vous demander, Silena, dit Andrew McRoss.
— De quoi s'agit-il? interrogea la jeune fille, tout en se disant que le jardin de cet hôtel particulier de Londres était très joli, ainsi illuminé.
On avait suspendu des lanternes chinoises de couleurs gaies dans les arbres et de grands flambeaux éclairaient les allées.
«C’est bien agréable de respirer l’air frais de la nuit, pensa-t-elle. Dans la salle de bal, il fait si chaud et il y a tant de monde... »
— Silena... reprit Andrew.
Et il s’interrompit. La jeune fille lui adressa un coup d’œil étonné et se dit qu’il semblait fort nerveux et la regardait de bien étrange manière.
— Oui, Andrew ? fit-elle avec patience. Que voulez-vous me demander ?
Quand elle s’assit sur un banc, il s'empressa de prendre place à ses côtés.
— Silena...
— Mais je vous écoute, Andrew !
Ce dernier prit une profonde inspiration avant de déclarer d’un trait :
— Voulez-vous m’épouser?
Le premier instant de stupeur passé, la jeune fille s’écria :
— Oh, non, Andrew! Je vous en prie, ne dites pas de bêtises pareilles !
— Ce n’est pas une bêtise ! protesta-t-il. Je voudrais vraiment que vous deveniez ma femme, ma chère Silena.
— Voyons, Andrew...
— Si vous acceptez, je vous promets que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous rendre heureuse.
- Partez, dit-elle. Immédiatement.
Au tribunal, son style concis, dénué de fioritures, en intimidait plus d'un. Scott ne se démonta pas pour si peu. L'artifice ne lui était pas inconnu ; sa tante Margaret - dite la Reine de Fer - l'utilisait couramment.
- Regardez par la fenêtre, répliqua-t-il.
La jeune femme prit une brève inspiration.
- Vous passez les bornes, monsieur Lyon.
- Je sais. Et j'insiste : regardez par la fenêtre, madame la juge.
Le regard perçant ne dévia pas.
Dans sa chambre, au premier étage, Nicki ferma la fenêtre pour s'isoler des rires et des clameurs sur fond de musique endiablée qui montaient du cabanon, situé pourtant à quelques centaines de mètres de là.
Chaque nuit ou presque, une fête animait cette cahute bâtie au bord de l'eau. Entre ses cinq cousins et les amis de passage... Chansons et bière glacée étaient alors de rigueur, mais en présence de T-John, l'ambiance grimpait d'un cran. T-John avait des histoires en réserve, et possédait la voix puissante qui convenait pour les raconter. Ce soir, la nuit serait plus folle encore que d'habitude. Plus longue aussi.


















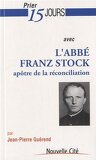






Sixième sens, cette fois-ci explore librement le registre de l'empathie et de la divination.