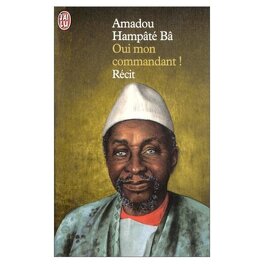Ajouter un extrait
Liste des extraits
Mon commandant, répondis-je, je suis profondément ému par la bonté de votre intention. Je sais que, si vous le voulez, vous pouvez me faire nommer chef de la province de Louta. Malheureusement, il m’est impossible de briguer cette place, et cela pour deux raisons. D’abord, l’ancien chef de la province, mon père adoptif Tidjani Amadou Ali Thiam, est encore vivant ; il réside chez moi, à Bandiagara. Je ne puis prendre sa place alors qu’il encore de ce monde et jamais le gouvernement de Haute-Volta ne consentira à lui redonner son poste. Ensuite, mon maître et père spirituel Tierno Bokar, de Bandiagara, m’a recommandé de servir les hommes avec dévouement, mais de ne pas chercher à les commander ; et je me suis promis de faire de son conseil ma devise.
Afficher en entierA partir de ce jour, les filles de Ouagadougou me laissèrent en paix. Pour elles, j’étais devenu un fonctionnaire pas tout à fait comme les autres : « le fonctionnaire marabout ». Plutôt que de me proposer leurs charmes, elles venaient me demander des prières ou des conseils. Je prenais très au sérieux cette qualité de marabout qu’on me prêtait, et que je préférais de beaucoup à celle de « commis expéditionnaire ». La preuve ? Je marchais, parlais, mangeais, regardais, riais et m’habillais comme je l’avais vu faire aux grands marabouts. En un mot, je les singeais avec beaucoup de sérieux et d’application. A l’époque, Tierno Bokar ne m’avait pas encore suffisamment pris en main ; je n’avais pas appris à faire la différence entre « paraître » et « être ».
Afficher en entierje vis ce qu’était devenue ma vie et j’eus honte de moi-même. Je constatai mon erreur avec lucidité et me condamnai sans faiblesse. « Je dois tenir mes engagements, me dis-je. Il me faut devenir un vrai musulman, et cesser de n’être qu’un musulman de naissance, un musulman par le nom et non par la conscience.
Afficher en entierA partir de Ouahigouya, je me sentis dépaysé. Je ne parlais pas le moré, la langue des Mossis. Quant à la langue peule, elle n'était pas courante dans le pays, et d'ailleurs pour rien au monde les Mossis n'acceptaient de s'en servir ; ils n'aimaient ni les Fulɓe, ni leur langue, ni leur lait sacro-saint, auquel ils préféraient de loin la bonne bière de mil appelée dolo. Pour les Mossis, un Pullo n'est pas un homme : c'est un singe rouge de la savane jaune. De leur côté, il faut le dire, les Fulɓe ne sont pas plus tendres à l'égard des Mossis qu'ils considèrent comme des orangs-outangs balafrés, malpropres et puant l'alcool, et dont le pays a souvent été considéré par eux comme une pépinière d'esclaves…
Sur le plan des relations individuelles, toutefois, ces appellations traditionnelles peuvent devenir un sujet de plaisanterie mutuelle et de moquerie amicale, comme on peut en rencontrer entre Fulɓe et Bambaras ou Fulɓe et Dogons.
Je pénétrais là vraiment en terre inconnue, sans soutien, loin des miens, et les paroles de M. Sinibaldi, qui m'avait dit à Bamako qu'il ne savait “à quelle sauce je serais mangé”, me revenaient en mémoire. Je chassai cette pensée angoissante et consacrai toute mon attention aux régions que nous traversions.
Parmi les étapes qui nous séparaient de Ouagadougou se trouvait Yako, chef-lieu d'une principauté qui, jadis, s'était glorieusement illustrée dans les annales des Etats mossis mais où, lors de notre passage, demeurait encore vivant le souvenir moins glorieux d'un féroce “surveillant des travaux publics” qui avait sévi à travers le pays. Il s'appelait Bara Dem, et c'était un Toucouleur venu du Sénégal dans les bagages des conquérants français. L'anecdote qui le concerne n'est pas sans intérêt dans la mesure ou elle illustre comment, à l'époque, étaient réalisés par la population certains grands travaux déclarés “d'intérêt général” pour le développement de la colonie, et comment certains Africains se firent parfois les instruments dévoués, voire cruels, de cette politique.
Bara Dem, cointne Alfa Maki Tall, chef des Toucouleurs de Bandiagara, s'était spécialisé dans la construction des routes et des ponts, mais avec une méthode de recrutement et de travail qui lui était toute particulière. Les grands travaux qu'il faisait exécuter nécessitaient une main-d'œuvre considérable, la plupart du temps réticente, qu'il n'hésitait pas à recruter par la force. Les Mossis refusaient de s'offrir sans résistance pour un travail qu'ils jugeaient dégradant et inutile. Pour eux, le conquérant blanc avait inventé ces histoires de routes larges de huit à douze coudées qu'il fallait ouvrir à travers la forêt, creuser dans la rocaille puis damer à la main pour en durcir la surface, uniquement pour tracasser le peuple et lui prouver sa vassalité. Les empereurs mossis et leurs dignitaires partageaient ce point de vue. Ils encourageaient en sous-main leurs sujets à saboter les travaux, et il n'était pas rare que les responsables des chantiers soient retrouvés empoisonnés ou descendus froidement par les habitants.
Bara Dem étant connu pour son courage mâle, sa force physique redoutable et son cœur sans pitié, l'autorité administrative coloniale du pays lui avait proposé les fonctions périlleuses de “surveillant des travaux publics”. Il accepta, mais sous trois conditions :
1. il recruterait lui-même de force tous les manœuvres dont il attrait besoin, avec droit de punir séance tenante toute résistance ou connivence de sabotage qu'il constaterait ou même soupçonnerait
2. il se ferait assister par dix hommes qu'il choisirait lui-même
3. lui et ses auxiliaires seraient armés et auraient le droit de faire usage de leurs armes pour se défendre légitimement.
C'était à prendre ou à laisser… Etant donné l'intérêt que représentait la réalisation de routes à travers les territoires, aussi bien pour le déplacement des représentants de l'autorité que pour l'acheminement de marchandises et des matières premières au profit des grosses sociétés commerciales françaises de la place, Bara Dem fut investi de tous les pouvoirs qu'il avait demandés.
De toutes les routes à créer, celle qui reliait Ouahigouya à Ouagadougou en passant par Yako était la plus urgente en raison d'un voyage envisagé par le gouverneur du Soudan, mais aussi la plus difficile à réaliser. Les habitants de Yako n'avaient jamais été des tendres. Ils refusèrent catégoriquement de livrer la main-d'œuvre et envoyèrent dire à Bara Dem de ne point s'aviser de venir à Yako pour quelque motif que ce soit, et surtout pour y créer une route fantaisiste dont ils n'avaient nul besoin. Les chemins exitants leur suffisaient.
Bara Dem porta le fait à la connaissance du commandant de cercle, puis, malgré la menace, il partit pour Yako. Là, installé dans le campement qu'il avait fait bâtir lui-même quelques mois auparavant, il fit convoquer le chef du village et les notables pour le lendemain matin à sept heures. A huit heures, personne ne s'était encore montré. Le message était clair.
Accompagné de ses dix gaillards armés de mousquetons à répétition, Bara Dem se rendit droit chez le chef du village. Celui-ci lui expliqua qu'il ne serait pas facile de trouver des manoeuvres, tous les jeunes gens de Yako s'étant enfuis dans les villages voisins. Bara Dem lui ordonna de l'accompagner au campement ou ils pourraient tous les deux étudier la question. Le chef tenta de regimber, mais Bara Dem, le regard menaçant, lui saisit le poignet et le serra d'une main de fer. Le chef comprit que le Toucouleur était homme à n'avoir besoin de personne pour venir à bout d'un adversaire, et que c'était un téméraire qui ne reculerait devant rien. Mieux valait composer avec lui. Il accepta de le suivre jusqu'au campement.
Ils étaient encore en route que déjà la nouvelle s'était répandue à travers la ville. De tous côtés les notables accouraient vers le campement pour assister leur chef. Quand ils furent assez nombreux, Bara Dem déclara :
— Le grand gouverneur du Soudan, qui réside sur la colline de Koulouba, au-dessus de Bamako, va venir visiter Ouahigouya, puis Ouagadougou. La grande route que nous ouvrons pour lui passe nécessairement par Yako.
Or, vous le savez, votre ville est située sur une élévation qui surplombe un vallon, lequel se transforme en une vaste mare pendant la saison d'hivernage. Il faudra donc réaliser une digue large et solide en travers du vallon. Pour ce travail, la province de Yako doit me fournir cinq cents manoeuvres et assurer quotidiennement leur nourriture.
Aucun de vous, y compris votre chef, ne quittera ce campement avant que les cinq cents manœuvres ne soient ici au complet. Faites transmettre des ordres en conséquence. Et celui d'entre vous qui essaiera de sortir pour rentrer chez lui, je le suspendrai à un piquet comme une vulgaire outre d'eau. Un notable de Yako, réputé pour ses fanfaronnades, s'écria :
— Est-ce que tu n'exagères pas un peu ? Comment pourrais-tu suspendre un homme comme une outre d'eau ?
Bara Dem éclata de rire :
— Je m'appelle Bara Dem, je suis toucouleur et j'appartiens à une ethnie guerrière. Or, les miens ont un principe, c'est de faire voir aux énergumènes de ton espèce exactement ce qu'ils demandent à voir. Tu veux voir comment on suspend un homme comnie une outre d'eau ? Très bien, tu l'auras voulu !
Bara Dem se saisit de la main droite du notable, la tordit et la lui renversa dans le dos. L'homme tenta de riposter en levant son bras gauche, mais Bara Dem s'en saisit et lui fit subir le même sort. Il lui ligota alors solidement les deux mains dans le dos, puis ordonna à l'un de ses auxiliaires de lui ligoter également les pieds. Quand le pauvre fanfaron fut ainsi pieds et poings liés, Bara Dem le fit suspendre horizontalement à une traverse posée sur deux grosses fourches fichées en terre, la corde de suspension passant dans son dos entre ses mains et ses pieds. Le malheureux, qui avait effectivement tout l'air d'une grosse outre d'eau suspendue, devait souffrir horriblement, les bras ainsi tirés en arrière sous le poids du corps.
— Faites feu sur quiconque tenterait de le délivrer ordonna Bara Dem à ses hommes.
Ce spectacle donna froid dans le dos à tous ceux qui nourrissaient encore quelque velléité de résistance ou qui envisageaient de saboter la réalisation de la digue. La sécurité des leurs était en jeu, et à quel prix ! Bara Dem laissa le pauvre notable suspendu jusqu'au moment où, n'en pouvant plus, il demanda pardon et jura de l'aider à réaliser ses travaux. Ce traitement brutal équivalait, jadis, à une éloquente mise en garde : il signifiait que le détenteur de l'autorité ne souffrirait aucune contradiction. Le message fut entendu.
Bara Dem était considéré, dans tout le pays, comme la terreur même. Tous les chefs, y compris le grand Moro Naba de Ouagadougou, redoutaient cet homme, qui, certes, réussissait à faire construire des routes, des ponts et des campements, mais pour qui la vie d'un Mossi ne valait pas plus que celle d'un poulet…
Le sort voulut que Bara Dem connut une mort atroce, dans des circonstances assez stupides. Alors qu'il était à cheval, il se pencha en avant pour réajuster la fixation de son chasse-mouche ; mais tandis qu'il était penché l'animal releva brusquement la tête, lui donnant sur le front un coup d'une violence telle qu'il lui en ouvrit la boîte crânienne. Son agonie fut longue et très pénible.
L'histoire ne dit pas ce qu'en pensèrent les populations voltaïques, qui virent tant des leurs arrachés de force à leur famille ou à leur champ pour des corvées dont ils ne comprenaient pas la raison, on envoyés en masse dans des pays limitrophes au climat humide pour y réaliser des travaux gigantesques, dont la plupart ne revenaient pas…
Afficher en entierLe lendemain matin, notre convoi s'ébranla en direction du bourg de Bango, nouveau chef-lieu de la province des Djalloubés dirigé par l'oncle de Lolo, le chef Boukari Salihou. L'étape suivante était Ouahigouya, chef-lieu de la circonscription administrative du Yatenga, ville importante où cohabitaient et le commandant de cercle représentant l'autorité française, et le “Yatenga Naaba”, empereur mossi du pays de Yatenga.
Dès notre arrivée à Ouahigouya, après avoir déposé nos bagages dans le campement, j'accompagnai les deux sergents jusqu'à la résidence du cercle où nous devions faire viser nos papiers et demander le renouvellement de nos porteurs. Ceux-ci devaient en effet retourner à Bandiagara où ils avaient été, selon l'usage, réquisitionnés d'office au titre des “prestations de travail obligatoires”, et de ce fait obligés d'abandonner qui son petit commerce, qui la récolte de son champ ou ses obligations familiales.
Dans le bureau du cercle, je fis la connaissance du “grand interprète” du commandant, un Pullo du Wassoulou qui s'appelait Moro Sidibé et qui, apparemment, méritait bien son titre : il mesurait au moins deux mètres de haut et sa corpulence était impressionnante ! En tant que compatriote, il me proposa très cordialement de venir prendre mes repas chez lui durant nos deux jours d'arrêt. Comme tous les anciens tirailleurs, il parlait ce français pittoresque et imagé que nous appelions “forofifon naspa”, mais en fulfulde et en bambara sa langue était irréprochable. La cour de sa concession était aussi achalandée que celle de l'empereur, et chaque soir s'y tenait une grande séance de musique et de causerie où conteurs et traditionalistes rivalisaient de connaissances. Accompagnés par d'éminents guitaristes, ils narraient à tour de rôle ce qu'ils avaient appris des anciens.
De tous ceux qui venaient égayer la cour de Moro Sidibé, Sidi — de la caste des cordonniers — était le plus versé dans l'histoire du Yatenga. Il connaissait sur le bout des doigts la remarquable organisation administrative de l'empire avant la pénétration française. Voyant mon intérêt pour ces questions, Moro Sidibé organisa en mon honneur pour le lendemain une soirée récréative où il ne convoqua que Sidi et deux guitaristes, afin que nous ne soyons pas gênés par le bruit et que nous puissions écouter Sidi tout à notre aise.
J'arrivai vers vingt heures. Moro Sidibé était encore dans les appartements de ses épouses. On m'introduisit dans une petite cour privée de la concession. Deux très belles jeunes filles étaient en train d'y étaler des nattes de style haoussa. Je pris place dans une chaise longue préparée à mon intention, mais je n'eus pas longtemps à attendre. Bientôt mon hôte apparut, tout habillé de blanc, haut comme un pilier et épais comme un taurillon. La croix de la Légion d'honneur accrochée à sa poitrine donnait a sa tenue, en ce lieu privé, un aspect solennel qui me laissait rêveur. Majestueux, il avançait vers moi à pas lents. Je me levai. Il me serra la main en souriant très largement et prit place dans sa chaise longue.
— Assieds-toi, me dit-il, nous allons dîner. Nos convives attendent dans la grande cour que nous ayons fini notre repas.
Il agita une petite clochette. Aussitôt les deux jeunes filles réapparurent, apportant de quoi nous laver les mains. Puis ce fut un défilé des plats les plus variés. Nous n'étions que deux, mais il y avait à manger pour dix…
C'était bien africain. Le dîner terminé, quand les jeunes filles eurent débarrassé nos nattes, Moro Sidibé fit introduire Sidi et ses deux guitaristes qui attendaient dans la grande cour. Après les salutations d'usage, Sidi et ses compagnons prirent place sur une grande natte qui nous faisait face. Les deux guitaristes commencèrent par accorder leurs instruments, puis, comme le voulait la coutume, ils jouèrent en l'honneur des Fulɓe l'air traditionnel njaru que tout griot musicien doit à un Pullo lorsqu'il lui rend visite, comme une sorte de tribut.
Pendant que les guitaristes jouaient, Sidi se recueillait, cherchant visiblement dans les archives de sa mémoire quel récit en extraire pour nous le rapporter. Moro Sidibé le tira d'embarras :
— O Sidi ! Raconte-nous donc comment fut fondé l'empire du Yatenga.
Tout heureux, mis à son aise, Sidi commença :
— O Sidibé ! En Afrique, parler d'un pays sans parler de son chef, ou parler d'un homme sans parler de ses ascendants, c'est commettre une bévue impardonnable. De même que l'arbre doit sa force et son envergure à ses racines, l'homme doit d'être ce qu'il est à sa naissance, c'est-à-dire aux germes qui lui viennent de ses parents. Quant au pays, il doit sa paix et sa prospérité à l'intelligence et à la bonne administration de son chef.
Je m'en vais donc conter pour vous ce que mon père me conta en me disant l'avoir appris de son propre père, qui avait connu l'empereur Naaba Kango et avait vécu à sa cour. Comme dit l'adage : « J'ai entendu » est plus proche de l'erreur que « j'ai vécu ». Voici donc le récit que je dois à mon père…
Il nous conta alors l'histoire très ancienne d'une princesse amazone mossi qu'un jour son cheval emporta ventre à terre jusqu'au cœur d'une profonde forêt où vivait un chasseur solitaire, qui n'était autre qu'un prince malinké (ou mande) en exil. Il nous conta comment l'amour, qui n'obéit à aucune loi et que rien ne peut expliquer, s'empara du cœur des deux jeunes gens et comment vint au monde l'enfant que l'on nomma Ouëdraogo (“cheval mâle”) en mémoire de l'étalon fougueux qui avait amené sa maman jusque devant la hutte de son futur papa. Ses descendants allaient devenir les empereurs des divers Etats du grand pays mossi. Ya-Diga serait le vrai fondateur de l'empire de Ouahigouya, auquel il donna le nom de Yatenga [manyaare].
Voulant en savoir davantage sur l'organisation traditionnelle du pays, je lui demandai comment l'empire du Yatenga était administré.
— L'empire, me répondit-il, était, et est toujours, administré selon une stricte hiérarchie dont les niveaux sont superposés comme dans une maison à étages, et que l'on retrouve dans tous les autres empires frères, y compris celui du grand Moro Naba de Ouagadougou.
Au sommet, à l'étage supérieur, trône l'empereur ; à Ouahigouya, c'est le Moro Naba Yatenga.
A l'étage suivant, on trouve les grands dignitaires du palais qui siègent au Conseil de l'empire en présence du Moro Naba. Ce sont :
• le Baloum Naba, maître du palais, introducteur des visiteurs et plaignants de toutes sortes ; les pages, les palefreniers, les femmes et les eunuques de l'empereur relèvent de son autorité
• le Togou Naba, porte-voix de l'empereur, qui répète à voix haute ce que l'empereur dit tout bas ; il administre les villages relevant directement de l'empereur et donne l'investiture au successeur de celui-ci
• le Ouidi Naba, chef de la cavalerie ; il gouverne les villages commandés par les fils de l'empereur et les provinces peules de l'empire
• le Rassoum Naba, qui gouverne le trésor impérial, les prisons et les exécuteurs des hautes œuvres
• le Diaka Naba, gardien des amulettes impériales, sacrificateur aux dieux et aux mânes des ancêtres, qui a pour coadjuteur le Yaogo Naba, gardien des sépulcres et musées impériaux
• le Samandee Naba, coadjuteur du Rassoum Naba, qui commande aux fantassins.
Voilà les six grands dignitaires du palais. Indépendamment des visites de déférence qu'ils rendent assez souvent à l'empereur, ils ont chacun un jour de permanence complet par semaine pour traiter avec lui des affaires de leurs départements respectifs.
Au troisième étage viennent les dignitaires de l'Etat :
• le Soloum Naba, chef des provinces
• le Tenga Naba, chef des villages
• le Bagaré Naba, chef des captifs et responsable du cheptel royal
• le Saga Naba, chef des forgerons et des artisans
• le Tenga Soba, chef de la terre (ou « maître de la terre » traditionnel), véritable représentant des populations et dont l'avis est toujours prédominant.
Un système de transmission des nouvelles par réseaux de tam-tams permet à l'autorité centrale de communiquer rapidement avec les villages environnants et les régions.
Enfin, tout en bas de l'édifice, vient le peuple qu'on piétine et qu'on pressure mais que l'on ne peut empêcher de chanter, de danser et de juger ses chefs !
Après cette véhémente tirade, Sidi leva soudain ses bras qu'il étira au-dessus de sa tête. il entrelaça ses doigts, poussa un gémissement de grande lassitude et dit :
— O, Moro, du clan des Sidibé ! Tes griots ont sommeil. Ils voudraient que tu leur donnes la route.
Je plongeai ma main dans ma poche afin de lui donner quelque chose. Moro Sidibé saisit mon bras :
— Laisse, dit-il, tu es mon invité. C'est à moi de donner les cadeaux d'usage.
Il distribua entre Sidi et ses compagnons quinze francs, trois gros moutons de case et trois boubous. Tout le monde était content, et moi plus encore ! Car non seulement j'avais beaucoup appris sur ce pays nouveau pour moi, mais le geste de Moro Sidibé me mettait à l'aise : ce que j'avais eu l'intention de donner aux griots eût été bien dérisoire, en effet, par rapport aux cadeaux du grand interprète !…
Je ne pouvais imaginer cette nuit-là que lorsque, en 1928, je retrouverais mon “oncle Wangrin”, il me raconterait en long et en large l'histoire rocambolesque de ses démêlés avec ce même “grand interprète”, et que ce dernier me confierait à son tour, lors de mon retour à Ouahigouya en 1932, sa propre version des événements.
Pour l'heure, tout heureux de ma soirée, je pris congé de Moro en le remerciant chaleureusement de son accueil.
Le lendemain matin, mes compagnons et moi repremous la route. A raison d'environ vingt-cinq kilomètres par jour sauf le dimanche, consacré au repos et à la distraction, nous comptions mettre une huitaine de jours pour arriver à Ouagadougou, terme de notre voyage.
Afficher en entierLe sixième matin après notre départ de Bandiagara, quelques kilomètres après Tou, notre route pénétra dans un vallonnement où du fourrage poussait en abondance. De grands troupeaux s'y déplaçaient, conduits par de jeunes bergers fulɓe au teint cuivré, musclés comme des athlètes et armés comme des combattants. Ils chantaient des poèmes bucoliques célébrant les beautés de la nature ou les exploits de leurs anciens, ces marcheurs infatigables venus d'on ne savait où et qui, à la tête de leurs troupeaux, s'enfonçaient vers on ne savait quoi pourvu qu'il y ait de l'eau, de l'herbe et pas de mouches !
A l'extrémité du vallonnement se dressait une petite colline que la route devait franchir, heureusement en pente assez douce. De l'autre côté, dans la plaine, s'étendait une grosse bourgade où se côtoyaient des maisons à terrasses en pisé de style dit “soudanais” et des huttes rondes ou cylindriques surmontées de toitures coniques, dans une anarchie architecturale qui n'était pas dépourvue de charme. C'était la ville de Tiw, ancien chef-lieu de la province des Fulɓe diallouɓe au sein du royaume mossi du Yatenga.
Cette ville entra dans l'histoire à partir de 1880, année où, à la surprise de tous, elle infligea une cruelle défaite à l'armée toucouleure qui avait été envoyée par Tidjani Tall, neveu d'El Hadj Omar et premier roi de Bandiagara, pour conquérir l'empire du Yatenga.
Depuis l'occupation française, un très grand chef pullo, Djibril Mamadou Ala-Atchi, avait développé l'économie de son pays en encourageant l'élevage et l'agriculture. A sa mort, survenue quelques années auparavant, il avait laissé un cheptel estimé a plus de deux cent mille têtes de bétail — on n'avait jamais réussi à les dénombrer exactement. Mais j'aurai à reparler de lui.
Notre caravane, conduite par le sergent Autexier, traversait lentement la ville, accueillie par les aboiements peu hospitaliers des chiens de garde. Les hommes, eux, nous saluaient respectueusement, tandis que les femmes poussaient des youyou stridents et que les enfants, piaillant d'excitation, gambadaient et sautaient autour de nous comme un troupeau de cabris.
C'est précédés, suivis et flanqués des deux côtés par les gamins du village que nous arrivâmes au campement de Tiw. Devant la grande porte d'entrée, notre garde d'honneur enfantine se dispersa comme une volée de moineaux. Ce campement était le plus beau le plus vaste et le mieux entretenu de tous ceux où nous avions séjourné jusqu'alors. Les deux sergents allèrent occuper deux cases jumelées par un grand hangar ou les porteurs déposèrent leurs bagages. Le cuisinier alla inspecter son domaine. Quant à moi, bien que “non blanc” de toute évidence, je me permis d'aller m'installer dans l'une des autres cases jumelées du même camp.
Une file de jeunes femmes s'approcha. Elles portaient des calebasses emplies de nourritures de toutes sortes, des canaris d'eau fraîche, des chasse-mouches, des nattes et des coussins. Elles déposèrent le tout devant les cases occupées par les deux sergents. L'homme qui les escortait vint me demander d'aller présenter aux Blancs ces cadeaux de bienvenue que leur offrait son maître le prince Lolo, fils ainé du grand chef défunt Djibril Mamadou Ala-Atchi. Cet homme, qui s'appelait Goffo, était lui-même un dimaajo, c'est-à-dire un “captif de case” pullo, ou serviteur attaché à une famille depuis des générations. Il était “grand captif”, c'est-à-dire le chef de tous les captifs attachés à la famille du prince Lolo et qui constituaient à la fois un corps de serviteurs et une sorte de garde d'honneur.
Accompagné de Goffo, je me rendis auprès du sergent Autexier et lui fis part du message de bienvenue du prince.
— Eh bien, s'exclama Autexier, on est fantastique ici ! Nos souhaits sont exaucés avant mêtue d'avoir été formulés. Fais dire au prince que nous le remercions et que nous serions heureux de le rencontrer.
Avant même que je ne commence à traduire, Goffo ajouta :
— Le prince est en train de prendre son bain. Dès qu'il aura fini, il viendra se présenter.
Je transmis la nouvelle au sergent.
En attendant, les nattes, canaris d'eau, coussins et chassemouches furent répartis entre nos cases par les porteurs, qui allèrent ensuite s'installer dans le campement réservé aux indigènes, alors élégamment appelé “campement des bougnoules”. Quant au cuisinier, après avoir récupéré la nourriture, il alla camper dans la case-cuisine. Les paleffeniers, eux, restèrent auprès des chevaux dans le hangar-écurie.
Une demi-heure plus tard, un nuage de poussière s'éleva en tourbillon au-dessus de la route. Le martèlement des tam-tams se fit entendre, accompagné de chants modules sur divers thèmes traditionnels. C'était le prince Lolo qui arrivait, entouré par ses courtisans et ses griots, tous à cheval, et suivi par une garde aussi armée que pour aller à l'attaque d'une fortification ennemie. Quand le cortège ne fut plus qu'à une vingtaine de mètres, je distinguai le prince Lolo. Il montait un superbe cheval blanc, nerveux, frémissant, dont le harnachement de cuir brodé était de fabrication marocaine, et les étriers en argent. Le prince lui-même portait des bottes européennes qui rehaussaient encore la beauté de sa tenue africaine. Son turban n'avait pas le volume excessif des turbans haoussas ; de proportions harmonieuses, il faisait penser aux turbans des lanciers hindous bengalis, que j'avais vus dans des illustrations.
Comme je devais l'apprendre un peu Plus tard, le prince Lolo, avant la mort de son père le chef Djibril, avait fait la guerre en France de 1916 à 1918. Il en était revenu avec le grade de sergent-chef (du corps indigène, cela va sans dire) et trois belles médailles qu'il portait présentement sur sa poitrine : la médaille militaire, la Croix de guerre à deux palmes et la médaille de sauvetage.
Le cortège entra bruyainment dans le campement. Des coups de fusil tirés à blanc crépitèrent. Tous les cavaliers mirent pied à terre, sauf Lolo qui resta en selle. Cette attitude m'intrigua. J'interrogeai Goffo, qui était resté auprès de moi :
— Pourquoi le prince reste-t-il à cheval ?
— O mon maître Amadou ! Comme dit l'adage : Si tu trouves un jour une belle génisse abandonnée par des Fulɓe dans un vieux parc, ne t'en empare pas, ce ne peut être qu'une guignarde.
Je ne saurais te dire pourquoi mon maître Lolo reste en selle. Sans doute ne le sait-il pas luimême… Je restai sur ces paroles énigmatiques.
Les sergents Autexier et Mayclaire s'avancèrent vers le prince. Quand ils furent à quelques inètres de son cheval, Lolo se mit à crier comme un fou : “Gaaarde-à-vous !” Et aussitôt il se dressa sur ses étriers, raide, la tête haute, le bras droit relevé et les doigts de la main appliqués sur sa tempe droite, en un impeccable salut militaire !… Les deux sergents, médusés, ne savaient que dire. Lolo restait figé sur ses étriers comme une statue de bronze, les yeux fixés sur on ne savait quel horizon… Le silence commençant à devenir gênant, l'un des compagnons du prince s'écria en français d'une voix puissante :
— Sergent-chef de l'infanterie Lolo Djibril Mamadou Ala-Atchi… Repos !
Comme par magie, le prince revint a une position normale. Il reprit en main les rênes qu'il avait abandonnées pour saluer, manœuvra son cheval et lui fit exécuter avec une habileté consommée une série de mouvements combinés : sauts de mouton, voltes et virevoltes. Il termina son exhibition en faisant s'incliner sa monture sur ses pattes avant en une courbette d'une élégance qui m'arracha un cri d'admiration. Quel cavalier c'était ! je devais d'ailleurs apprendre par la suite que le prince était cité parmi les meilleurs cavaliers de toute la Haute-Volta, qui en comptait des milliers !
Les captifs et les griots poussèrent un chœur d'exclamations louangeuses. Trois d'entre eux allèrent se placer à côté du cheval, toujours incliné sur ses pattes avant. D'un habile maniement des rênes conjugué avec de discrets mouvements de pied, Lolo redressa son cheval. Puis, à notre stupéfaction, tel un parfait voltigeur il sauta de sa selle pour aller retomber dans les bras tendus des trois hommes. Ceux-ci le portèrent en triomphe, et passant devant nous à vive allure, allèrent le déposer sous le hangar qui réunissait les cases des deux sergents. Abasourdis, nous fîmes demi-tour pour rejoindre le hangar où Lolo, déjà princièrement installé dans une chaise longue apportée par son porte-siège, nous attendait. Les rôles étaient renversés. C'était maintenant Lolo qui, sous leur propre hangar, allait recevoir les deux sergents…
Pendant que nous avancions vers le hangar, Goffo, regardant son maître avec tristesse, me dit en fulfulde :
— Crois-tu, ô mon maître Amadou, qu'un prince digne de ce nom se permettrait de telles acrobaties ? Si elles prouvent de façon éclatante les qualités équestres de mon maître, elles n'honorent pas le turban de dauphin du trône des Djallouɓe. Un prince se doit d'être réservé. Or mon maître Lolo ne l'est pas, et de plus il est intempérant ; tu t'en rendras compte avant de quitter la ville. C'est d'ailleurs son manque de sérieux qui l'a empêché d'être intronisé à la place de père.
Je ne savais que dire à un homme qui portait un jugement si sévère sur son prince que par ailleurs, j'en étais sûr, il était prêt à défendre au prix de sa vie. J'gnorais encore que Lolo était coutumier de ce genre de fantaisies, et que l'abus des boissons alcoolisées y était pour quelque chose. Nous étions arrivés sous le hangar. Le prince, sans se lever de sa chaise, s'adressa à moi en fulfulde :
— O fils de mon père ! Dis aux deux fils de la grande France pour laquelle j'ai versé mon sang et ma sueur comme si elle était le pays des Djallouɓe eux-mêmes qu'ils sont les bienvenus. J'ai ici pour eux nourriture, boissons, poitrines fermes et fesses souples et arrondies. Ils ne manqueront de rien. Et s'ils veulent se baigner dans du lait, je ferai venir autant de vaches laitières qu'il en faudra pour les satisfaire. Je vais d'ailleurs faire immoler en leur honneur cinq bœufs de dix ans et cinq gros moutons de case, afin que tout le monde se régale !
Je traduisis son discours aux deux sergents, qui n'en croyaient pas leurs oreilles…
— Eh ben mon colon ! s'exclama Autexier. Viens, Mayclaire. Nous n'avons plus qu'à nous asseoir et à écouter ce phénomène de l'hospitalité africaine !
On nous avança trois coussins, et nous prîmes place en face du prince. Autexier ine chargea de le remercier de sa générosité, clé le féliciter pour son art équestre et de lui dire qu'il était digne d'aller disputer leur prix aux cadets de l'Ecole de Saumur en France. Lolo éclata de rire, et répondit directement en français :
— En 1917, j'ai passé une permission de détente de quinze jours à Saumur. J'y ai vu les élèves de la cavalerie. Ils sont très forts, et montent de très beaux chevaux de grande taille. J'avais pensé en ramener un à Tiw pour la reproduction, mais personne ne m'a pris au sérieux ; mon capitaine m'a même interdit d'en parler! Mais c'est à Saumur que j'ai bu le meilleur champagne…
Sans transition, Lolo demanda aux deux sous-officiers s'ils avaient apporté avec eux des liqueurs fortes. Il était prêt à les leur payer le prix qu'ils en voudraient.
— Nous ne sommes pas des commerçants, répondit le sergent Autexier, mais nous pouvons néanmoins te servir un très bon vin.— Je préférerais un verre de Pernod-Fils, de Berger oLi de bitter, dit Lolo. Le vin est une boisson pour les femmes et les garçonnets. Moi, je suis un poilu qui connaît les talus et les tranchées de France !
Il secoua son boubou et fit tinter ses trois médailles, qu'il désigna du doigt une à une :
— O pièces frappées pour glorifier ceux qui savent charger sans peur les colonnes ennemies ou recevoir sans broncher la charge de leurs baïonnettes ! Vous ne tinterez jamais sur la poitrine des couards qui pissent de terreur quand les canons font entendre leur tonnerre, ou quand les mitrailleuses égrènent leur chapelet dont chaque grain petit vous donner la mort !
Autexier fit sortir de la caisse à provisions un litre de Pernod-Fils et trois verres. Il y versa la liqueur pure à peine étendue d'eau, tendit un verre au prince, l'autre au sergent Mayclaire et prit le troisième. Tous trois levèrent le coude en criant :
— A votre santé !
Après une seule gorgée, les deux Français déposèrent leur verre sur le sol. Lolo vida le sien d'un trait, rota bruyamment et le tendit à Autexier en disant :
— Encore, sergent ! Encore de cette femme verte dont le parfum enivre même celui qui attrait perdu son odorat le jour de sa naissance ! Verses-en, oui, verses-en beaucoup dans mon verre ! Oh, je sais, les marabouts me reprochent ma pratique alcoolique… Ils ignorent que cela me permet de noyer les soucis que l'injustice a semés dans ma tête, d'où leurs prières n'ont pas su les extirper !
Autexier versa dans le verre une bonne rasade d'alcool, y ajouta de l'eau et le tendit au prince. Celui-ci l'avala d'un coup, puis se leva et lança d'une voix forte :
— Vive l'absinthe ! A bas la loi qui en interdit la vente ! Et gloire aux contrebandiers qui nous procurent Pernod-Fils, rhum et bitter ! Allons, sergent, encore un verre !
Cette fois-ci Autexier augmenta la proportion d'eau, tout en glissant à l'oreille de Mayclaire “Si avec ça le mec tient encore debout, alors chapeau Nous saurons à qui nous avons affaire !” Lolo vida son verre, puis retomba assis dans sa chaise longue. Sa tête tomba lourdement sur sa poitrine. Au bout d'un moment, Autexier le crut terrassé par l'alcool :
— Ça y est ! L'animal a son compte !
Lolo se secoua, leva brusquement la tête et éclata de rire :
— Non, sergent, je n'ai pas encore inon compte ! Je l'auria quand ce qui reste de ta pauvre bouteille sera transvasé dans la cuvette de mon estomac ! Allez, encore une rasade, et cette fois-ci verse plus d'alcool que d'eau, cette boisson faite pour les poissons et les grenouilles ! …
— Ça suffit comme ça ! l'arrêta Autexier.
Complètement ivre, Lolo se mit à chanter la Madelon, à la manière pittoresque des tirailleurs indigènes qui avaient ramené en Afrique la chanson mascotte des poilus de 14-18… Il fallut toute l'autorité affectueuse de Goffo pour nous débarrasser de ce prince à la fois généreux et pitoyable.
Pourquoi Lolo, dauphin d'une des plus grandes provinces de la Haute-Volta, qui avait hérité d'un cheptel si vaste que personne ne pouvait en dénombrer les têtes, dont le palais regorgeait d'or, d'argent, de caisses d'ambre pur et de coraux de première qualité, et qui avait à son service plus de mille captifs prêts à mourir pour lui, était-il devenu une telle épave humaine ? C'était une longue histoire que Goffo, le chef de ses captifs, me conta en pleurant, et que je rapporte ici parce qu'elle apporte des lumières nouvelles sur un épisode rocambolesque de la vie de “Wangrin” que j'ai raconté dans mon livre l'Etrange Destin de Wangrin, au chapitre intitulé “La mort d'un grand chef et ce qui s'ensuivit”. Il va sans dire qu'à l'époque où se situe le présent épisode, n'ayant pas encore retrouvé Wangrin, j'ignorais tout de cette histoire. Voici ce que me conta Goffo :
— En tant que fils aîné, Lolo aurait dû être intronisé à la place de son père. C'est d'ailleurs en tant que dauphin que ce dernier l'offrit en 1916 au gouvernement français pour aider la France à se défendre contre les troupes du roi Guillaume II qui l'avaient attaquée. Lolo se conduisit à la guerre de manière à ne faire honte ni à son père ni aux Fulɓe du monde entier ! Il se battit si vaillamment qu'il obtint le grade de sergent-chef et trois grandes médailles de preux. Hélas, il n'apprit pas seulement à faire la guerre, il apprit également a fréquenter les maisonnettes où boivent les Blancs, et à boire comme eux. Mais avec sa manie de vouloir toujours briller plus que les autres, il se mit à boire plus que les Blancs les plus buveurs. Il oublia Allâh, il oublia Mohammad… Il cessa d'être musulman et se convertit avec fougue à la religion de l'alcool. Un camarade du beuverie lui apprit un jour le nom du dieu qui souffle l'ivresse dans le coeur des hommes. Il s'est converti à ce dieu. Et c'est ainsi que Lolo nous revint le cœur vidé d'Allah et empli ce l'esprit de « Bakisso » (Bacchus), le dieu de l'ivrognerie.
Malgré sa brillante conduite à la guerre et ses titres de gloire, son comportement attrista son père. Tous deux s'éloignèrent l'un de l'autre. Les marabouts et les notables manquèrent à leur devoir en laissant empirer une situation qui mettait tout le monde mal à l'aise sous le ciel des Djallouɓe.
Le prince fonda alors une association de jeunes buveurs composée de quarante-cinq vauriens. Il leur donna a chacun un cheval et une tenue similaire, une lance solide, un casse-tête et un sabre tranchant. Leur groupe commença à sillonner le pays en se livrant à des séances de beuverie dans tous les villages où se tenaient des foires hebdomadaires. En l'espace de dix mois, Lolo avait épuisé l'immense fortune que son père et ses oncles maternels lui avaient donnée. Pour continuer d'entretenir les membres de son association, il contracta d'énormes dettes. Ses créanciers, fatigués d'attendre, allèrent trouver son père. Celui-ci régla tout le monde, mais pour y parvenir il dut vendre deux cent vingt taureaux, cinquante génisses et dix kilos d'or.
Le même mois, rongé de chagrin, le chef Djibril tomba malade. Sa maladie fut de courte durée. Il mourut sans que son fils ait changé de conduite ni demandé son pardon. Lolo passa ainsi à côté de la chance qu'il ne rattraperait jamais plus. Malheur de malheur !…
En évoquant la triste mort du chef Djibril qu'il aimait comme un fils, le pauvre Goffo pleurait à chaudes larmes.
— A la mort du chef Djibril, continua-t-il, Lolo hérita d'une partie de ses biens et ambitionna d'occuper sa place. Mais il avait compté sans les intrigues de son oncle paternel Boukari Salihou, puîné de son père, et surtout il n'avait pas mesuré l'impopularité de sa conduite auprès des anciens et des marabouts. Pour évincer Lolo du turban de Tiw, son oncle Boukari Salihou acheta très cher la connivence de « Wangrin », le grand interprète du commandant de cercle, qui était venu représenter ce dernier aux funérailles du chef Djibril. Lolo fût donc frustré du commandement, et peu s'en fallut qu'il ne fût obligé de céder à son oncle la fortune laissée par son défunt père !…
(Goffo cita Wangrin, bien sûr, sous son véritable nom. C'était la première fois que j'entendais parler de lui depuis mon entrée en Haute-Volta ; cela me donna l'espoir de le retrouver un jour dans une ville ou une autre du pays, car depuis mon enfance à Bandiagara, je le considérais toujours comme “mon oncle”.)
Quand Goffo eut terminé son récit, je me demandai en mon for intérieur si l'éventualité qu'il venait d'évoquer pour le prince n'aurait pas été préférable pour toute la famille du défunt, car Lolo était visiblement en train de dilapider l'immense fortune dont il avait hérité. Je ne lui donnais pas deux ans pour tout engloutir dans la boisson et les excentricités dont il avait fait sa raison de vivre.
A ce moment, Goffo gémit doucement comme un chien malade. Il prit congé de moi et rentra au village. Il était vingt-trois heures passées lorsque je regagnai ma couchette ; mais je ne pus m'endormir avant des heures, retournant cette histoire dans ma tête et méditant sur les méfaits de la boisson. Je ne me doutais pas que six ans plus tard, en 1928, je retrouverais “Wangrin”, l'interprète responsable de l'éviction de Lolo, et qu'entre autres histoires il me conterait en détail les péripéties mouvementées de cette mémorable succession, et comment il avait réussi à se sortir a son avantage de l'intrigue la plus “carabinée” qu'il ait jamais montée dans sa carrière, pourtant fertile en “wangrineries” de toutes sortes !
Afficher en entierLe lendemain matin de bonne heure, je me rends au Cercle pour signaler que mes affaires sont réglées et que je suis prêt à quitter Bandiagara le jour même. Le grand interprète m'introduit dans le bureau du commandant où se trouvent déjà deux sous-officiers français, les sergents Autexier et Mayclaire ; j'apprends que nous allons voyager ensemble jusqu'à Ouagadougou.
— Alors! fait le commandant. La fiancée est-elle trouvée ?— Oui mon commandant !
Le plus beau est que je ne mens pas. Quatre jours après mon arrivée, mes fiançailles avec ma cousine Baya Diallo, qui se trouve présentement dans une autre région et que je n'ai pas revue depuis près de six ans, ont effectivement été “nouées” par les représentants de nos deux familles.
Notre départ a lieu deux heures plus tard. Les deux sergents, qui ont eu droit chacun à un cheval et à huit porteurs, sont accompagnés d'un cuisinier, de deux palefreniers et d'un petit boy. Je les suis à pied, après avoir confié ma malle à l'un de leurs porteurs. Notre convoi, fort de vingt-trois personnes et de deux chevaux, quitte Bandiagara pour Kanikombolé, première grande étape sur la route de Ouagadougou. Jusqu'alors, j'avais voyagé en terrain de connaissance ; chaque pouce du chemin parcouru évoquait le souvenir des expériences, heureuses ou dramatiques, qui avaient façonné mon enfance et mon adolescence. A partir de maintenant, je tourne le dos au pays natal pour m'enfoncer vers le sud-est, vers un pays inconnu où m'attend, loin des miens, une carrière incertaine.
Quelques kilomètres après le village de Diombolo, nous commençons à gravir la pente de la grande colline de Kani. La falaise est recouverte d'arbres fruitiers sauvages d'un vert chatoyant. Les strates pierreuses superposées qui la constituent, et dont le soleil avive encore les différentes nuances de couleur, lui donnent, de loin, l'aspect de grandes maisons étagées entre terre et ciel.
La route qui serpente en épousant les méandres de la colline est due, comme la digue de Mopti-Seeware dont j'ai parlé précédemment, au génie constructif d'Alfa Maki Tall, fils du défunt roi Aguibou Tall. La gravir jusqu'au sommet ne se fait pas sans peine ; mais là, comme pour nous récompenser de tous nos efforts, un tableau grandiose et sauvage s'offre à notre vue. Alors que, sur son versant nord, la colline s'élève plus ou moins progressivement, ici, côté sud, elle s'interrompt abruptement, comme taillée par un gigantesque et grossier coup de hache, et tombe en un à-pic de plus de cent mètres de hauteur. Cette véritable muraille de pierres domine une plaine sablonneuse vaste comme un océan, parsemée de loin en loin par des arbres dont les dômes arrondis ressemblent, vus d'en haut, à des îles vertes serties dans l'immensité des sables jaunes.
Après avoir rassasié nos yeux de ce tableau, nous nous préparons à la descente, qui s'annonce périlleuse. Le chemin est étroit. Le moindre faux pas risque d'envoyer dans le ravin hommes, bêtes et bagages. Un guide, placé là en permanence par les autorités afin d'aider les voyageurs, vient nous proposer ses services.
— En route ! s'écrie-t-il.
Et il prend les devants, suivi des deux palefreniers qui tiennent les chevaux par la bride ; viennent ensuite les seize porteurs, le cuisinier, le boy, moi-même, et les deux sergents blancs qui ferment la marche. Notre file indienne attaque la descente, réglant sa marche sur celle du guide. Il nous faut près de trois heures pour venir à bout du sentier de trois kilomètres qui se faufile à travers les failles de la falaise.
De retour sur le terrain plat, une petite halte nous permet de nous détendre et de faire souffler nos chevaux avant de prendre le chemin qui mène au campement administratif du village de Kanikombolé. Ce village présente la particularité d'être construit à l'intérieur d'une immense caverne ouverte comme une bouche dans le flanc de la montagne, et dont la lèvre supérieure pétrifiée avance si loin vers l'avant que les cases n'ont pas besoin de toiture pour se garantir des pluies. On l'appelle d'ailleurs “le village dont les maisons n'ont qu'une seule toiture”.
A l'entrée du campement, le guide prend congé de nous en nous promettant d'aller aviser le chef de village de notre arrivée. Celui-ci se présente peu après, accompagné de quelques notables. Il nous souhaite la bienvenue et demande ce que nous attendons de lui. Je traduis ses propos à mes compagnons.
Le sergent Autexier, plus ancien dans le grade que le sergent Mayclaire, est en fait le véritable chef du convoi. Il me demande de continuer de lui servir d'interprète auprès du chef de village :
— Dis-lui de nous faire envoyer deux petites poules, des œufs, du lait, du beurre de vache, du bois de cuisine, du fourrage et un panier de mil pour deux chevaux, et de la nourriture pour les vingt et un indigènes de ma caravane.
Je transmets sa commande.
— Et toi, interprète, que désires-tu ? me demande le chef.
— Je te laisse le choix de ce que tu feras préparer pour moi.
Le chef nous quitte et retourne au village. Un peu plus tard, il nous fait envoyer tout ce que le sergent a commandé, à l'exception du repas des hommes qu'il promet de nous faire servir vers vingt heures.
Pendant que le cuisinier prépare le dîner des deux sergents, Autexier m'appelle :
— Amadou Ba ! Mon ami et moi t'invitons à dîner.
Je ne m'y attendais nullement, car manger à la table d'un Blanc était, à l'époque, une chose impensable pour un nègre. Cela m'était déjà arrive une fois en 1915 à bord du vapeur Le Mage, dans des circonstances exceptionnelles que j'ai racontées précédemment, et j'en avais gardé un souvenir très flatteur ; mais je m'imaginais pas que cela pût se renouveler un jour.
Nous bavardons un moment, puis le cuisinier vient préparer la table. Il s'empare d'une vieille caisse qui a servi au transport de bouteilles d'alcool, la renverse, la recouvre d'une pièce de toile en guise de nappe et y place trois assiettes en fer-blanc, trois verres et trois couverts des plus ordinaires.
— A table ! crie le sergent Autexier.
Nous nous asseyons tous les trois sur le sol autour de notre table improvisée, à laquelle il ne manque que des pieds…
Le cuisinier pose cérémonieusement devant nous trois bouteilles de vin rouge et un pot à eau. Il prend une serviette, la jette sur son bras gauche replié en équerre, puis sort de la case et se dirige cérémonieusement vers le coin cuisine cri criant :
— La suite !, ce qui a le don de déclencher notre fou rire.
Il faut savoir en effet que, dans les premiers bâtiments coloniaux, la cuisine était toujours construite à quinze ou vingt mètres de la maison d'habitation où se trouvait la salle à manger des Blancs. Le boy qui venait de servir le premier plat à ses patrons sortait du bâtiment en criant “la suite !” afin de prévenir le cuisinier qu'il venait chercher le deuxième plat. Ce cri était pour ainsi dire entré dans les usages domestiques. Notre hilarité ne troubla nullement notre cuisinier qui, ce jour-là comme tous les autres jours, ne manqua jamais, a chaque repas, de sortir de la case en se criant imperturbablement à lui-même : “La Suite !”
Le dîner fut fort gai. Je quittai mes compagnons assez tard et me dirigeai machinalement vers un coin du campement où nos porteurs venaient d'organiser une danse. Soudain je m'entendis appeler : “Interprète ! Interprète !”
Je me retournai. C'était le chef de village et quelques notables qui venaient me voir. Je les conduisis jusqu'à ma case où ma chaise longue m'attendait. Ils s'installèrent autour de moi.
— Interprète ! dit le chef, nous sommes venus te remercier de ta bonne entremise, car sans elle les deux militaires nous auraient sûrement rendu la vie impossible, comme l'ont fait les trois caporaux blancs qui ont transité par ici le mois dernier. Nous avons vu que tu n'avais pas de cheval. Demain, nous t'en prêterons un pour aller jusqu'à Kri, l'un des derniers villages du territoire avant la Haute-Volta. Le palefrenier nous le ramènera. Un interprète comme toi ne doit pas marcher à pied !
J'essayai de les convaincre que je n'étais nullement intervenu auprès de mes compagnons blancs en leur faveur, mais en pure perte. Ils restèrent persuadés de me devoir la modération des demandes du sergent Autexier. Sans doute la nourriture de vingt-trois personnes au pied levé leur paraissait-elle une vétille à côté de ce que l'on exigeait habituellement d'eux ? Nous bavardâmes un bon moment, puis ils s'en retournèrent.
Le lendemain matin, avant le lever du soleil, le chef était devant ma case. Un joli cheval harnaché attendait dans la cour, tenu par un jeune palefrenier qui portait en bandoulière un sac en peau de bouc. Je ne pouvais dominer ma joie à l'idée que je n'aurais pas à marcher à pied pour franchir la longue plaine sablonneuse. Je n'avais pas fini de remercier le chef de son obligeance que retentit le coup de sifflet du sergent Atitexier. C'était le signal du départ. Les porteurs se précipitèrent sur les bagages, et les palefreniers amenèrent les chevaux. Le chef de village avança vers les deux sous-officiers, son bonnet à la main. Il les salua et, par mon intermédiaire, les remercia d'avoir honoré son village de leur “présence française”…
— Dis donc, Amadou ! s'écria le sergent Mayclaire. Tu as maintenant un cheval, à ce que je vois !
— Est-ce que le commandant de Bandiagara ne nous a pas dit qu'Amadou était un prince de je ne sais quel foutu patelin ? ajouta Autexier. Il faut bien qu'on lui évite de « faire son pied la route »!
Il éclata de rire.
— Allez, à cheval ! Et urge …
Chacun de nous serra à tour de rôle la main du chef, puis nous montâmes en selle et le convoi prit la route de Bankassi, notre prochaine halte réglementaire.
Au temps de l'empire toucouleur, la ville de Bankassi, située à la fourche des routes qui mènent l'une à Ouahigouya en pays mossi, l'autre à Louta en pays samo (l'ancienne province jadis commandée par mon père adoptif Tidjani Thiam avant sa destitution), était un chef-lieu de région militaire. Nous y arrivâmes vers treize heures. Comme il se devait, notre convoi se dirigea vers le campement réservé aux Européens. Lorsqu'il s'agissait d'un gros bourg situé au bord d'une route importante, il y avait en général deux campements : un pour les indigènes et un autre pour les Blancs, ouvert exceptionnellement aux fonctionnaires africains.
Les chefs des communautés toucouleure et dogon de la ville, accompagnés chacun d'une délégation, vinrent nous saluer et nous offrir leurs services. Mes deux compagnons, qui étaient des hommes mesurés, n'exigèrent rien de plus que ce qu'ils avaient demandé à Kanikombolé.
Quant à moi, jugeant que le village de Kri était encore trop éloigné pour garder plus longtemps le cheval qui m'avait été si aimablement prêté à Kanikombolé, je le libérai et le rendis à son palefrenier, auquel je donnai cinq cents cauris — ces petits coquillages blancs décoratifs qui servaient encore de monnaie à l'époque. Chez les Toucouleurs de Bankassi, j'étais comme en famille ; je demandai donc à leur chef de prévoir pour moi un autre cheval, que je lui renverrais ultérieurement.
Ainsi, sur ce long voyage de près de mille kilomètres que le gouverneur en colère m'avait au début imposé de faire à pied, en fait, après le trajet accompli en pirogue, je n'avais marché que pendant environ deux cents kilomètres : de Mopti à Kanikombolé. J'en avais fait bien plus dans mon enfance ! Finalement, je ne m'en tirais pas si mal…
Après Bankassi nous campâmes tour à tour à Kro et à Kri, deux gros villages qui étaient des hauts lieux de la tradition dogon, puis à Tou, dernier village du territoire du Soudan français avant la Haute-Volta, où l'on parlait le dogon et le moré, langue des Mossi, l'une des principales ethnies de ce territoire.
Afficher en entierAu même moment, la recommandation que ma mère m'avait faite lors de notre séparation à Koulikoro me revint en mémoire, et me causa un choc : “Avant toute chose, dès que tu seras à Bandiagara, va voir Tierno Bokar !”
Or je n'en avais rien fait. Très mal à mon aise, je rentrai à la maison et réfléchis.
En tant que chef d'association, me dis-je, j'ai beaucoup d'obligations et d'amusements en perspective. Si je vais voir Tierno maintenant, il va me parler de prières, de “ne fais pas ceci !”, et “ne fais pas cela !”… Cela m'ennuyait un peu d'aller le voir — j'étais un jeune fonctionnaire, je prenais mes airs… — mais cela m'ennuyait encore plus de ne pas y aller. Une idée lumineuse me vint à l'esprit : “Puisque Tierno Bokar est, comme on dit, la “lessive des âmes”, mieux vaut que je me consacre à mes obligations pendant toute cette semaine et que faille le voir la veille de mon départ. Je quitterai ainsi Bandiagara bien propre et bien lavé…” Je fixai mon départ au lundi matin suivant.
Durant toute la semaine, ce fût un tourbillon d'invitations, d'expéditions avec mes anciens camarades, de courses de chevaux, de séances de guitaristes et de visites de courtoisie galante aux jeunes femmes qui avaient été les “Vailentines” de notre association, aujourd'hui toutes mariées et souvent mères de famille, mais dont, jadis, nous avions chante la beauté et pour qui nous avions livré des combats mémorables !
La journée du dimanche se passa à prendre congé de mes parents et amis. Après la tombée du jour, je demandai à mon ami d'enfance le griot Mouktar Kaawu (l'ancien porte-parole de notre association), de m'accompagner chez Tierno Bokar, dont l'école coranique était toujours, à Bandiagara, un foyer de haute spiritualité.
Mouktar Kaou se montra réticent. Les jeunes gens de Bandiagara, dont la religion n'était pas la première préoccupation, évitaient en général d'aller chez le saint homme.
— On ne va pas chez Tierno Bokar comme on va aux bains, me dit-il. Cet homme lit dans les cœurs, on ne peut rien lui cacher. Dès que tu t'assois devant lui, il voit toutes tes fautes. Je ne tiens pas du tout à ce qu'il me révèle les miennes !
— Ma mère veut que j'aille voir Tierno Bokar, je n'ai plus que cette nuit pour le faire et nous le ferons ensemble ! Allez, va t'habiller et viens. Et tant mieux si Tierno Bokar voit jusque dans l'appendice de nos intestins !
En tant que griot et ancien camarade d'association, Mouktar ne pouvait refuser. Il partit changer de tenue. A son retour, j'étais prêt. Je portais un boubou lustré teint à l'incligo, une culotte bouffante blanche, une belle paire de chaussures de Djenné et une petite calotte blanche “mode Tidjani”. Suivi d'un Mouktar à la mine boudeuse, je me dirigeai vers le quartier haoussa où se trouvait la maison de Tierno Bokar.
A notre arrivée, il est près de neuf heures. La cour est vide. Tierno a déjà regagné ses appartements, et les élèves leurs dortoirs. Nous restons quelques instants dans le vestibule, ne sachant que faire. Une petite fille de la maison âgée d'environ cinq ans, la petite Gaboulé, nous a entendus parler. Elle vient vers nous :
— Qu'est-ce que vous faites là ? Papa Mosquée 17 est déjà rentré dans la case de tante Néné. Revenez demain matin, vous pourrez déjeuner avec Papa Mosquée. Vous savez, dans sa bouillie du matin, on met du sucre ! Allez, partez, partez !
— Ma petite Gaboulé, écoute-moi. Va trouver Papa Mosquée, et dis-lui que son fils Amkoullel est là et demande à le voir.
— C'est toi Amkoullel ?
— Oui, c'est moi. Tiens, voici une pièce de cinq centimes pour t'acheter demain du jus de jujube. Maintenant, va vite !
La fillette s'élance en criant à tue-tête :
— Amkoullel est arrivé ! Amkoullel est arrivé ! Il est dans le vestibule !
Alerté par ses cris, Tierno sort de sa case et s'avance vers nous, le visage rayonnant. Mon esprit sort comme d'une brume. Comment ai-je pu ne pas me précipiter vers lui dès mon retour ! Il me prend dans ses bras, me serre sur son cœur et m'embrasse, ce qui n'est pas courant en Afrique. Puis il salue Mouktar et lui serre la main. Il ne cesse de répéter la formule rituelle de salutation :
— Bissimillâhi ! Bissimillâhi !Au nom de Dieu ! Bienvenue ! Soyez à l'aise !
Il nous amène sous l'auvent qui abrite le devant de la case de tante Néné, son épouse. En passant à côté de la case de sa mère, il l'appelle :
— Ayya ! Ton petit-fils Amkoullel est là !
A peine somnes-nous installés que la vieille Ayya, douce et sainte femme qui fût la grand-mère de tous les enfants de l'école, vient nous souhaiter la bienvenue. Après les questions d'usage sur mes parents, mon voyage, ma santé… elle me donne sa bénédiction, que je reçois avec émotion. Puis elle prend congé de nous, non sans m'avoir encore souhaité un bon voyage, une carrière réussie et une longévité heureuse !
Tierno Bokar se tourne alors vers moi. Il me regarde et se met à rire silencieusement, si fort que ses épaules en sont toutes secouées :
— Eh bien, Amadou ! dit-il enfin. Voilà une semaine que tu es là, et c'est seulement ce soir, la veille de ton départ, que tu as songé à venir me voir ?
Plein de confusion, je baisse les yeux :
— Oui Tierno…
— Non, pas d'explications ! je ne veux pas que tu mentes. Tu n'as pas de justification. Et tu n'as pas suivi les conseils que ta maman a dû te donner.
Ça y est! me dis-je. Non seulement il lit dans les cœurs, mais maintenant il lit à distance. Comment peut-il savoir ce que ma mère m'a dit dit a Koulikoro ? Mouktar a bien raison, on ne lutter avec un tel homme. Le plus sage est de lui dire toute la vérité :
— Tierno, tu as raison. Ma mère m'avait bien recommandé de venir te voir dès mon arrivée à Bandiagara, mais mes amis se sont si bien emparés de moi qu'au début j'ai oublié les paroles de ma mère. Après, quand je m'en suis souvenu, j'ai décidé de me distraire d'abord et de te réserver ma dernière visite, afin que tu laves mon âme avant mon départ et que tes conseils restent gravés dans mon esprit et dans mon coeur.
Tierno Bokar sourit :
— Et qu'a dit ta mère à mon intention ?
— Elle a dit : “Tu réserveras ta première visite à Tierno Bokar et tu lui diras ceci de ma part : ta petite sœur, ma mère, me commande de venir me remettre entre les mains de Dieu par ton entremise.
— Ah ! s'exclame-t-il, voilà bien le langage de ma petite sœur bien-aimée et bénie Kadidja Pâté !
Il me fait alors asseoir en face de lui, et garde un long moment les yeux fixés sur moi. “Voilà! me dis-je. Il est en train de scruter mon intérieur.” Quant à Mouktar Kaawu, il se tient coi et se fait tout petit dans un coin, comme s'il voulait se faire oublier.
Je ne sais comment je trouve le courage de soutenir le regard du maître :
— Tierno, lui dis-je, je viens me remettre entre les mains de Dieu par ton entremise.
Il pousse un soupir heureux :
— Que Dieu t'entende ! Et qu'il nous agrée tous ensemble !
Son expression se fait alors plus grave :
— Ecoute, Amadou ! Maintenant tu n'es plus un enfant, il faut que nous parlions d'homme à homme.
Il se tourne vers Mouktar :
— Mouktar Kaawu ! J'aurais souhaité qu'Amadou vienne tout seul, mais Dieu en a décidé autrement. Ce que je vais dire, je le dis à moi-même, chez moi, et uniquement pour Amadou. Je ne te demande pas de nous laisser seuls, mais je veux que mes paroles ne sortent pas d'ici.
— Je promets que je n'en dirai rien à personne ! assure Mouktar.
— Bien ! fait Tierno.
Il me regarde à nouveau. Je me sens comme saisi par quelque chose de puissant. Tout mon être est suspendu, en attente de je ne sais quoi.
— Es-tu en état de pureté rituelle ? me demande-t-il.
— Non, Tierno!
Je suis un peu vexé, car j'aurais dû penser à faire mes ablutions avant de venir chez cet homme si méticuleux en matière de religion. Il me montre une bouilloire emplie d'eau et je vais prendre mes ablutions dans le coin de la cour réservé à cet usage. Mouktar en fait autant, puis nous revenons nous asseoir sous l'auvent.
Tierno est assis en face de moi.
— Celui qui veut se convertir à Dieu, dit-il, comme celui qui veut lui confier les secrets de son cœur, s'y prépare en se purifiant par les ablutions rituelles. Tu viens de le faire correctement, j'en suis content.
Il s'adresse à moi comme si Mouktar n'existait pas.
— Amadou ! dit-il, Tu sais que dans cette vie d'ici-bas, que tu en prennes un petit peu, tu lâcheras ! Que tu en prennes plein les mains, tu lâcheras ! Cette vie s'appelle “lâcher” ! Alors, il ne faudrait pas attendre le jour où la vieillesse arrive, quand le pied ne peut plus se lever, que l'œil ne voit plus clair et que la bouche n'a plus de dents, pour revenir à Dieu. Dieu Lui aussi aime les belles fleurs. Si l'on attend d'avoir dépassé l'âge mûr pour revenir à Lui, ce n'est pas un homme qui revient, mais un impuissant. Bien souvent, d'ailleurs, on ne le fait que par crainte de la mort et de l'enfer ; mais il ne faut pas adorer Dieu par peur de l'enfer ou désir du paradis, il faut l'adorer pour Lui-même.
Maintenant, Amadou, apprends que la meilleure partie du corps pour suspendre l'or, c'est le lobe de l'oreille. Or, l'or que je possède, je ne vois pas d'oreille ou le suspendre mieux qu'à la tienne. Avec ton défunt frère Hammadoun et la petite Dikoré, vous avez été le premier foyer de cette école, les trois pierres sur lesquelles on pose la marmite pour nourrir la famille. Alors aujourd'hui, Amadou, je voudrais que tu te convertisses à l'Islam.
Sur ces mots il se tait, comme attendant une réponse.
— Mais, Tierno, je suis déjà musulman !
— Non ! Tu es né musulman, mais cela ne suffit pas pour l'être vraiment. Chaque être humain devrait pouvoir, à sa majorité, se décider en pleine conscience. Maintenant que tu vas partir pour Ouagadougou pour y mener ta vie d'homme, moi je te propose l'Islam. A toi de réfléchir. Si tu veux suivre cette voie, je continuerai à t'aider, je t'enverrai des lettres. Et si tu veux en suivre une autre, je prierai pour que Dieu t'aide…
Il se tait à nouveau, son regard toujours posé sur moi.
— Tierno, lui dis-je, je choisis la voie du l'Islam.
Il se penche vers moi :
— Donne-moi tes mains.
Je les lui tends, paumes ouvertes vers le haut, dans la position de celui qui reçoit.
— Chaque personne née musulmane,devrait, à l'âge adulte, se convertir à Dieu de son plein gré en prononçant la Shahâda, la double formule de profession de foi, comme si c'était la première fois.v Il me fait alors réciter la Shahâda : Lâ ilâha ill'Allâhu Mohammadu rasûl-Allâh. Il n'y a de dieu que Dieu, et Mohammad est l'Envoyé de Dieu.
— O Dieu ! dit-il. Accepte Amadou, et nous avec lui, parmi les tiens et les compagnons de ton saint Envoyé Mohammad — que le Salut et la paix soient sur lui !
Puis, posant ses doigts sur mes mains ouvertes, il récite la Fatiha, première sourate du Coran, et l'oraison tidjanienne consacrée au Prophète appelée Salâtul fâtihi. A la fin il dit :
— Amin !
Et, dans le geste traditionnel de réceptivité après une prière ou une bénédiction, passe ses mains en descendant,sur son visage, puis sur sa poitrine. J'en fais autant.
Après un moinent de recueillement, il rompt le silence :
— Amadou, tu viens de prononcer cette profession de foi en toute connaissance de cause, et sans aucune contrainte de quelque ordre que ce soit, ni héréditaire, ni familiale, ni extérieure. A partir de ce moment, tu es vraiment musulman, fils de musulmans. Je souhaite que, plus tard, tu veuilles adhérer à la Voie tidjani à laquelle j'appartiens moi-même, et le moment venu, si tu le désires, je pourrai te l'enseigner. Mais ne te crois pas obligé de m'emboîter le pas. Comme il est dit dans le Coran : « Pas de contrainte en religion ! »
En attendant ce jour, sache que tu viens d'inhumer l'enfant que tu étais et d'exhumer l'homme que tu vas devenir. Désormais, tu es responsable de tes actes et de tes paroles. Surveille-toi comme un avare veille sur sa fortune. Ton coeur, ta langue et ton sexe sont les trois organes à surveiller.
Le meilleur des cœurs est celui qui conserve le mieux en lui-même la reconnaissance. Mais celui qui rapproche le plus l'âme des vertus essentielles que sont l'amour et la charité, c'est le coeur sur lequel l'égoïsme, le mensonge, l'envie, l'orgueil et l'intolérance n'ont pas de prise.
En Islam, pour maintenir ardent en nous le feu de la foi, il faut accomplir chaque jour les vingt-deux rekkats qui composent les mouvements de base des cinq prières cardinales. Elles sont comme autant d'entraves pour juguler la fougue de la langue et l'empêcher de nous jeter dans le péché par la parole.
Quant à ton organe sexuel, n'en fais pas un instrument de jouissance dépravée. Garde-toi des relations hors mariage, et méfie-toi des femmes de mœurs faciles qui se vendent par cupidité ou se donnent à tout venant.
Enfin, garde-toi des jeux de hasard, de la viande de porc, de l'alcool et du tabac, du tabac, et encore du tabac !…
A ce mot “tabac”, répété trois fois par Tierno avec tant de vigueur, mon sang ne fait qu'un tour et je me sens empli de fourmillements… Je garde en effet, tout au fond de ma poche, une tabatière en forme de bourse emplie de poudre de tabac. J'ai appris à Kati, avec les enfants des tirailleurs, à priser du tabac à la manière des Africains, mais je ne le fais qu'à l'insu de mes parents car, dans la Tidjaniya, l'usage du tabac est formellement interdit. S'ils l'avaient su, ils auraient été capables, surtout mon père adoptif, de refuser de manger avec moi dans le même plat. On m'aurait servi à part, chose impensable en Afrique ! C'eût été me ravaler au rang d'un chien.
Persuadé que Tierno voit ma tabatière à travers mes vêtements, je ne sais plus comment me tenir. Je me mets à me trémousser, à tortiller mon boubou. Deux fois, l'idée me vient de sortir carrément ma tabatière et de la donner à Tierno, mais je n'en ai pas le courage. Finalement je reste là, et ma tête retombe lourdement sur ma poitrine.
Tierno a vu mon embarras :
— Amadou !
— Oui Tierno ?
— Lève la tête.
Je relève la tête, mais garde les yeux baissés.
— Regarde-moi dans les yeux.
Je le regarde.
Il sourit largement :
— Mon fils, sache que Dieu est misériordieux, et que l'amplitude de Sa miséricorde est plus vaste que celle du nos péchés. Quand on se convertit à Lui ou que l'on revient sincèrement vers Lui, Il pardonne tous les péchés antérieurs. Inutile, donc, de ressasser tes fautes passées. Veille seulement à ne plus les commettre.
Je me sens libéré d'un grand poids.
Il est près de minuit. Tierno nous parle encore un peu, puis, selon la formule d'usage, il nous “donne la route”. Il nous raccompagne jusqu'à la porte. Là, il me fait tourner vers l'est, c'est-à-dire vers La Mecque, et se place en face de moi. Tout en me regardant fixement dans les yeux, il me donne sa dernière bénédiction, puis il me serre encore contre sa poitrine. Il donne une poignée de main à Mouktar.
— Bonne route, dit-il, et que la Paix soit devant vous, avec vous et derrière vous !
Je m'engage avec Mouktar dans la ruelle. Je me sens devenu un autre homme. Je suis frais, léger et dispos comme au sortir d'un bain réparateur. Au moment de tourner dans une autre ruelle, je me retourne. Tierno est toujours là, debout devant sa porte, mais il ne me fait aucun signe. C'est l'une des visions qui sont demeurées à jamais vivantes dans mon âme, avec celle de ma mère disparaissant derrière la dune de Koulikoro, et, beaucoup plus tard, la vision que j'aurai à nouveau de Tierno à Bamako, le jour de mon départ en chemin de fer pour Dakar, quand, pour la dernière fois, je verrai s'éloigner sa silhouette blanche sur le quai de la gare…
Tout emplis des paroles du maître, Mouktar et moi marchons silencieusement à travers la ville endonnie. Mouktar prend congé de moi devant la maison familiale. Dès son départ, je sors ma tabatière de ma poche et vais la vider dans la fosse des toilettes. Puis je la déchire et la jette elle-même dans la fosse.
Une fois rentré dans ma chambre, je reste en prière jusqu'à l'aube.
Afficher en entierAprès un petit repos on nous servit un déjeuner, et je repris immédiatement la route, suivi de mon porteur. La chaleur était écrasante, mais je ne la sentais pas. Mon cœur battait de joie, mes jambes me portaient, ma tête chantait, car ma prochaine halte serait Bandiagara, ma ville natale où s'étaient écoulées les plus heureuses années de ma jeunesse. J'allais retrouver mes parents, mes amis d'enfance, la rivière qui avait retenti de nos jeux et de nos cris, et tous les lieux où je m'étais tant amusé dans la poussière, sur le sable ou sur les grandes dalles naturelles que nous appelions “nattes de pierre”. Je me mis à chanter la devise de Bandiagara et celle de ma mère.
Vers dix-sept heures, j'aperçus le dôme gigantesque du grand baobab du cimetière de Bandiagara, qui domine la plaine et surplombe le grand bosquet à l'ombre duquel Bandiagara fut bâtie par Tidjani Amadou Seydou Tall, neveu d'El Hadj Omar.
A l'entrée de la ville, j'empruntai des ruelles que je savais peu fréquentées. Je voulais en effet surprendre Beydari Hampâté et tous ceux qui constituaient maintenant ma “famille paternelle” 16. Ils ne savaient pas que j'étais en route pour Ouagadougou. Je pus atteindre la maison sans me faire repérer. Ceux qui me rencontraient dans les ruelles s'effaçaient de mon chemin plutôt que de chercher a me dévisager, autant par discrétion naturelle que, sans doute, par crainte de ma tenue. Mon porteur franchit le premier le seuil du vestibule et déposa mes bagages ; puis il prit congé de moi et reprit le chemin de Mopti.
Les membres de la maisonnée — au moins vingt personnes assises dans le vestibule ou dans la cour — restaient figés, attendant l'annonce de l'identité du voyageur. J'entrai à mon tour, mais ne fus reconnu qu'après avoir ôté mon casque et mes lunettes noires. Un grand cri de joie éclata :
— Amkoullel ! C'est Amkoullel ! Seydi Bâ ! Seydi Bâ ! Amkoullel est venu !…
Le cri se répercuta dans la rue “Amkoullel est venu ! Amkoullel est venu !” Il se répandit comme une traînée de poudre dans tout le quartier, jusqu'au marché qui se tenait à quelque cent mètres de là.
Chaque femme se précipita sur son canari d'eau, à qui me servirait la première l'eau de bienvenue. Dinkadi, l'épouse de mon grand frère Beydari Hampâté, était en train de prier dans sa chambre. Avertie par les cris, elle se précipita au-dehors, chantant et dansant l'air Ndaa mi seyniima:
N'daa! Vois ma joie, ohé, vois ma joie!
Oh ! Je suis joyeuse, d'une joie qui me vient de Dieu…
Elle me serra fort dans ses bras, puis m'entraîna sous le hangar où elle fit installer plusieurs belles nattes pour accueillir les visiteurs qui n'allaient pas tarder à arriver. En quelques minutes, la cour se remplit de monde.
Beydari, qui se trouvait au marché, avait appris mon arrivée par la rumeur qui roulait comme une vague à travers le quartier. Il plia son étal et rentra en courant. Quand il me vit, il fondit en larmes et me serra contre lui. Nous pleurions de joie tous les deux. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de trois ans.
On m'installa dans la chambre même de Beydari. De tous côtés arrivaient à la maison des plats envoyés par des parents ou des amis : viande rôtie, couscous, lait, noix de cola, etc. La coutume voulant que le retour du fils du maître soit une occasion de réjouissances et de largesses, parents et captifs mirent tout en œuvre afin que cette première nuit soit aussi somptueuse qu'une nuit de mariage. Trente camarades, sur les soixante-dix qui composaient jadis l'association dont j'étais le chef, vinrent m'entourer. Des griots guitaristes d'abord, puis des chanteurs religieux animèrent la soirée. Nous ne nous séparâmes que tard dans la nuit.
Tôt levé le lendemain matin, à sept heures je me rendis à la résidence du commandant de cercle de Bandiagara, où je fus d'abord reçu par son interprète Seydou Harouna, un homme à vrai dire peu ordinaire. Ancien captif pullo du Djelgodji (région du Burkina actuel), non seulement il se vantait sans complexe de son statut, mais encore il l'affichait ostensiblement en portant constamment sur lui une flûte en bambou percée de cinq trous, dont seuls jouaient les captifs dans la société poullo-toucouleure, les nobles n'avant pas le droit de jouer d'un instrument de musique. Lorsqu'il se déplaçait a cheval, il accrochait sa flûte à sa selle ; et lorsqu'il entrait dans les bureaux de la résidence tous boubous déployés, il la portait suspendue à son épaule.
Mais là ne s'arrêtait pas son originalité. Bien qu'extrêmement riche, à l'occasion des grandes fêtes de fin d'année Seydou Ilarouna s'armait de sa flûte de captif et se rendait de porte en porte a travers la ville, perpétuant la coutume des captifs, pour réclamer aux familles nobles le cadeau qui lui était dû. Il recevait un franc par-ci, deux francs par-là, un boubou, voire quelques noix de cola…
Il ne faisait aucune exception dans sa tournée, même pour les familles nobles très pauvres que, par ailleurs, il aidait charitablement à vivre ; Seydou Harouna entretenait en effet, par générosité (comme l'avait fait longtemps avant lui son prédécesseur “Wangrin”), plus de trente familles pauvres de Bandiagara. Cette façon d'être était d'autant plus étonnante qu'à l'époque le “grand interprète” du commandant passait avant tous les Noirs, y compris les chefs indigènes ; c'était véritablement le deuxième personnage du cercle, plus puissant, parfois, que le “petit commandant” lui-même. De la part de Seydou Harouna, il ne s'agissait ni d'une plaisanterie ni d'une provocation : simplement, sans tenir aucun compte des nouvelles hiérarchies sociales créées par la colonisation, il appliquait, avec une sympathique simplicité, la tradition qu'il avait toujours connue.
Après les salutations d'usage, Seydou Harouna me fit s'asseoir auprès de lui. Il me posa les questions habituelles sur mon identité, ma situation, le but de mon voyage, puis il me dit :
— Amadou Hampâté, je suis un captif pullo. Donc, tu es mon maître. Ton captif Beydari Hampaté, qui vit ici à Bandiagara, est mon ami et mon égal, et c'est d'ailleurs toujours lui qui me fournit en viande. Je t'en prie, utilise-moi comme tu l'utiliserais lui-même. Surtout ne te gêne pas !
— Eh bien, lui dis-je, j'ai justement un problème à résoudre ! Avant du continuer mon voyage sur Ouagadougou où je suis affecté, je souhaiterais passer toute une semaine à Bandiagara, mais je ne sais quel motif invoquer pour que le grand commandant m'accorde un arrêt aussi long.
— Qu'a cela ne tienne ! répondit-il en se levant. Laisse-moi faire !
Il prit mes papiers et entra dans le bureau du commandant. Cinq minutes plus tard, il réapparaissait dans l'entrebâillement de la porte :
— Amadou Hampâté ! Le grand commandant t'attend. Viens vite!
En passant, il me glissa rapidement à l'oreille, en langue peule :
— Contente-toi de répondre “oui” à tout ce qu'il te demandera…
Je n'avais pas le temps de réfléchir, et moins encore de lui demander des explications. Une crainte me traversa cependant l'esprit : “Pourvu que ce vieux renard ne m'ait pas tendu un traquenard !” Il n'était pas rare, en effet, que de vieux interprètes illettrés, voyant dans les jeunes fonctionnaires instruits des remplaçants possibles, donc des rivaux dangereux, leur tendent des pièges pour les éliminer.
Quoi qu'il en soit, il était trop tard ; j'étais déjà dans le bureau du commandant. Penché sur sa table, il était en train d'écrire. J'ôtai mon casque, le serrai des deux mains contre ma poitrine et m'inclinai profondément :
— Bonjour, mon commandant ! Je suis venu vous présenter mes devoirs respectueux…
Avant que je puisse ajouter un mot, il s'exclama :
— Ah ! Voici donc le prince du Fakala ! — déclaration qui me plongea dans la perplexité. Alors, il paraît que la coutume ne permet pas à un descendant des Hamsalah d'aller s'amuser avec n'importe quelle fille, et qu'il faut le marier de bonne heure, n'est-ce pas ?
— Oui mon commandant ! …
— Et l'on veut faire l'école buissonnière à Bandiagara pour s'y choisir une petite fiancée, n'est-ce pas ?
— Oui mon commandant !…
— Eh bien, mon gars ! Contrairement aux règlements en vigueur, je prends sur moi de permettre à un jeune fonctionnaire en déplacement réglementaire de suspendre sa marche pour se fiancer. Je te donne dix jours de permission !
Le soulagement dilata ma poitrine:
— Oh! Merci mille fois, mon commandant !
— Ce n'est pas moi qu'il faut remercier, jeune homme, mais Seydou Harouna. Il m'a expliqué votre coutume et m'a dit combien il serait grave pour toi et les tiens que tu n'obtiennes pas une autorisation de dix jours pour régler cette affaire de famille. Certes, j'exige qu'on aime et respecte la France que je représente ici, mais je me fais un devoir de respecter les coutumes de mes administrés — tant qu'elles ne vont pas, bien sûr, à l'encontre des intérêts et du prestige de la France.
— Encore merci, mon commandant ! Merci au grand interprète Seydou. Harouna, et vive la France !
Je sortis du bureau tout heureux et remerciai l'interprète comme il se devait, mais non sans un sentiment de gêne ; ma conscience me gourmandait de lui avoir prêté une mauvaise intention alors que, pour m'aider, il était allé jusqu'à mentir à son chef. J'avais oublié de mettre en pratique le conseil donné à Hammadi dans le conte initiatique Kaydara: N'agis jamais par soupçon…
Afficher en entierNotre prochaine escale était Mopti. Ce serait aussi la dernière, car là s'arrêtait mon voyage par pirogue ; je devrais effectuer le reste du trajet à pied.
A Mopti, j'étais pour ainsi dire chez moi. Parents et amis ne m'y manquaient pas, et bien des souvenirs, heureux ou dramatiques, m'attachaient à cette ville depuis ma plus tendre enfance. Elle avait toujours été le point de départ de mes embarquements pour des pays plus ou moins éloignés, d'abord avec ma mère alors que nous rejoignions mon second père en exil, puis en tant qu'écolier, quand je commençai à découvrir le monde.
La perspective de revenir dans la ville avec mon titre tout neuf de fonctionnaire et mon casque colonial sur la tête me remplit pendant un moment d'une certaine joie, mais elle fut vite altérée à la pensée de devoir me séparer de mon brave Mamadou Koné. Placé au départ auprès de moi pour me surveiller et m'empêcher de m'échapper, il était, en fait, devenu un soutien fidèle et un compagnon précieux, pour ne pas dire un ami. Sa mission auprès de moi s'arrêtait à Mopti. J'eus beau retourner dans ma tête toutes les astuces possibles pour la lui faire prolonger par les autorités et pouvoir continuer de voyager avec lui, hélas, je ne trouvai aucune solution…
J'en étais là de mes réflexions quand j'entendis la voix du chef laptot :
— Ouvrez vos paquets et jetez dans le fleuve un peu de toutes les denrées ou nourritures que vous possédez. Nous allons traverser Denndamaare.
La première fois que j'avais dû sacrifier à ce rite, c'était lors de mon premier voyage d'écolier, sur le chemin de Djenné. Denndamaare était en effet la demeure de la déesse d'eau Mariama (ou Maïrama), fille de Gaa, la reine-mère de tous les dieux et esprits de l'eau du bassin du Niger, demeure située au point de rencontre des eaux du “fleuve noir”, le Bani, avec les eaux du “fleuve blanc”, le Niger. En ce lieu s'opère la réunion de toutes les eaux descendues des monts guinéens, sierra-léoniens et ivoiriens pour constituer un seul fleuve : le Grand Niger. En amorçant sa courbe pour descendre vers la mer, il enserre dans sa vaste boucle un territoire où fusionnent elles aussi de multiples races d'origines diverses, plus ou moins noires et plus ou moins blanches, lesquelles à leur tour, riches de leurs cultures respectives, vont former un grand peuple.
La coutume veut que l'on ne cache rien à Maïrama et qu'avant de quitter les eaux blanches pour entrer dans les eaux noires, ou l'inverse, on lui offre en sacrifice un peu de tout ce que l'on possède, comme en une dîme rituelle. Il ne serait venu à l'idée d'aucun d'entre nous de désobéir aux ordres de notre chef laptot à cette occasion précise, car en tant que Bozo c'était un “maître de l'eau”, un sacrificateur aux dieux d'eau, et il était sur son élément, donc le seul qualifié pour faire franchir à notre pirogue ce passage délicat.
Dans la tradition africaine ancienne, un chef, si puissant soit-il, ne détenait jamais à lui seul tous les pouvoirs entre ses mains. Dans tous les pays où il y avait des “maîtres de la terre”, des “maîtres des eaux”, de la pêche ou des pâturages, c'étaient eux qui détenaient l'autorité religieuse traditionnelle vis-à-vis de ces éléments et qui pouvaient en accorder le droit d'usage, et non le roi. La terre étant censëe n'appartenir qu'a Dieu, le droit de propriété n'existait pas. Nul ne pouvait décider de cultiver un terrain ou de s'y installer si le “maître de la terre” de l'endroit ne l'y autorisait en procédant a la cérémonie requise, comme l'avait fait à Bougouni le chef Tiemokodjian lorsqu'il avait concédé un terrain à ma mère. Certes, il incombait à ces chefs traditionnels de récolter éventuellement des redevances pour le roi, mais ce dernier ne pouvait leur imposer ses désirs.
Arrivés à Mopti, notre chef laptot nous fit débarquer au quai Simon. Je me rendis tout droit chez Tiébessé, l'amie d'enfance de ma mère chez qui nous étions descendus si souvent lors de nos passages dans cette ville. Après les salutations d'usage, elle m'apprit une nouvelle qui me serra le cœur :
— O Amkoullel ! me dit-elle, ton père Koullel est ici, à Mopti, et il a été malade toute l'année. Il y a même eu un moment, le mois dernier, où personne n'a pensé qu'il survivrait. Il a déliré pendant trois jours, et pendant son délire il n'avait qu'un seul nom à la bouche : « Amkoullel ! Amkoullel ! » Il te parlait comme s'il te voyait en face de lui. Un jour, il a maudit les Français et leur école qui vous avaient séparés. Depuis, il s'est un peu rétabli, mais il n'a pas de forces. Ta vue sera certainement pour lui un grand remède.
Je devais me présenter au cercle avec Mamadou Koné pour y faire viser mes papiers, mais je repoussai cette visite à l'après-midi. Accompagné de Tiébessé, je me rendis immédiatement chez mon père Koullel, l'ami de toujours de ma famille, le camarade d'enfance de Tierno Bokar et de mon oncle Bokar Paate. Ce grand magicien du Verbe, conteur, historien, poète et savant traditionaliste, qui m'avait entouré de son affection depuis ma plus tendre enfance et qui avait veillé sur ma formation traditionnelle, qui avait donné tant d'éclat aux soirées récréatives de mes parents et qui nous avait transmis tant de connaissances, cet homme dont on m'avait donné le nom et qui, d'une certaine façon, a été a l'origine de ma vocation, gisait là sur sa couchette, amaigri, les paupières fermées, dans un état qui aurait arraché des larmes à une pierre.
— Soulébo, Soulébo !, l'appela Tiébessé, utilisant son nom personnel (“Koullel” était son surnom, son nom d'usage). Amkoullel est venu…
Des larmes coulèrent doucement des yeux fermés du vieil homme. Moi je pleurais comme un enfant, que d'ailleurs pour lui je ne cesserais d'être ma vie durant.
Je m'assis sur le lit en y allongeant mes jambes, soulevai Koullel dans mes bras et le couchai en posant sa tête sur mes jambes, dans cette position qui, en Afrique, exprime l'intimité et la confiance les plus totales. Je commençai à le masser doucement. Il luttait pour soulever ses paupières, comme pour vérifier de ses yeux que c'était bien moi, que Tiébessé n'avait pas menti… mais elles retombaient constamment. Enfin, à ma plus grande joie, il parvint à ouvrir ses yeux.
— Amkoullel ! Amkoullel ! fit-il d'une voix mal assurée. C'est bien toi, mon Amkoullel ?
— Oui, père ! Je suis bien ton Amkoullel. Je suis venu de Bamako. Poullo ma mère et Naaba mon père te saluent.
— Merci, dit-il en essayant de sourire. Et merci, mon Dieu, de m'avoir permis de revoir mon fils avant de quitter ce bas monde ! …
Il saisit ma main et essaya de la serrer, mais il n'en avait pas la force. Il se contenta de laisser glisser la paume de sa main sur le dos de la mienne.
— Tu as vite grandi, mon fils, reprit-il de sa voix faible. J'en suis heureux. Tu pourras te défendre dans la vie. Tu n'auras plus besoin de moi, je peux m'en aller tranquillement.
Ces paroles me tordirent les entrailles.
— Père, m'écriai-je, ne dis plus ce mot. il est trop cruel pour moi, je ne veux pas l'entendre. Si tu m'aimes, ne le dis plus.
Il sourit :
— Je sens déjà comme une amélioration de mon état. Allez, recouche-moi, va faire tes courses et ne reviens que demain matin. Je crois que je vais bien dormir.
Je fis venir un matelas neuf pour remplacer celui sur lequel je l'avais trouvé et l'y installai de mes mains. Son visage était souriant. Je sortis, comme il me l'avait demandé.
En Afrique traditionnelle, les amis intimes d'un homme ou d'une femme pouvaient ainsi aimer les enfants de leurs amis comme s'ils étaient les leurs, et s'y attacher profondénient. De mon côté, je ne sentais pas de grande différence entre Koullel et mon père adoptif Tidjani Thiam, le second époux de ma mère. L'usage du mot “père” aidait encore à renforcer ce lien, car les mots ont une force que nos anciens connaissaient bien. Nombre de mes camarades vivaient des relations du même genre. La règle était générale, c'est le contraire qui eût été exceptionnel.
De retour à la maison, je donnai à Tiébessé l'argent nécessaire pour acheter tout ce qui manquait dans la maison de mon père Koullel en fait de commodités. Puis je me rends au cercle, où m'attendait mon brave Mamadou Koné.
Je me présentai tout d'abord au “grand interprète” de Mopti, qui s'appelait Oumar Sy. Il ne descendait pas du roi Mademba Sy, mais de Hammadi Koumba Kettiel Sy, l'interprète du colonel Archinard, le grand conquérant du Soudan français.
Il m'annonça au commandant de cercle. Celui-ci étant en train de tenir une grande palabre avec tous les chefs du pays, c'est le “petit commandant” — c'est-à-dire l'adjoint au corrimandant de cercle — qui me reçut. Son interprète (appelé comme il se devait “petit interprète”) m'avertir en fulfulde :
— Fais bien attention ! Le petit commandant ne gobe pas les Toucouleurs, particulièrement ceux de Bandiagara. Ne t'attends à rien d'agréable de sa part. Il cherchera ses propres poux dans tes cheveux. Et ne t'étonne pas de l'entendre proférer des paroles désagréables et des allusions blessantes ; il nous en abreuve copieusement tous les jours.
Je présentai au petit commandant mes papiers et ceux de Mamadou Koné. Il mit les papiers de Mamadou Koné de côté, puis examina les miens qui comprenaient une copie de ma décision de nomination, mon ordre de route, mon certificat de situation de solde et un état des avances perçues. On aurait dit qu'il y cherchait quelque irrégularité pour pouvoir nie la reprocher. Après les avoir tournés, retournes, feuilletés et refeuilletés, il eut une sorte de contraction des muscles de son visage, ce qui donna à sa physionomie, barrée par une moustache tombante en forme de cornes de bœuf musqué, un aspect à vrai dire plus grotesque que terrifiant.
Il leva les yeux sur moi et me regarda dédaigneusement, bougonnant je ne sais quoi à mi-voix. “Un homme prévenu en vaut deux”, me dis-je. Je sentais l'orage prêt à éclater mais me préparai à le recevoir, en pasteur habitué à affronter la tornade avec calme. Cela ne tarda pas :
— Quelle connerie as-tu commise pour qu'on ait eu besoin de te flanquer un garde au cul ?
— Si mon commandant veut bien examiner mes papiers ou ceux du garde, il y trouvera certainement la réponse à sa question, répliquai-je, en faisant une demi-révérence.
— Eh, mon garçon, doucement ! Je suis le “petit commandant” de cette région. Ne t'avise surtout pas de faire de l'esprit avec moi, tu ne tarderais pas à t'en repentir.
Il tapa de la main sur la table :
— Je t'ai posé une question et j'attends une réponse !
— Oui mon commandant ! Mais que mon commandant m'excuse, je ne sais quoi lui répondre.
— Pourquoi vas-tu servir au diable dans un pays étranger, alors que ton pays n'a pas suffisamment de fonctionnaires ?
— Je demande bien pardon à mon commandant, mais je vais servir dans un territoire français qui, il y a deux ans seulement, faisait encore partie intégrante de mon pays, le Soudan. je ne vais donc pas “à l'étranger” comme le dit mon commandant.
A ce moment un garde entra brusquement dans le bureau. Il se mit au garde-à-vous :
— Ma coumandan ! Le grand coumandan y demander vous véni toussuite dans bureau !
Le petit commandant ne se le fit pas répéter deux fois. Il se leva aussitôt, rajusta ses habits, passa sa main dans ses cheveux embroussaillés et se dirigea vers la porte. En passant, l'air mauvais, il me bouscula légèrement :
— Ote-toi de mon chemin !
Un commis expéditionnaire, secrétaire du grand commandant, avait entendu le dialogue depuis son bureau. Il sortit et vint me rejoindre. Par chance, c'était l'un des fils du grand chef pullo Amadou Kisso chez qui j'avais logé lorsque j'étais écolier à Djenné. Il s'appelait Alfadi Cissé. Il entra dans le bureau du petit commandant, jeta un coup d'œil rapide sur sa table et s'empara de mes papiers, y laissant ceux de Mamadou Koné. Il me prit par la main :
— Viens mon frère ! Cet imbécile de mal blanchi se fait toujours un plaisir de provoquer les nègres, et plus particulièrement leurs intellectuels. Il devrait savoir que tant que Dieu sera Dieu, le lionceau ne mangera pas de l'herbe !
Il m'installa dans son propre bureau et disparut avec mes papiers, plus quelques autres qu'il avait tapés à la machine. Quelques minutes plus tard, il était de retour :
— Tiens, me dit-il, voilà tes papiers. Ils sont visés. Le chef de village de Mopti mettra à ta disposition un porteur quand tu le lui demanderas. Le grand commandant te souhaite un bon voyage.
Je le remerciai, mais m'inquiétai de savoir si sa démarche ne lui causerait pas d'ennuis.
— Sois tranquille, répondit-il, le petit commandant comprendra la leçon. Il n'a aucun droit de te parler comme il l'a fait, car tu ne dépends de lui en aucune façon. Comme c'est le grand commandant qui a signé tes papiers, il se tiendra tranquille.
— Comment as-tu fait pour réussir ce coup, si salutaire pour moi ?
— J'avais des documents urgents à faire signer par le commandant. J'en ai profité pour lui demarider de viser également tes papiers, ajoutant que tu étais mon cousin et que cela t'éviterait du séjourner trop longtemps à Mopti. Et le tour fut joué !
Je compris alors combien un secrétaire, ou un interprète, pouvaient changer la tournure d'une affaire. En fait, grâce à lui j'avais échappé a un grand danger, car si j'avais dû revoir le petit commandant, celui-ci aurait sans doute — comme cela se produisait fréquemment — essayé de me faire sortir de mes gonds en me disant les choses les plus désagréables, voire insultantes, jusqu'à ce que je profère une impolitesse ou des paroles imprudentes. Et là, il aurait eu un prétexte pour me causer les plus grands ennuis.
Je quittai mon ami et rentrai chez Tiébéssé. Le lendemain matin, Mamadou Koné se présenta de bonne heure : il venait prendre congé de moi. Je le remerciai sincèrement pour son agréable compagnie et tous les services qu'il m'avait rendus pendant notre voyage, et lui remis, comme il se devait, un bon cadeau en gage de reconnaissance. Nous regrettions beaucoup l'un et l'autre de ne pouvoir continuer la route ensemble, et nous nous quittâmes en nous souhaitant bonne chance. Je n'ai jamais oublié Mamadou Koné, le “garde surveillant” qui était devenu mon ami.
Dans la matinée, je me rendis chez mon père Koullel. Je le trouvai bien mieux que la veille. Je restai avec lui trois jours, mais à la fin c'est lui-même qui m'ordonna de poursuivre mon voyage. Je partis le lendemain matin pour Bandiagara. La certitude qu'il allait mieux et qu'il allait se remettre atténuait un peu ma peine de le quitter. En fait, il ne devait pas survivre plus d'un mois à mon départ, mais je n'appris son décès que beaucoup plus tard. Ma consolation fut de l'avoir revu avant son départ de ce monde éphémère.
Je quittai Mopti à l'aube avec le porteur qui m'avait été affecté. Nous avions soixante-dix kilomètres à faire à pied avant d'atteindre Bandiagara. Il nous fallut déjà presque trois heures pour franchir la longue digue de douze kilomètres qui relie Mopti à la terre ferme pendant la période des hautes eaux qui inondent toute la région. Cette digue, véritable travail de titan, était l'œuvre d'Alfa Maki Tall, fils du roi Aguibou Tall et chef de Bandiagara après la mort de son père, celui-là même qui avait donné son petit garçon pour remplacer mon frère le jour où nous avions été réquisitionnés d'office pour l'école française. Alfa Maki Tall, qui avait des dons innés pour les travaux de construction, avait trouvé là l'occasion d'exercer son talent. Certes, cette digue a subi depuis des réparations et des améliorations, mais elle est toujours là et sert de support a une route très fréquentée.
Entre Seeware et Waylirde, nous fûmes rejoints par un superbe cavalier. Il chevauchait un cheval sahélien au ventre avalé comme celui d'un lévrier, la robe alezan doré, les pieds lavés et le front étoilé. Le harnachement était celui d'un prince. Quant au cavalier, il tenait à la main en travers de sa monture un long bâton sculpté en bois d'ébène.
Arrivé à ma hauteur, estimant sans doute à ma tenue que j'étais un agent de l'autorité, il me salua et me demanda mon nom. Je le lui dis. Alors, fichant son baton en terre sans descendre de selle, il fit danser et caracoler son cheval sur un rayon de cinq mètres, lui faisant accomplir presque tous les mouvements équestres classiques, tout en déclamant en langue peule un poème de sa composition en l'honneur du Prophète Mohammad. Pour clore son chant, il fit faire une grande courbette a son cheval et déclara :
— Amadou, fils de Hampâté, petit-fils des Bâ et des Hamsalah du Maasina, je me nomme Sandji Amadou, et suis un troubadour de l'Envoyé de Dieu.
Très ému, je lui demandai de me faire crédit de ce que j'aurais dû lui donner pour une telle rencontre.
— Je m'en acquitterai plus tard, lui dis-je.
Il releva sa monture, rangea son bâton et sourit :
— On ne doit pas dire à un pêcheur “donne-moi un poisson, avant qu'il ne soit allé à la pêche.” Et il ajouta : “le talon et le serpent se meuvent tous deux à même le sol; leur rencontre n'est donc pas impossible” — ou, comme on dit en français : “Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas.” Il nous salua, et poursuivant son chemin il s'éloigna au petit trot.
C'était la première fois que je rencontrais ce grand poète, né à Sokoura dans le Kounari (région de Mopti). Dans toutes les régions peules de la Boucle du Niger, on chante encore ses poèmes a l'occasion des fêtes et des grandes cérémonies religieuses.
Après Lin bref repos à Doundou, je repris la route dès treize heures car toute la zone comprise entre Doundou et Goundaka, l'ancienne capitale des rois du Kounari, était alors infestée de lions. Mon plan de route m'imposait de passer la nuit au campement de Fiko, non loin de Goundaka. Il fallait à tout prix atteindre ce campement avant le coucher du soleil afin de nous mettre à l'abri des fauves. A la fourche de la route, juste avant l'entrée de Goundaka, une grande pancarte annonçait : “Méfiez-vous des lions.” Cet avertissement stimula suffisamment nos forces pour nous permettre d'accomplir au pas de course le reste du trajet. Nous arrivâmes au camp vers quinze heures ; nous avions le temps de nous y installer et de bien nous barricader.
Le campement était situé dans la plaine, juste sous un village dogon qui, lui, était niché sur la falaise. Un veilleur dogon se tenait sur la première corniche de la falaise pour entendre l'appel que les fonctionnaires de passage devaient lancer pour signaler leur arrivée. Mon premier soin fur de pousser à pleins poumons le cri conventionnel. Je montai sur l'élévation aménagée à cet effet en dehors du campement et criai :
— Courrier ! Courrier ! Courrier !
Puis j'attendis, pour savoir si le veilleur avait perçu mon appel. J'eus de la chance ; l'écho m'apporta presque immédiatement sa réponse :
— Yooo ! Yooo !
Une demi-heure plus tard, le chef de village, accompagné de deux personnes, se présenta au campement. Il me trouva confortablement installé dans ma chaise longue, emblème indiscutable de mon rang social ; à l'époque, un homme occupant une chaise longue ne pouvait être qu'un agent de l'autorité ou le fils d'un grand chef, en tout cas un homme fortuné. Il prit une attitude humble, me salua et, malgré son âge, vint s'accroupir au pied de mon siège avec ses deux compagnons, attendant mes ordres.
— Je dois passer la nuit ici avec mon porteur, lui dis-je. Il faut m'envoyer un repas et du lait.
C'était la ce que l'on appelait alors le “droit du casque” s'il s'agissait d'un fonctionnaire colonial, ou “de la chéchia rouge” s'il s'agissait de gardes de cercle, de goumiers ou de spahis.
Sans doute ma demande ne parut-elle pas excessive au chef dogon, car il sourit largement, apparemment: soulagé :
— Tu seras servi avant que le muezzin n'appelle à la cinquième prière du jour !
Il fit un signe de tête au plus jeune de ses compagnons, qui partit comme une flèche. Je le priai de se relever et de s'asseoir ainsi que son compagnon, ce qui eut pour effet de dissiper toutes leurs craintes. Le chef se mit a me poser des questions sur les blancs-blancs de Bamako et me demanda s'il était vrai que cette ville était éclairée la nuit au moyen de lampes sans huile ni mèche, des lampes qui, disait-on, brillaient comme de petits soleils… Je le lui confirmai, mais je ne suis pas sûr qu'il me crut. Il marmonna entre ses dents quelques mots que je ne compris pas.
Une heure plus tard, trois jeunes femmes apparurent, portant chacune une calebasse sur la tête. La première calebasse contenait de la pâte de mil, la deuxième une sauce onctueuse à base de viande de poulet, la troisième environ quatre litres de lait frais. Les récipients furent déposés devant moi. Par discrétion, le chef prit congé et regagna son village. Je n'eus à lui donner qu'une poignée de main en échange de son hospitalité.
Je dînai seul, et donnai les restes à mon porteur. Celui-ci mangea à sa faim, et a son tour porta les restes à deux voyageurs qui étaient arrivés après nous. La nourriture ne se mesure pas en Afrique. Quand on en fait pour un, soyez sûr qu'il y en aura toujours pour quatre, ou même davantage !
Le lendemain, dès le lever du soleil, je quittai Fiko et prit la route de Bandiagara. Cette dernière étape était longue et accidentée. Il fallait franchir la grande colline dite “Ɓalewal Kori”, effort d'autant plus pénible que nous étions déjà exténués par une marche de près de vingt kilomètres et par la crainte des fauves qui pullulaient dans cette région déserte et giboyeuse. Heureusement, de l'autre côté de la colline se trouvait le campement du village de Kori-Kori, à environ quinze kilomètres de Bandiagara. Les campements, surveillés par des gérants, étaient alors des sortes de gîtes mis en place par l'administration tous les vingt-cinq ou trente kilomètres en bordure des villages pour loger les fonctionnaires de passage. On y trouvait des cases de terre, généralement doubles, coiffées d'une toiture de chaume.
Afficher en entier