Les commentaires de AureRaineke
Je vois déjà vos yeux écarquillés de surprise en lisant romance et vampire. Vos neurones sortir des tiroirs de la mémoire le fameux : “elle n’avait pas dit qu’elle n’aimait pas beaucoup ces deux genres ?”. Vous avez raison, mais je ne pouvais pas passer à côté de cet ouvrage écrit par ma collègue et amie K. Sangil dont j’ai déjà bêta-lu des nouvelles (dont celles de 11 Contes et légendes revisités et 10 destinées). Elle appartient à cette catégorie d’autrices dont la plume réussit à me tirer hors de ma zone de confort et à frayer avec l’en.. euh les créatures et les genres que j’apprécie le moins. Second Souffle m’a-t-il convaincu ? Voici ma réponse :
À 16 ans, Eustenée Milesi embrasse son destin avec fierté et tristesse. Elle doit porter le dernier souffle du Premier Né vampire pour l’offrir à son successeur. Cette transmission de pouvoir suscite jalousie et avidité, car une partie des suceurs de sang déteste le Traité de Paix avec les sorcières et l’ombre dans laquelle leur condition les oblige à vivre auprès des humains. Sa rencontre avec le traqueur Lajos Walkil va bousculer sa vie et son cœur, pour le bien comme pour le pire.
Le roman s’ouvre sur une lettre écrite par Ellura Milesi, la mère d’Eustenée. Elle plante la situation initiale et les enjeux de façon succincte et captivante à la fois. L’histoire se déroule en 1890 dans l’empire austro-hongrois dirigé par François-Joseph Ier. Vous savez l’époux de la femme la plus célèbre et tragique de ce pays : Sissi. Juste par la mention de cette duchesse et iméparitrice, je suis sûre que la scène vient de se dessiner d’un coup dans votre esprit : des châteaux, des bals, des robes somptueuses, des conspirations…
C’est dans ce contexte que prend place la romance entre Eustenée et Lajos. La première partie du livre développe l’amour entre ces deux âmes tandis que la seconde nous plonge dans les complots liés à la révolte populaire qui secouent la Hongrie. J’avoue avoir eu un peu de mal à imbriquer certains passages, car ce morceau d’histoire que je ne connais pas est juste esquissé et sert surtout à renforcer le lien qui unit Eusténée et Lajos. J’aurais d’ailleurs aimé avoir plus de complots et de sournoiseries, mais je comprends qu’il ne s’agit pas d’un roman historique à la Ken Follet dans lequel les coups bas sont roi. Le genre principal est la romance et les fans de ce type littéraire ne seront pas déçus.
K. Sangil a réussi à briser mon cœur de pierre grâce à l’émotion qu’elle insuffle dans les relations et interactions entre ses personnages. Et ce, même dans les scènes de sexe qui sont bestiales pour certaines. Un point m’a frappé dès les premières pages : l’esprit de famille qui unit Eustenée et ses parents. N’étant pas friande de récits vampiresque, je ne peux affirmer que cet aspect est original. Les férus vont peut-être lever les yeux aux ciels devant mes idées vieillottes et dépassées sur ces créatures. Je ne cache pas que hautains et sensuels sont les mots qui me viennent les premiers en tête pour les décrire. Dans Second souffle, Karey le père respire d’amour pour sa femme sorcière et sa fille. On ressent la chaleur et l’union de cette famille avec une force qui m’a fait fondre. Surtout quand on sait les épreuves que les parents ont dû endurer pour convaincre leur clan à cause de la guerre ancestrale entre vampires et sorcières.
À leur rencontre, Eustenée n’apprécie pas Lajos en raison de son attitude froide et rustre envers sa mère et elle. Du coup, je pensais avoir affaire à un ennemi to lovers. Cependant, ce passage m’a paru tellement rapide que je ne le glisserai que partiellement dans ce trope. Le couple devient inséparable en quelques pages, même si des problèmes surgissent dans leur idylle, notamment dus au statut particulier de Lajos et à ses préjugés.
Ce chasseur solitaire ne se rend pas compte que certains de ses comportements peuvent engendrer des situations délicates. De plus, son dégoût des sorcières ne facilite pas les relations. Sa fidélité envers Karey, les souvenirs du Premier Né et l’amour qu’il porte à Eustenée vont l’aider à les surmonter à ouvrir la porte d’une nouvelle ère.
En bref, Second souffle est une romance fantastique mettant en scène la puissance de ce sentiment qui vainc les différences raciales et les ambitions personnelles d’individus peu recommandables. La plume captivante de l’autrice qui peint les émotions sans filtre m’a plongée dans ce récit flirtant avec l’histoire d’un pays que je connais peu. Même si elle manque de conspirations et faux-semblants pour pimenter les rebondissements à mon goût, elle fait parfaitement son job dans ce genre littéraire.
Afficher en entierAyant entendu parler et lu plusieurs chroniques sur cette trilogie jeunesse, j’ai fini par craquer et me lancer dedans, sans regret !
Dame Mélisse, une puissante Magicière et grand-mère de Charly, rompt l’un de ses beignets de prédiction, puis s’évanouit dans la nature. Cinq ans après, elle est retrouvée affaiblie et amnésique. Son petit-fils se réapproprie la magie qu’il avait oubliée et découvre le monde auquel elle appartient. Aidé de Maître Lin et de Sapotille, son chemin l’amènera vers des révélations plus incongrues les unes que les autres, jusqu’à la raison inimaginable qui a poussé sa mamie à disparaitre.
L’univers élaboré par Audrey Alwett est à la fois simple, complexe et original. À chaque page, je m’imprégnais un peu plus de son monde gentil et cruel, lumineux et obscur où son imagination me prenait de cours par son mélange de mignonnerie et d’injustice. Magic Charly synthétise tous les aspects de la réalité et du merveilleux, et converge vers une révélation finale… inattendue de par sa nature. Je vais sciemment éviter de vous décrire la hiérarchie et le fonctionnement afin que vous découvriez tout comme il se doit, un peu comme Charly lorsqu’il entre dans ce monde.
Au-delà de cet ouvrage fantastique, dans tous les sens du terme, j’ai adoré son inclusion, sa tolérance et sa bienveillance (si on omet les mésaventures de Charly et de Sapotille). Charly est un adolescent de 14 ans, tout ce qui est de plus banal. Pourtant, sa carrure alliée à sa couleur de peau inspire la méfiance et des regards obliques de la part des passants malgré sa gentillesse et sa bonté. Il avale ses pensées et émotions négatives dans ses poings. Devenu Patouilleur (apprenti), il prend soin de ne pas faire d’ombre à Parchemine/Sapotille dont le manque de confiance en ses propres capacités l’entraine à le méjuger. Leur duo va évoluer vers une amitié solide qui promet des étincelles dans les tomes suivants.
J’ai adoré Sapotille bien plus que la copine rebelle de Charly : June. Malgré ses faiblesses et son caractère hautain, la première possède une force de conviction et une graine de femme forte qui n’a besoin de personne pour la protéger. Elle va apprendre que, parfois, l’entraide peut s’avérer précieuse. June est la pote de Charly qui incarne l’essence de l’adolescence. Rebelle, elle se pose en opposition des règles établies par les adultes et adore les mauvais coups. En dépit de son sale caractère et de son côté envahissant, elle est fidèle en amitié. Charly peut compter sur elle.
L’histoire est servie par une plume usant des deux V : visuelle et vivante. L’écriture s’amuse avec les mots sans abuser des symboliques. Dosée avec amour telle une recette de Dame Mélisse, elle peint le monde de Magic Charly en un gâteau aux mille saveurs.
En bref, j’ai adoré L’apprenti au point de vouloir en parler pendant des heures tout en me retenant. La découverte de l’univers merveilleux d’Audrey Alwett m’a profondément émue, si bien que je ne souhaite pas vous gâcher cette expérience. En deux mots : Lisez-le !
Afficher en entierJe remercie chaleureusement Babelio de m’avoir proposé Les femmes d’Heresy Ranch de Melissa Lenhardt en service presse. Ne suivant plus l’actualité des gros éditeurs, je serais sans doute passé à côté de ce roman historique à la saveur féministe. Un récit qui se base sur une histoire vraie, une histoire effacée par les historiens et enterrée par les films hollywoodiens qui insèrent dans les esprits des clichés et préjugés.
« Emily Butler, c’est votre vrai nom ?
— Aussi vrai que nécessaire.
— Votre gang a un nom ?
— Nous sommes une légende, vous vous rappelez ? »
En 1877, Colorado, un gang de femmes s’attaque à une diligence qui transporte l’argent de Connolly. Grace Trumbull, écrivaine en quête d’aventures s’y trouve. Impressionnée, elle demande à les suivre pour coucher sur le papier leur histoire, car personne n’y croit.
Pour une fois, je ne m’étale pas sur le résumé. Je pense que ces quelques lignes suffisent amplement à vous transmettre l’intérêt du roman. On y suit Margaret Parker (alias Garet), Henrietta Lee (Hattie LaCour), Stella et Joan qui au détour de leurs malheurs (le mot est faible pour décrire ce qu’elles ont vécu) se sont croisées et ont décidé de vivre comme des hors-la-loi. Tout est parti d’une injustice : du vol (n’ayons pas peur de le nommer ainsi) du Ranch de Garet par le Colonel Connolly lorsqu’elle perd son mari. Or, Garet est une gestionnaire sans égal. Elle séduit les chevaux sauvages et les dresse avec amabilité. C’est d’ailleurs elle qui contrôlait le ranch. Mais voilà, elle possède le plus gros défaut de la terre d’après la société humaine dans laquelle elle vit : c’est une femme et tous les hommes savent qu’une femme ne peut s’en sortir seule. Enfin pas tous, mais peu d’entre eux osent le clamer haut et fort.
« Une minute, ma belle. Je ne vais pas pouvoir continuer si vous vous obstinez à répéter que ceci n’est pas possible et que cela est incroyable. On n’est qu’au début de l’histoire. Bon sang, pas étonnant que les histoires de femmes restent toujours ignorées de tous. Tout ce qui sort de l’ordinaire est taxé d’être des inventions ou le fruit d’une trop grande imagination. Comme s’il ne venait jamais à l’idée de personne que les femmes puissent être aussi capables que les hommes, plus douées même, dans bien des situations, parce qu’on n’a pas à tenir notre rang en tant qu’homme, avec tout ce que ça implique. »
Ayant refusé l’aide de son voisin qui ne lui proposait pas de collaboration équitable, mais un mariage, elle se retrouve sans le sou aux portes de l’hiver. Aucun banquier n’a les couilles de lui prêter de l’argent en outrepassant les injonctions du colonel ! Par survivance et vengeance, elle braque Les Rocheuses et le vole à son tour. C’est le début du gang Parker dont les exploits à la Robin des bois : elles distribuent le butin aux gens qui vivent dans un trou perdu.
« Mais nan, ce sera perdu et oublié, comme tant d’autres choses. Oublié ou transformé. Parce que ce sont les hommes blancs qui écrivent l’Histoire, ma fille. Ils ne se montreront jamais autrement que comme des héros. Allons… Vous savez très bien que j’ai raison. Vous voulez la vérité, je vous la donne, Grace Williams. »
Ce roman est basé sur des faits réels mis en lumière par la doctoresse en histoire Stéphanie Bailey qui relate en préface et en interview, comment elle a découvert ce gang féminin et sa démarche pour retrouver les quelques sources disponibles. Ces traces tangibles et en même temps peu nombreuses qui ont permis d’étayer Les femmes d’Heresy Ranch. Melissa Lenhardt a choisi une structure et un type de narration ingénieux. Elle mélange des extraits de journaux intimes, des témoignages de la WPA (Work Projects Administration) et des articles. Vous l’aurez deviné, ce sont les mêmes sources que Stéphanie Bailey. Le travail de l’écrivaine pour donner vie à ce passé oublié est savamment dosé si bien qu’on croit plus au récit qu’aux articles des journaux rédigés par des hommes, dans une société patriarcale et qui sont manipulés par les riches propriétaires.
Ce n’est pas seulement une envie de ma part de vouloir croire en l’histoire de ces femmes. Cette impression, cet ancrage dans mon esprit provient de la vraisemblance des personnages et de l’atmosphère de réalité que la plume de Mélissa Lenhardt dépeint.
Au lieu de plonger dans une aventure avec des hold-up extraordinaires des fusillades chorégraphiées au mouvement près, l’autrice nous offre une entrée dans le quotidien de ces femmes. Un quotidien doux et cruel à la fois, où la société ne les épargne pas, sans pour autant tomber dans le mélodrame. Tout comme Grasse on découvre peu à peu leurs passés, leurs blessures, leurs forces comme leurs faiblesses, au point de s’attacher à elles. J’ai été émue de lors des derniers chapitres de devoir les quitter, si bien que la partie intitulée La famille va au-delà du sang a pris tout son sens. J’ai eu l’impression de quitter des amies, des proches. Je voulais continuer à vivre auprès d’elles jusqu’à la fin de leur jour, même si le roman n’a pas besoin d’exploiter cette partie de leur vie.
Mon émotion témoigne de la densité de ces personnes que Mélissa Lenhardt a réussi à ressusciter le temps de compter leur histoire. Ce qui m’a le plus frappé est l’égalité de leur relation. Quand on parle de Western et de gang, on a tout de suite l’image d’une bande avec un chef. Or, Heresy Ranch possède plutôt une gestion sur l’égalité. Même si Garet pourrait être considérée comme la tête du gang, on remarque vite qu’Hattie marche à ses côtés. Lorsque l’orgueil de l’une manque de les mettre dans la mouise, l’autre la remet sur le bon chemin.
Margaret Parker est une femme ouverte d’esprit qui a du répondant. D’origine anglaise, elle est arrivée au Colorado lors de sa lune de miel. Son mari, Thomas, et elle sont tombés amoureux de la région. Surtout Garet en raison de son amour pour les chevaux qu’elle dresse avec expérience. Dès que des femmes en détresse approchent de la maison, elle les accueille avec bienveillance, sans les questionner. Elle leur tend la main alors qu’elle affronte ses propres soucis seule.
C’est ainsi qu’elle a rencontré sa meilleure amie, Henrietta Lee qui s’extirpe d’une horrible situation grâce à son courage et à sa volonté. Fidèle, elle possède un cœur en or sous la carapace qu’elle a érigé à cause de son statut de femme noire. Malgré sa dureté, son autorité et son franc-parler, les gens qui la côtoient finissent par tomber sous son charme. Sa capacité à trouver des solutions et à les mettre en pratique s’avère précieuse.
À elles deux, elles forment un duo grandiose et soudé même si les désaccords (l’arrivée de Grace, par exemple) surviennent dans leurs relations. On a l’impression que rien ne peut les arrêter lorsqu’elles agissent ensemble. J’ai adoré leurs interactions sans fard, pures et parfois tendues. Désireuses de garder leur liberté, elles dénoncent les abus masculins, la violence dont ils ont recours, car ils se sentent faibles, impuissants. Cela donne de nombreuses punchlines qui ont rempli mon téléphone de photographie.
« — Qu’est-ce que vous faites à Timberline, Garet ? Vous avez des ennuis avec la loi ?
— Comment avez-vous deviné ?
— Vous avez l’air de quelqu’un qui attire les ennuis.
— Ah oui ?
— Quelque chose dans vos yeux. J’imagine que votre mari a du mal à vous mettre au pas.
— Il n’y a jamais eu jusqu’à présent d’homme capable de me mettre au pas, comme vous dites si élégamment.
— Ça me plairait d’essayer, pour sûr.
— Surveillez vos paroles, a fait Luke.
— Je ne voulais pas marcher sur vos plates-bandes, shérif.
— Je ne suis les plates-bandes de personne. Vous feriez mieux de vous en souvenir. »
À côté des thèmes féministes comme l’émancipation des femmes et la reconnaissance de leurs exploits dans l’histoire, l’autrice n’oublie pas de peindre le contexte, sans verser dans la tragédie, de la condition des gens de couleurs. En la personne d’Henrietta, elle met en avant la différence de traitement juste parce qu’elle est noire. L’esclavage y est aussi abordé. Les Chinois et métisses apparaissent dans des rôles habituels des westerns : serviteurs ou prostituées avec leurs lots de malheurs et de désirs.
En bref, j’ai adoré Les femmes d’Heresy Ranch, car il renferme tout ce que j’aime bien qu’il se déroule dans une époque (la ruée vers l’Ouest) qui est loin d’être ma préférée. Le livre est écrit de manière intelligente et vraisemblable. Ce roman historique remet les pendules à l’heure sans verser dans la grandiloquence et le fantasque hollywoodien. Il nous plonge dans ce combat d’idées où les pistolets ne sont pas les seuls à porter des coups. Il est humain et à la fois cruel dans ce qu’il dépeint.
Afficher en entierAprès mon coup de cœur pour Rouge, c’est naturellement que je me suis penchée sur la bibliographie de Pascaline Nolot dont la plume m’avait envoutée. Mon choix s’est arrêté sur Éliott et la bibliothèque fabuleuse, un livre jeunesse promettant magie et dépassement de soi. Encore une fois, je n’ai pas été déçue par ma lecture.
Poursuivi par les sbires de l’infâme Charlie, Éliott se réfugie dans l’antre de la bibliothèque pour leur échapper. Fatigué par ce rituel postscolaire, il s’endort jusqu’à l’heure de fermeture. À son réveil, il surprend la vie secrète de l’endroit et l’existence de La Brigade des Rats de Bibliothèque, une société qui règle des problèmes propres au monde littéraire. L’affaire est portée devant le tribunal de l’organisation et l’enfant doit accomplir trois missions pour expier son crime. Lors de la première tâche, il rencontre L’indispensable guide de survie du souffre-douleur qui lui glisse à chaque fois entre les mains comme un savon mouillé. Or, il désire l’attraper et le lire à tout prix !
Dès l’ouverture du roman, l’autrice dessine le contexte de départ et les personnages avec brio. Elle introduit la magie en quelques pages avec naturel. La fluidité et le dynamise de sa plume colorée m’a de suite happée dans cette mise en bouche décrivant le quotidien horrible d’Éliott qu’elle contrebalance par des épisodes rocambolesques à croquer comme du chocolat. Dans Rouge, elle m’avait déjà épatée par son adaptation aux langages des villageois rustiques et anciens. Ici, elle use du champ lexical du monde littéraire pour métamorphoser ou employer des expressions qui respirent l’amour de la langue française et des livres. D’ailleurs, si l’univers emprunte le chemin des agents secrets, il n’y a aucune arme farfelue (mise à part peut-être les crayons-lasers), juste des bouquins qui nous sauvent en nous permettant de nous évader le temps d’une lecture et de nous prendre pour des héros.
Éliott est ravi de pouvoir vivre de folles aventures comme son héros favori, Georges Padenom. Ce petit garçon adore lire et désire échapper à la méchanceté de Charlie. Bien que la fuite constitue sa meilleure méthode, il n’est pas dénué de courage et n’hésite pas à sauter dans l’extraordinaire auprès de Caleb, bibliothécaire-rockeur le jour et directeur de la BRB le nuit, ainsi que l’intraitable Maaaow (M. Chat pour ceux qui sont incapables de prononcer son prénom correctement).
Inflexible sur le règlement, ce matou (directeur adjoint de la BRB) intente un procès à Éliott pour l’évincer en vain malgré l’avocat fantôme amnésique dont il l’affuble. Peu à peu, l’enfant découvrira les raisons de sa haine des humains. Derrière son côté impitoyable se cache un cœur droit qui déteste l’injustice.
Le thème principal du roman se centre sur le harcèlement scolaire qui touche les enfants, même à un jeune âge. Éliott n’a que dix ans ! L’écrivaine aborde la notion de honte que ressentent, non pas les bourreaux, mais les victimes. Une triste réalité. Ce sentiment qu’aucune victime de violence ne devrait subir ! Le comportement inadéquat des adultes est également évoqué : les œillères que les professeurs et les parents posent d’eux-mêmes, car les brimades et leurs conséquences doivent rester dissimulées sous prétexte que ça ternit la réputation de l’école pour les premiers et qu’il est impossible que la vie de sa progéniture soit aussi pourrie dans la vision des seconds. On imagine toujours que ça n’arrive qu’aux autres.
Vous l’aurez deviné, j’ai adoré ce livre. Si je devais vraiment lui trouver une faiblesse, ce serait l’absence de raisons derrière le comportement de Charlie. Globalement, on n’apprend pas grand-chose d’elle. Pourquoi est-elle si méchante ? Mystère. Ce choix reste compréhensible, car l’autrice a préféré se focaliser sur le pouvoir d’Éliott et de ses victimes qui se croient faibles alors qu’iels possèdent pourtant un courage, une force et une confiance insoupçonnés. Le pouvoir d’user des mots, de délier la parole pour retourner la situation en sa faveur. De faire soi-même le premier pas vers la liberté de vivre sans maltraitance. D’agir de telle façon que les autres, les spectateurs finissent par s’unir pour arrêter la machine de la violence qu’ils détestent aussi.
" je ne suis pas magique : seuls les mots le sont…"
En bref, Éliott et la bibliothèque fabuleuse est une pépite. Basé sur un thème tabou et malheureusement trop répandu, ce roman jeunesse fantastique désamorce cette bombe avec intelligence et brio. Il est à mettre dans beaucoup de petites mains pour montrer que l’espoir existe. Pas seulement dans l’imagination, mais aussi enfoui dans les tréfonds de nos cœurs.
Afficher en entierQuatrième lecture du partenariat avec Les plumes de l’imaginaire, Le codex de Paris est le premier tome de la série Paris des limbes dont l’intrigue prend place, je vous le donne dans le mille, la capitale française.
Germain Dupré possède un cabinet d’enquêteur dans la cave d’un bâtiment haussmannien et un secret que seul le gang de Mathieu connait : c’est un vampire. Lorsque Nadine Leroy lui demande de retrouver son mari qui s’est enfui avec un précieux codex, il ne s’attendait pas à renouer avec son passé, le moment où sa vie a basculé ni aux alliances qu’il se trouve contraint de signer.
L’autrice nous plonge illico presto dans l’ambiance des venelles sombres de Paris dès les premières lignes. Truand et désinvolture se mêlent grâce au choix précis des noms de rues, la façon de parler de notre vampire ou les termes dépeignant la mise en scène. Cette atmosphère laisse ensuite place à la rencontre légère et drôle entre Germain et sa copropriétaire, Romane. Le récit alterne entre ces deux mondes et m’a rappelé au début les histoires de détectives privés des années 1950, les cigarettes et le côté macho en moins. Comparaison qui s’arrête assez vite dans le déroulement.
En effet, si notre vampire se lance dans une enquête classique qui consiste à interroger l’associer du disparu, celle-ci avance par la suite grâce à la magie plutôt qu’à découverte d’indices, à la déduction et au flair du limier. Ensuite, les attaques-surprises prennent la relèvent pour aider le développement de l’histoire. Ainsi, Le codex de Paris n’est pas à considérer comme un polar surnaturel bien ficelé, mais bien un récit fantastique saupoudré de polar. Par ailleurs, l’objectif de Germain dévie rapidement de la cible de sa cliente, lorsqu’il apprend la nature du grimoire.
Le roman présente une belle dentition (désolée pour le jeu de mots de bas étage) de personnages principaux comme secondaires. Son assurance, Germain Dupré la doit aux siècles qu’il a traversés depuis sa métamorphose. La sagesse acquise au fil de ses (més)aventures lui permet de se fondre parmi les humains et d’éviter d’être démasqué. Cependant, la confiance en ses capacités lui a tout de même joué un tour et précipité dans les crocs du magnat de la drogue, Mathieu, dont il souhaite se libérer, tout comme il a réussi à bannir ses penchants de vampire grâce à l’avancée médicale. Oui, notre détective déteste plonger ses canines à la source pour épancher sa soif de sang et tuer les humains en raison de….Bon je ne vais pas trop en dire non plus.
De prime abord, Romane incarne l’étudiante joyeuse qui garde le courage d’avancer malgré la perte de ses parents. Yogiste et fervente protectrice des animaux, elle horripile et attendri Germain à la fois par son caractère rayonnant et sa solidarité. Néanmoins, tout soleil possède son ombre et celle de la jeune femme va se révéler plutôt inattendue dans ses conséquences. Son secret sera bien utile à notre vampire. Les actions de Romane vont prouver sa détermination et ses paroles justes dans ce monde qui induit un comportement paradoxal aux humains.
— Vous vous êtes associée à cette abomination en connaissance de cause ? s’exclama le frisé. Qu’êtes-vous ?
— Ouverte d’esprit, fit Romane.
Zagan est un démon superhéros. Bon OK pas totalement : il désire empêcher l’arrivée de l’apocalypse surtout pour préserver les Enfers. Le sauvetage de l’humanité n’est donc qu’une cause collatérale de la mission qu’il veut accomplir à tout prix. Pourtant, il reste honnête pour un démon. Je l’apprécie beaucoup, voir plus que Germain qui, en dépit des centaines d’années passées sur terre, garde une certaine naïveté envers les gens issus de la caste qu’il a fréquentés dans sa jeunesse.
Dans les personnages secondaires, je vais uniquement en évoquer deux. Sofia, la médium, car elle a une répartie incroyable. Je l’ai tout bonnement adorée et sa réserve, voire sa méfiance par rapport aux démons, ne m’a pas du tout rebutée. Chaton ! Ce matou qui s’échappe du sac de Romane et trouve refuge dans le bureau de Germain apparait peu et n’a pas un énorme impact dans cette histoire, mais…c’est un chat et je suis faible devant eux.
La plume de la romancière est fluide et colorée, comme déjà citée ci-dessus. Parfois, elle utilise trop de répétitions, mais cela ne m’a pas empêché d’apprécier ma lecture. Son humour est un véritable délice avec des répliques et des punchlines à tomber. De plus, elle va au fond des choses dans son récit, en transformant Germain en guide touristique de Paris, mais aussi en incluant un point qui m’est cher de par ma formation. En abordant le début de l’enquête sur le vol d’une antiquité, elle met l’accent sur l’importance de la conservation des objets d’art c’est-à-dire la régulation des conditions hydrothermiques du milieu afin que l’œuvre traverse le temps en ralentissant sa détérioration un maximum. Cela peut vous paraitre bête. Toutefois, c’est un élément qui m’a touchée, car trop de personnes pensent que la manière de manipuler ou de ranger un témoin du passé est sans importance.
En bref, Le codex de Paris fut une lecture divertissante. Si je m’attendais au départ à une enquête relevant plus de la recherche d’indices qui nous emmènerait dans les tréfonds de la magie, je n’ai, pourtant, pas été déçue du voyage grâce aux personnages nuancés qui amènent des visions justes et réelles de notre existence qui ne repose pas toujours sur la belle logique que notre société nous dépeint. La ligne entre le bien et le mal est plus floue que l’on ne le pense, et les choix sont souvent bien plus difficiles que cette simple question manichéenne.
Afficher en entierLes Larmes de Saël est ma troisième lecture du partenariat avec Les plumes de l’imaginaire. Pour rappel, il s’agit d’un groupe sur Facebook rassemblant des autrices autoéditées ou hybrides qui s’allient pour promouvoir leurs romans et échanger avec les lecteur.rices. N’hésitez pas à nous rejoindre. Ce roman fait partie d’une saga en trois tomes. Toutefois, il peut se lire comme one-shot. En effet, l’écrivaine n’avait pas prévu d’en faire une série et malgré la fin, il se déguste très bien en solo.
Arcana réside dans la ville prospère de Ceylan protégée du monde extérieur par un bouclier. L’air, les températures, les énergies sont mesurés au millimètre près pour en faire un havre de paix où les habitants puissent vivre sans crainte. À l’approche de l’âge adulte, elle ne sait toujours pas ce qu’elle souhaite pour l’avenir. Ce choix lui est enlevé par trois faits : son père qui veut la marier, l’explosion qui endommage le cœur de Ceylan et le jugement des terroristes devant la population. Mues par ses envies de liberté, elle s’engage à épouser avec Ashkan selon les lois à l’étonnement de toute la citée. Leur union à peine célébrée, ils sont expulsés à Saël. Arcana va devoir apprendre à survivre dans ce Nouveau Monde aussi austère que galvanisant.
A.D. Martel propose un univers mêlant le post-apocalyptique et la fantasy orientale. On comprend qu’une catastrophe et des guerres ont propulsé la terre à l’époque où se déroule le récit. Mis à part Ceylan et Saël, on ne sait rien des contrées alentour. Et pour cause, les citoyens de la première ville demeurent à l’intérieur d’une bulle de protection contrôlée dans sa globalité et possédant une technologie avancée. Les connaissances d’Arcana découlent uniquement de ses professeurs et du gouvernement. C’est pourquoi, elle va débord découvrir Saël à travers ses préjugés qui vont tomber au fur et à mesure qu’elle appréhende le territoire et son fonctionnement empreint d’orientalisme rustique avec son soleil de plomb et le clanisme, mais aussi la signification à la fois terrible et belle des larmes de Saël.
Vous l’aurez compris, les deux nations sont l’opposée l’une de l’autre. La prospérité de Ceylan est contrebalancée par un système politique profondément patriarcal, qui régule le quotidien et la vie de ses citoyens par des mesures strictes telles la loi de l’enfant unique et la gestion des cultures raisonnées. Toutefois, la cité exploite la denrée la plus précieuse avec excès : l’eau. Leur technologie repose entièrement sur elle. Chacun possède un bracelet, une sorte de montre connectée, qui permet de contacter ses proches, prendre des notes ou activer les passerelles entre la basse et la haute ville. Il s’agit d’un outil de dépendance dont Arcana arrivera à se priver sans trop de mal.
Saël, quant à elle, a une politique presque matriarcale. Je dis presque, car les hommes ont un pouvoir décisionnaire conféré par leur statut spécial et involontaire. Le peuple vit en tribus sous la tutelle d’une assemblée d’anciennes. La vie ou plutôt survie est archaïque, la technologie n’existe pas et l’eau est précieuse.
Arcana se retrouve donc confrontée à un changement radical suite à sa décision d’épouser Ashkan et sa naïveté ainsi que son égo démesuré. Cette prétentieuse fille de conseiller possède une haute estime d’elle-même et un caractère fort. Je crois n’avoir jamais rencontré un pareil personnage au cours de mes lectures. Durant le premier chapitre, je ne l’appréciais pas du tout. Dès le deuxième, je l’ai adoré, adoptée. Pourtant, elle revêt toujours son côté princesse aux penchants superficiels et capricieux, mais sa soif de liberté et son courage pour se dresser face à l’adversité (son père représentant l’autorité parental et gouvernemental pour son statut), puis les politiciens, m’ont tout de suite subjugués. Aucune incohérence ne se glisse dans son personnage. Son caractère fort se révèle nuancé et logique, bien qu’elle pèche aussi par orgueil. D’ailleurs, la confiance en ses capacités va en prendre un coup quand elle se rendra compte qu’on la manipule. Malgré cela, elle ne baissera jamais les bras. Elle évoluera au fil de ses contacts avec sa nouvelle famille dont les relations sont tendues au début et des habitants de Saël. Les erreurs parcourent son chemin d’apprentissage et d’intégration. Erreurs qu’elle n’avouera pas toujours à haute voix, mais qu’elle prendra à cœur de réparer. Un comportement bien plus efficace qu’une faute confessée, d’autant plus qu’il reste cohérent avec sa personnalité et lui confère une part d’ombre réaliste.
Les autres protagonistes sont tout aussi profonds et nuancés, surtout les féminins que j’adore. Commençons par les masculins : Ashkan est ténébreux est intriguant. Toutefois, son côté bougon et ses problèmes de communication m’ont un peu refroidie. Son petit frère, Zachary est l’exact opposé grâce à sa douceur, sa compréhension et cette timidité adorable. Donya est la matriarche du clan. Sa langue ferme et sévère convient aux vieilles femmes qui doivent porter l’honneur et le respect des leurs, en dépit des années et de la méchanceté qu’elles ont vécues. Enfin, nous avons le troisième membre de la famille, la mutique et espiègle, Mina, qui se révèle touchante derrière la solitude qu’elle subit en raison de sa différence.
L’autrice aborde de nombreux thèmes et les consolide grâce à son savoir d’historienne. Elle emploie la fameuse gloire des vainqueurs qui embellissent leur victoire en dissimulant leurs exactions et leurs horribles stratégies. Dans le roman, chaque détail a son importance, même ceux qui semblent les plus anodins comme les sculptures du ministère de Ceylan. L’endormissement de la population sous couvert de bien-être, l’assouvissement des femmes, mais aussi des hommes. Elle opère un inversement plus qu’intéressant, je vous laisse découvrir de quoi je parle, car je n’ai pas envie de spoiler.
En bref, A.D. Martel m’a conquise avec ce premier tome qui a grignoté mes heures de sommeil. Les larmes de Saël nous plonge dans un univers oscillant entre science-fiction et fantasy orientale teinté des couleurs de l’importance de l’intégration dans une nation étrangère, l’ouverture d’esprit, le féminisme et le respect.
Afficher en entierLes zombies n’ont jamais fait partie de mes créatures préférées qu’ils soient classiques ou modernisés comme ce fut le cas dans les nombreux films des dernières décennies qui les ont mis à toutes les sauces. Néanmoins, le roman de Céline Saint-Charle a réussi à attirer mon œil grâce aux chroniques (dont celle d’OmbreBones) qui le présentaient comme atypique dans sa finalité.
Sandra vit et travaille dans le ranch familial. Adorant sa fratrie, elle renonce à une virée shopping pour aider son frère Tom qui essaye sa dernière invention pour acheminer le purin et l’urine des bovidés sur les champs afin de les fertiliser. L’opération s’avère être un succès quand le Shérif Perkins surgit dans son 4×4 avec l’intention d’emmener l’un des employés qui aurait sauvagement assassiné son épouse d’après les propos d’un témoin. C’est là que tout dérape. Recouverte de déjections animales, Sandra se retrouve menottée à Perkins métamorphosé en zombie. Un long périple à travers le Texas au milieu d’une horde de morts-vivants l’attend.
Si la mise en place du contexte initial reste classique avec l’attaque de macchabées affamés de chair humaine, le récit prend progressivement la tangente pour devenir un road trip des plus conventionnels à condition d’omettre la nature cannibale des compagnons de route de Sandra. D’abord, mue par un instinct de survie engendré par la peur de finir dévorée, la jeune femme appréhende leurs comportements. Peu à peu les préjugés issus de l’imagination humaine laissent place à une réalité déconcertante puis presque enivrante.
Ce changement d’opinion s’opère en parallèle de la propre déchéance du personnage principal qui traverse des étapes de régression vers un état de besoins primaires qui transgressent les bonnes manières et qui la met d’une certaine façon au même niveau que les zombies. Sandra incarne alors le survivalisme par l’adaptation et l’intégration avec une vision à long terme tandis que d’autres humains ne vivent plus qu’au jour le jour consommant les denrées et produits seconds comme l’essence sans se préoccuper du après.
Au cours de ses pérégrinations, elle remarque avec horreur les vestiges de la bêtise de ses semblables sur les lieux désertés avant d’y être confrontée en temps réel. Dans ce monde d’apocalypse, certains déchaînent leurs vices et reproduisent l’avilissement, l’esclavage sexuel sur les femmes et encore pire selon leur degré de santé mentale ou de psychopathie.
Les zombies se révèlent quant à eux plus solidaires. Quand Sandra se rend compte du rôle qu’elle peut jouer dans la naissance de cette nouvelle ère, cette civilisation destinée à prendre le relai sur terre, elle s’y implique à fond comme une bergère guidant son troupeau et incarne la justice de l’Apocalypse (d’où le clin d’œil biblique du titre).
Le roman oscille entre frissons, répliques cyniques et douceur. La plume de Céline Saint-Charle est fluide, dynamique et immersive. Elle arrive à construire des ambiances mixtes où l’horreur et l’humour se côtoient avant de fondre vers une normalité dérangeante étant donné que mon cerveau s’amusait à me rappeler l’aspect anthropophage des zombies et le fait qu’à tout moment les choses peuvent basculer en raison du processus d’apprentissage. Notre héroïne reste humaine après tout.
En bref, L’Apocalypse selon Sandra est une utopie, ou plutôt un road trip qui s’en rapproche. Le roman apporte une vision drastiquement différente des bouquins post-apocalyptiques même s’il en reprend certains éléments comme la déchéance d’une partie de la population qui n’arrive pas à évoluer malgré sa destitution du sommet de la chaine alimentaire et qui recourt à la domination. L’épouvante sanglante propre à toute histoire de zombie disparait en quelques chapitres au profit d’un récit touchant abordant la tolérance et la solidarité.
Afficher en entierL’annonce d’une jeune autrice de la part d’une maison d’édition que j’apprécie beaucoup ne pouvait que titiller ma curiosité. Écrire une saga à 13 ans au point que celle-ci soit publiée ! Le rêve de toute personne qui désire devenir auteur.rice. À la lecture du résumé promettant orphelin, surnaturel et course-poursuite dans la capitale belge, je ne pouvais qu’assouvir mon appétit de découverte.
À 12 ans, James Holt n’a connu que l’orphelinat Saint-Victor qu’il déteste au plus haut point. Surtout sa directrice Madame Reybard qui l’enguirlande, ses amis et lui, à la moindre respiration. De plus, il soupçonne que sa haine est tellement forte qu’elle le dénigre auprès de chaque parent adoptif potentiel. James vit donc une vie normale d’adolescent en crise contre les adultes, jusqu’au jour où des événements étranges se produisent dans l’établissement. La crainte et son envie de rébellion le poussent à accepter la proposition de son pote William. Une nuit, ils fuguent ensemble vers la liberté. Enfin, c’est ce qu’ils croyaient, car l’aventure va les entraîner d’une folle course-poursuite vers les mains de la destinée de James.
Le roman commence par un prologue relatant l’explosion du vaisseau La Martas due un monstre conférant tout de suite sa couleur au récit. Ensuite, celui-ci se déploie sous la forme de courts chapitres centrés sur le quotidien de James et ses camarades jusqu’aux fameuses révélations promises dans le titre, ainsi que le rebondissement final qui prépare le terrain du second tome.
L’univers de James Holt est bien ficelé, même s’il ne comporte pas beaucoup de surprises scénaristiques. J’utilise ce mot issu du cinéma, car l’image globale que j’ai du texte ressemble à un film d’action dans lequel les respirations sont peu nombreuses. Le début m’a paru de prime abord scolaire. L’autrice y dépeint en quelques chapitres la pléthore de personnages et brosse la situation initiale en quelques coups de descriptions. Dès le départ, on remarque que les dialogues sont maîtrisés, mais j’ai ressenti un manque d’ambiance pour être réellement prise dans l’histoire. Cependant, cette impression disparaît quand la fugue, et donc l’action, arrive. Aline Godefroid déploie une plume fluide qui joue avec le rythme et les mots pour construire des scènes mêlant tensions et acrobaties avec brio. On voit qu’elle a passé des heures à travailler cet aspect jusqu’à faire sien ce genre.
Par contre, il s’agit aussi de sa faiblesse, si je puis le dire ainsi. Au moment où la course-poursuite démarre, on s’arrête peu, voire pas du tout pendant presque une centaine de pages, créant un manque de respiration pour le lecteur et un rythme identique sans fluctuation, un peu comme le Boléro de Ravel ou la musique de Game of Thrones qui répètent inlassablement les mêmes notes. Le peu de changement n’apporte pas assez de relief à mon goût et empêche l’évolution des personnages auxquels je n’ai pas réussi à m’attacher.
Pendant le passage de la fuite, James est confronté à plusieurs révélations que je ne vais pas lister ici pour ne pas en dire trop. L’une d’elles est sans doute la plus déstabilisante pour lui étant donné qu’il s’agit de la véritable identité de son meilleur ami. Quand celui que vous connaissez depuis toujours vous avoue une telle chose, il me semble que tout adolescent se poserait des questions ou douterait en partie de la bonne foi de cet allié qui vous a menti. Pareil pour ces nouvelles capacités qui se déclenchent de façon aléatoire et dont il ne semble pas craindre une seule fois la puissance. James n’a pas le temps de cogiter. Et, c’est comme ça pour à peu près tout ce qui se produit. Il accepte tout sans rechigner, un peu trop pour un adolescent en pleine rébellion selon moi.
On passe ainsi de la situation A au point B sans ressentir son évolution ou la vivre. Je n’ai pas réussi à m’attacher aux autres protagonistes non plus, particulièrement en raison de l’incohérence entre la description initiale racontée par la romancière et les lignes de dialogues et d’action qu’elle leur prête. Je pense notamment à Sophie qui est censée être timide au point de parler très peu, mais qui s’ouvre sans difficulté. Je sais qu’elle le fait devant ses amies et que ça peut se justifier, mais ses quelques apparitions ne m’ont jamais montré ces caractéristiques-là. Je pense que le contexte du départ aurait peut-être dû être développé un peu plus, le temps d’ancrer les acteurs plutôt que de les esquisser en quelques mots.
Un autre élément qui m’a dérangée est le côté unidimensionnel des personnages de l’histoire. Ils ont peu de nuances, voir pas du tout. Les méchants sont simplement mauvais et certains relèvent du cliché, comme la cruelle régente de l’orphelinat. Il y a bien un protagoniste qui m’a plu avant de m’ennuyer par sa continuelle folie. Il s’agit de Roxane. Déterminée à atteindre son but, elle n’hésite pas à martyriser et à jouer avec James et William comme un chat le ferait avec une souris. Au départ, j’aimais beaucoup son côté badass et son cynisme, mais le manque de nuance a fini par me lasser. Même son background ne m’a pas convaincu, tout comme celui de William qui n’a pas réussi à m’émouvoir. De nombreux personnages sont également très forts, ce qui empêche une identification qui, pour moi, est primordiale dans un roman jeunesse.
L’autrice y aborde des thèmes étonnamment matures. À travers les extra-terrestres, elle dépeint un reflet de notre société. Ceux-ci se croient évolués contrairement à notre espèce qui ose utiliser encore ses cordes vocales pour communiquer. Pourtant, leur civilisation repose sur un système de caste. Les Mylosiens en bas de l’échelle, sont bien entendu des renégats, des déchets que les « bons » aliens gardent par pure bonté. Étrangement, ils dégagent plus d’animosité et de barbarie primitive que les humains malgré leur technologie avancée.
Elle parle également de la gestion de la crise de l’adolescence qui est au cœur même de son récit. Les changements ressentis dans son corps symbolisés par la naissance du pouvoir de James, la recherche de sa propre identité (surtout quand on ne sait pas d’où on vient, mais aussi une fois que l’on connait ses racines) et la gestion des émotions fortes qui bouillonnent et font sauter le couvercle de la casserole avant de manière impromptue.
Révélations possède ainsi une richesse insoupçonnée, portée par une plume solide, mais inégale. Aline Godefroid captive par son habilité à dompter l’action et le genre dans lequel elle écrit. Elle mélange les tropes de la science-fiction et s’amuse à y distiller des éléments des mythologies grecques et égyptiennes pour construire son univers.
En bref, le premier tome de James Holt est un livre jeunesse plein de promesses malgré les faiblesses qui y transparaissent. Au cours du récit, l’autrice démontre son travail acharné pour appréhender cette discipline ingrate qu’est l’écriture d’un roman. Si le dosage entre révélations et actions ainsi que le manque de substance des personnages ne sont pas encore maîtrisés, la qualité de sa plume reste indéniable et j’ai hâte de voir si ses efforts porteront ses fruits dans le second opus.
Afficher en entierLa porte des Rois démons est un roman de fantasy de Mariann Helens. J’ai lu cette autoédition dans le cadre du partenariat avec Les plumes de l’imaginaire. La série La Compteuse d’âmes devrait dénombrer quatre livres.
Lorsque la nuit plonge sur le patelin d’Ibma, elle apporte les Creux. Des êtres sans âme qui mordent les humains pour agrandir leur troupe. Mesha se laisse surprendre et prend la fuite à la suite d’un combat rudement mené. Le lendemain, elle retourne dans le village pour subtiliser vivres, biens et têtes décapitées. Les premiers pour survivre, les dernières pour les rapporter à Galore afin que le mage puisse les examiner. Les Creux ont une origine mystérieuse. Depuis des siècles, leurs attaques se calquent sur un même schéma. Sauf que cette nuit change la donne. Plus nombreux, ses monstres désincarnés et aveugles semblent voir Mesha alors qu’aucune peur ni trace de sang frais ne la recouvrent. En chemin vers Ardeville, la mercenaire fait la rencontre d’Ascelin Brocardier. L’un des survivants de l’attaque d’Ibma, qui garde bien des secrets sur sa véritable identité.
L’univers de La Compteuse d’âmes se calque beaucoup sur notre Moyen-âge et la Renaissance en ce qui concerne la situation géopolitique. Nous sommes à une époque durant laquelle la religion patriercane a remplacé les anciennes croyances qu’elle enterre à coup de prosélytisme, de tortures et de bûchers. Vous noterez l’utilisation de la racine identique au mot patriarcat sur lequel l’autrice a basé cette religion. En effet, celle-ci est profondément misogyne. Les prêtres peuvent pratiquer la magie, mais quand une femme l’emploie, on l’accuse de sorcellerie et de servantes des démons. Vous voyez le topo. Les puissances magiques reposent sur un système bien pensé sur lequel je ne vais pas m’attarder. Je vous laisse le découvrir lors de votre lecture.
Lors des allocutions des moines, les citoyens et citoyennes sont séparés. Les hommes entendent en premier les paroles saintes, viennent ensuite celles offertes aux femmes. La romancière met donc en exergue l’obscurantisme à travers son livre en le renforçant et en le dénonçant grâce aux échanges de Mesha et d’Ascelin qui représentent la tolérance et l’ouverture d’esprit.
Les Anciens Dieux pourraient bien être à l’origine du mal qui va bientôt se déverser sur le monde des humains. Le récit de La porte des Rois démons fait office de préambule qui dépeint le contexte imaginé par Mariann Helens. Elle décrit son univers et sa mythologie passée et présente de long en large, ce qui donne quelques longueurs à ce premier roman. En effet, l’élaboration du suspense n’est pas maîtrisée, car beaucoup de nœuds d’intrigue et révélations sont prévisibles pour les lecteurs aguerris de fantasy. L’enjeu majeur apparait au début et ne subit son évolution qu’à la toute fin. Entre les deux, le récit se déroule en combats et discussions pour expliquer l’univers. L’absence de sous-trame, d’histoires parallèles (propre au tome un, j’entends) au fil conducteur global de la trilogie m’a dérangée, car je préfère les séries plus fournies en rebondissements. De plus, le manque de suspense a fortifié cette impression de faiblesse. L’écrivaine distille bien quelques mystères au cours de son récit, mais j’en ai vite compris l’issue. Par exemple, le secret de Mesha m’est apparu dès les premières pages lorsqu’elle est dans la taverne à écouter les deux paysans.
Malgré cela, j’ai apprécié ma lecture pour diverses raisons :
Mesha et Ascelin sont des personnages hauts en couleur. La mercenaire n’a rien d’une héroïne d’épique fantasy. Elle fuit dès qu’elle peut le village d’Ibma au lieu de tout faire pour le sauver. Elle a une vision de la vie qui oscille entre réalisme et pessimisme. Du coup, elle évalue les situations et les stratégies en n’omettant jamais les conséquences désastreuses qui pourraient en découler si elle défaillait. Néanmoins, elle ne renonce jamais à poursuivre son but et elle hésite peu à recourir à des méthodes brutales.
Ascelin est l’archétype du bourgeois gentilhomme bien élevé dont la vie a basculé. Il est doux, attentif et fait preuve d’une curiosité immense. Son intérêt et son sens de l’honneur ouvrent peu à peu le cœur de sa compagne de route avec laquelle il va se lier d’amitié en dépit de son passé. De prime abord, il pourrait paraître trop lisse, mais plus on pénètre dans son intimité et dans son âme plus on y voit une sorte de… fanatique d’un autre genre.
La plume de l’autrice est fluide et agréable à lire. Elle maîtrise la technicité des combats et de la verve médiévale. Le vocabulaire est précis sur l’armement et la façon de donner les coups. Cela démontre une grande recherche de sa part. Certains passages possèdent un peu trop de répétitions à mon goût. Certaines descriptions m’ont parue superflues, car elles n’ont pas d’impact dans l’histoire. Par exemple, celle des fortifications et des ponts étroits d’Ardeville dont elle appuie la puissance défensive longuement. Je m’attendais à une scène qui s’y déroulerait par la suite sans avoir à répéter l’aspect insaisissable de la place en brisant l’action au vu du soin que l’autrice prend à l’ancrer en nous. Cependant, on n’y retourne plus.
En bref, La porte des Rois démons, est un premier tome qui jette les bases d’une histoire qui aura sans doute plus d’éclat dans le second opus. En dépit de son classicisme, de sa linéarité et du manque de suspense, j’ai adoré la cristallisation de la misogynie du christianisme à travers le nom et les principes de la religion patriercane, ainsi que les personnages attachants et nuancés que sont Mesha et Ascelin.
Afficher en entier





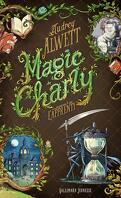

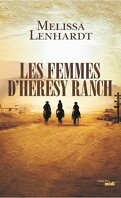

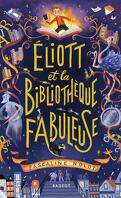










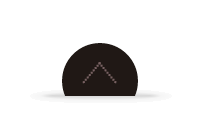
Bruno adore la corrida. À l’une d’elles, il s’en prend à une militante qui s’est introduite avec ses compagnons dans l’arène pour empêcher le massacre des taureaux. Malgré sa violence, elle réussit à le maudire avec ses pouvoirs de médium. Bruno passe de l’autre côté de la muleta. Il devra combattre les hommes pour réintégrer son humanité.
Alegría c’est le genre de roman, défendant une valeur, qui pose une question : qu’est-ce qu’il va m’apporter quand on partage le point de vue de l’auteur ? La finalité, on la connaît dès le départ. On sait vers quoi il va nous amener : l’ouverture d’esprit du protagoniste, la révélation qui le fera basculer après l’expérience dans la peau d’un Toro.
Je n’ai pas lu ce livre pour me repaitre de la douleur de Bruno, l’horreur et les tortures qu’il va connaître. J’ai beau avoir mon côté psychopathe, je n’entre pas dans la catégorie des gens malsains qui prônent des idéaux et applaudissent la crucifixion des violents, des opposants. En fait, je ne saurais dire ce qui m’a attiré vers lui en dehors du thème et de la magnifique couverture exécutée par Aurélien Police ainsi que la valeur sûre qu’est Livr’S éditions pour moi. Je ne regrette pas ma lecture pour plusieurs points que je salue.
Non seulement l’auteur a fait un travail de documentation remarquable et globale qui se ressent avant même de lire la bibliographie à la fin. Il s’est renseigné autant chez, mais en plus, j’ai appris une chose qui m’a complètement scotchée : la corrida existe en France et celle-ci est légale. Croyant débarqué en Espagne, j’ai dû relire deux fois un passage qui donnait des indices sur la localisation de l’intrigue. Localisation enfoncée à coup de sabot dans mon esprit en relisant la loi retranscrite en note de bas de page.
Ensuite, le personnage de Bruno a écartelé mon cœur qui ne savait pas dans quelle direction aller tant Alex Mauri lui a insufflé une dualité paradoxale et, pourtant, si humaine. Bruno est procorrida à 200 %. Il idéalise le taureau en fier combattant qui meurt avec panache. Pour lui tradition justifie la violence alors qu’il considère celle sur d’autres animaux (exemple : les chiens) d’horrible. Chômeur depuis son burn-out et divorcé, il incarne le gars à la révolte introvertie. Il crache sur pas mal de monde, mais hoche la tête devant ces mêmes personnes. C’est le cas de son ex-belle famille chez qui il se rend pour l’anniversaire de son fils, Quentin. Il ne peut encadrer son beau-père qui se moque de ses employés qu’il écrase sans vergogne. Enfin, Bruno est un père incroyable. Ouvert d’esprit sur certains points, il se réjouit de la margnilité de Quentin. Il fait de la pâtisserie avec lui et prend soin de lui, le chéri, bref agit comme un papa devrait le faire. Vous comprendrez pourquoi j’ai eu des difficultés à voir en lui uniquement un connard vulgaire et pourfendeur de taureau. Son évolution m’a également clouée sur place, car l’écrivain évite la facilité et colle parfaitement à la mentalité de son protagoniste.
Alors que Bruno découvre l’envers du décor dans les élevages et l’arène, il reste orgueilleux. Aux portes de la mort, le rebelle introverti devient extraverti comme si la musculature et les cornes lui conféreaint la force et du courage. En mauvaise posture, il ne devient pas humble, il croit au contraire qu’il doit donner une bonne leçon à tous ces toreros de pacotilles.
La narration intrinsèque nous plonge dans son esprit, ses sentiments, ses constatations, ses frustrations, ses espoirs brisés, sa détermination. Vu qu’on suit Bruno, le style est brut, vulgaire, parfois violent, mais authentique. Les détails qui émaillent ce court roman sont juste saisissants. Ils colorent l’histoire tout en nous immergeant dans la brutalité de ce monde. J’ai particulièrement été impressionnée par la précision de la métamorphose. La description des sensations et des causes est chirurgicale.
En bref, Alegría fait partie de ces livres dont on est sûr d’apprécier les thèmes défendus, mais dont la lecture subjugue par l’habilité et l’ingéniosité de l’auteur à aller au-delà des carcans habituels. De mélanger l’inmélangeable. De teinter de gris son protagoniste principal, là où d’autres n’osent franchir les limites de la pureté et la noirceur quand il s’agit d’idéaux à défendre.
Afficher en entier