Jean Racine
Auteur
Activité et points forts
Thèmes principaux
Classement dans les bibliothèques
Quelques chiffres
Note moyenne : 6.92/10Nombre d'évaluations : 2 555
18 Citations 1 180 Commentaires sur ses livres
Les derniers commentaires sur ses livres

Andromaque est ma pièce de théâtre préférée, celle que je conseille toujours. Cela fait des années que je n'ai pas plongé dans cette tragédie, mais il m'arrive encore souvent d'y penser. Je me ferai peut-être une nouvelle relecture car, je dois bien l'avouer, j'aime me plonger dans ce genre de lecture.
Je trouve que le personnage d'Andromaque est une des grandes figures féminines de la mythologie grecque, elle porte et incarne dans un sens énormément de valeur. La plume et la poésie sont fluides, recherchées mais compréhensibles. Et comment ne pas mentionner les liens entre tous les personnages. Il y a quelque chose de captivant et beaucoup de thèmes forts sont abordés.
Afficher en entier
Quelle langue ! Comment ne pas s’extasier devant la beauté de la langue de Racine ? J’ai pris un véritable plaisir à savourer chaque vers, chaque tournure. Ce qui était d’autant plus agréable que la pièce est intéressante et accessible. Peu de personnages, des enjeux clairs et énoncés, de l’amour et de la rivalité, des liens de parenté difficiles, bref, tout pour captiver !
On a ici une pièce classique par excellence, qui ne mérite pas de grandes explications pour être comprise, et qui donne même envie d’aller se renseigner sur les personnages historiques. Sans compter la simple beauté du parler, c’est une pièce que je relirai avec plaisir.
Afficher en entier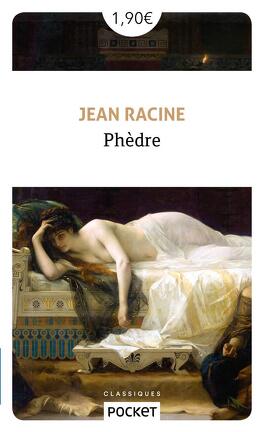
stepmom x stepson and it’s not a 🖤🧡 video
Afficher en entier
c'est un bon livre et très enrichissant mais l'humour est moindre mais l'histoire racontééest interessant et enrichissant
Afficher en entier
C'est un bon classique, facile à lire et rapide. J'ai apprécié le lire même si cela ne m'a pas passionné. Je l'ai plus lu par obligation que par ma volonté.
Sympa
Afficher en entier
Toujours un plaisir de lire du théâtre et celui de Racine ! Les tirades sont, certes, un peu longue mais remplies de poésie.
Afficher en entier
Lire que j’avais bien aimé sur le moment mais qui m’a pas marqué plus que ça contrairement à Antigone .
Afficher en entier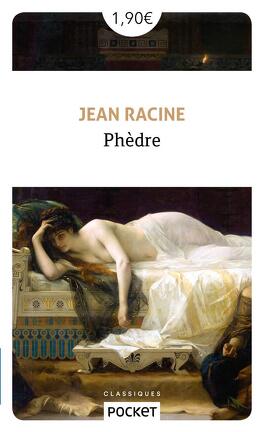
Cela faisait longtemps que je n'avais pas lu de pièce de théâtre et en particulier de tragédie ; et je doit dire que cela fait parfois du bien. Une belle plume, une histoire tragique où se mêlent passion, sentiments, trahisons. Bref un classique à lire !
Afficher en entier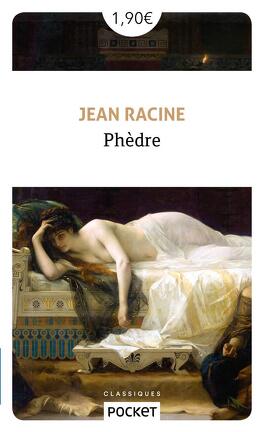
Phèdre, c'est inquiétant. Femme immorale, dégueulasse, menteuse, harceleuse, violeuse, pédophile, manipulatrice - pourquoi n'en dit-on rien dans nos explications de textes ?
Et dire que j'ai dû jouer un extrait de la pièce en classe. Fort heureusement, j'ai pu conserver ma dignité : j'ai eu le luxe de pouvoir incarner Thésée, son (pauvre) mari. En espérant que personne ne tombe jamais sur une telle femme dans la réalité.
Revenons-en à Phèdre. Non, n'y revenons pas. J'espère que la catharsis à l'époque a bien marché.
Afficher en entier
Racine sait bien écrire ses tragédies, celle ci est prise dans une spirale infernale: Oreste éprouve des sentiment pour Hermione, qui aime Pyrrhus qui lui est tombé éperdument amoureux de son esclave Andromaque qui veut rester fidèle à son défunt mari Hector.
La première fois que j’ai lu cette œuvre était pour les cours de seconde, bien évidemment ça ne me donnais pas envie. De plus, ce livre est assez compliqué au niveau de la langue car il est écrit avec d’anciens mots et les phrases sont tournés dans un ancien sens. Il faut le lire sans y être forcé sinon vous risquez de vous mélanger et d’abréger votre lecture sans comprendre le sens et l’importance des différents dialogues.
Afficher en entierOn parle de Jean Racine ici :
2018-01-01T12:42:09+01:00
2016-04-22T17:14:26+02:00
Les gens aiment aussi
Dédicaces de Jean Racine
et autres évènements
Aucun évènement prévu
Editeurs
Gallimard : 32 livres
Larousse : 26 livres
Hachette : 17 livres
Flammarion : 14 livres
LGF - Le Livre de Poche : 14 livres
Hatier : 7 livres
Pocket : 6 livres
Bordas : 3 livres




















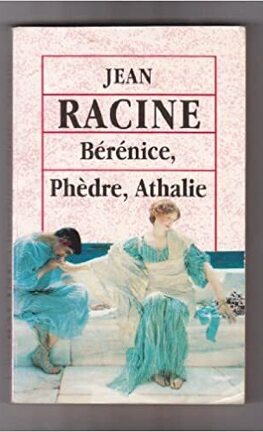




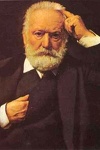




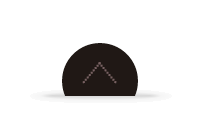
Biographie
Jean Racine, né à La Ferté-Milon le 22 décembre 1639 et mort à Paris le 21 avril 1699, est un poète tragique français considéré, à l'égal de son aîné Pierre Corneille, comme l’un des deux plus grands dramaturges classiques français
Né dans une famille de petits notables et d'écrivains : son père était procureur, son grand-père et son bisaïeul avaient été contrôleurs du grenier à sel de La Ferté-Milon et de Crépy-en-Valois ; l'on vit longtemps, sur la façade de la maison des Racine, rue de la Pêcherie, leurs armes parlantes : d'azur, au rat et au cygne d'argent. Orphelin dès quatre ans (sa mère décède en 1641 et son père en 1643), il est recueilli par ses grands-parents et reste chez eux jusqu'à la mort de son grand-père en 1649. Sa grand-mère entre alors au couvent de Port-Royal où Racine rejoint sa marraine qui y est religieuse. Ce malheur lui permet en fait de recevoir une solide éducation janséniste (courant moral du XVIIe siècle qui a connu son apogée à la fin du siècle et qui consiste à diviser les nantis de la grâce et ceux qui ne l'ont pas, on dit de Phèdre que c'est une « chrétienne à qui la grâce aurait manqué »...) aux Petites écoles de Port-Royal qui l'accueillent gratuitement. Il reçoit une large culture, comprenant la littérature et surtout l'apprentissage du grec et du latin. Il a pour maîtres les célèbres Pierre Nicole, Claude Lancelot et Antoine Le Maistre, ainsi que Jean Hamon. Cependant le théâtre y est très peu présent, car les Jansénistes le méprisaient.
À 18 ans, Racine est donc orphelin et pauvre, mais cependant il possède une très forte culture et il peut s'appuyer sur le réseau de relations des jansénistes. Il étudie alors la philosophie au collège d'Harcourt. L'enseignement qu'il reçoit est fondé sur l'étude de la Bible, de la rhétorique et des auteurs grecs et latins. Il découvre la vie mondaine grâce à un cousin qui habite l'hôtel de Luynes. Il écrit ses premiers poèmes. Dans un premier temps, il tente de concilier ses aspirations littéraires avec la carrière ecclésiastique, mais finalement, après un échec de cette dernière, il choisit de se consacrer entièrement à la littérature.
En 1660, il reçoit une pension du roi grâce à des odes : la Convalescence du Roi et la Renommée aux Muses et la Nymphe de la Seine.
En 1664, il est introduit à la cour, grâce à un poème à l'éloge de Louis XIV. Il fait enfin jouer l'une de ses pièces par Molière, la Thébaïde, la même année. Celle-ci n'a pas un grand succès.
En 1665, il fait jouer Alexandre le Grand qui est son premier succès. La pièce plaît notamment au roi, car elle est à son honneur. Elle est retirée à Molière pour être jouée par une troupe de comédiens plus prestigieux, à l'Hôtel de Bourgogne. C'est cette affaire qui entraîne une brouille définitive entre Molière et Racine.
Racine publie alors deux pamphlets contre Port Royal et ses anciens maîtres qui désapprouvent fortement sa carrière théâtrale, il se brouille avec Port Royal.
L'important succès de la tragédie Andromaque, placée sous la protection de Madame Henriette d'Angleterre, (1667) assure sa réputation. Après une unique comédie, les Plaideurs, en 1668, il revient définitivement à la tragédie et donne successivement Britannicus (1669), Bérénice (1670) (qui est l'occasion d'une joute théâtrale avec Corneille dont la pièce est : Tite et Bérénice. C'est Racine qui l'emporte indéniablement), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674) et Phèdre (1677). Ébranlé par les critiques et les cabales, Racine renonce au théâtre malgré le succès populaire de son chef-d'œuvre Phèdre. Membre de l'Académie française depuis 1673, Racine reçoit en décembre 1690 une charge de « gentilhomme ordinaire de Sa Majesté ». Il est également trésorier de France ce qui lui assure un revenu. Enfin il est nommé historiographe du roi en 1677, c'est-à-dire en même temps que Boileau. Racine décide de se ranger (il a eu de nombreuses maîtresses notamment parmi ses actrices : La du Parc, La Champmeslé) et épouse en 1677 Catherine de Romanet, qui lui donnera sept enfants. Il s'agissait d'un mariage d'intérêt.
À la demande de Madame de Maintenon, il écrivit encore pour les élèves de Saint-Cyr les tragédies bibliques Esther (1689) et Athalie (1691). Racine à l'époque est toujours hostile au théâtre vivant, mais il considère ces pièces comme des œuvres pédagogiques et poétiques.
Depuis 1666, Racine, attaqué sur ses mœurs et son théâtre par Pierre Nicole, s'était brouillé avec les jansénistes. Malgré les persécutions dont ils sont victimes, Racine se réconcilie avec eux. Il les soutient notamment dans leurs démêlés avec le pouvoir (Louis XIV leur étant hostile). Sa présence aux funérailles d'Arnauld en 1694 prouve la réconciliation de Racine avec ses anciens maîtres. Il écrit un Abrégé de l'Histoire de Port-Royal qui parut après sa mort. En 1696, il est nommé conseiller-secrétaire du roi, auquel il fait très souvent la lecture.
Racine meurt à Paris le 21 avril 1699, à l'âge de cinquante-neuf ans, des suites d'un abcès ou d'une tumeur au foie. Louis XIV accéda à la demande qu'il avait formulé d'être inhumé à Port-Royal, auprès de la tombe de son ancien maître Jean Hamon (après la destruction de Port Royal ses cendres ont été déplacées à l'église Saint-Étienne-du-Mont de Paris).
Afficher en entier