Voltaire
Auteur
 Né(e) le 1694-11-21
Né(e) le 1694-11-21
 ✟ 1778-05-30
( 83 ans )
✟ 1778-05-30
( 83 ans )
Activité et points forts
Thèmes principaux
Classement dans les bibliothèques
Quelques chiffres
Note moyenne : 6.46/10Nombre d'évaluations : 3 173
38 Citations 1 564 Commentaires sur ses livres
Les derniers commentaires sur ses livres

Une lecture intéressante mais loin d'être accrochante...
Afficher en entier
Ce recueil aux leçons de morales est intéressant à lire, surtout quand on connaît ce personnage qu’était Voltaire. L’Ingénu est une histoire qui vaut le détour.
Afficher en entier
Livre étudié pour les cours assez intéressant et simple de compression à la lecture
Afficher en entier
Livre d’aventure agréable, je le conseil aussi pour sa dimension philosophique, apportant un regard particulier sur le monde.
Afficher en entier
Une merveilleuse lecture avec la plume de Voltaire! Comme d’habitude, je ne suis jamais déçue avec lui. Ses écrits sont avancés sur son temps.
Afficher en entier
Lu pour mes études, j'ai adoré l'écriture, les personnages, les symboliques, l'esprit révolté de Voltaire, etc. L'analyse faite en classe nous a apporté beaucoup de compréhension de l'œuvre et j'ai vraiment été intéressée.
Afficher en entier
C'est un livre d'aventures avec un personnage principal un peu simplet qui donne son expression à quelqu'un de naïf : un ou une candide. C'est sympa à lire mais parfois j'ai eu du mal avec le style.
Afficher en entier
Micromégas est une œuvre fascinante qui transporte le lecteur dans un voyage extraordinaire à travers l'espace et le temps. Dans cette nouvelle, Voltaire explore avec ingéniosité les thèmes de la relativité, de l'humilité et de la découverte de soi. En suivant les aventures des géants Micromégas et son compagnon, le lecteur est invité à remettre en question ses propres perceptions de l'univers et de l'existence. Les rencontres avec différentes formes de vie extraterrestres permettent à Voltaire d'exprimer des idées philosophiques profondes tout en maintenant un ton léger et divertissant. Micromégas offre ainsi une réflexion stimulante sur notre place dans l'univers, tout en nous divertissant avec des récits captivants et des dialogues plein d'esprit.
Afficher en entier
Ouvrage très intéressant pour connaître le style de Voltaire. Je l'ai lu au lycée et ç'a été une belle découverte, je ne m'attendais pas à une telle qualité et à une telle facilité de lecture.
Afficher en entier
Un classique, découvert lors de ma scolarité, un passage obligé mais pas si difficile que cela à lire
Afficher en entierOn parle de Voltaire ici :
2018-01-01T12:42:09+01:00
2016-11-30T18:55:41+01:00
2016-05-26T17:44:40+02:00
2016-04-22T17:14:26+02:00
2015-11-26T18:05:07+01:00
2015-11-25T19:31:52+01:00
Les gens aiment aussi
Dédicaces de Voltaire
et autres évènements
Aucun évènement prévu
Editeurs
Gallimard : 25 livres
Flammarion : 21 livres
Larousse : 15 livres
LGF - Le Livre de Poche : 14 livres
Hatier : 8 livres
Pocket : 7 livres
Hachette : 7 livres
Nathan : 4 livres




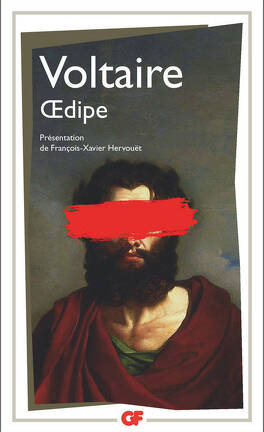











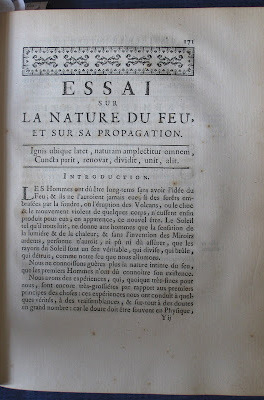






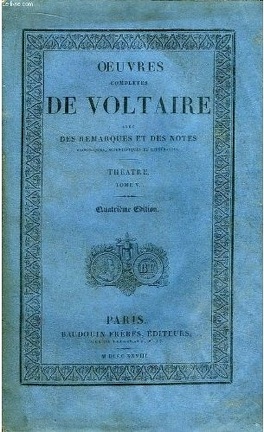



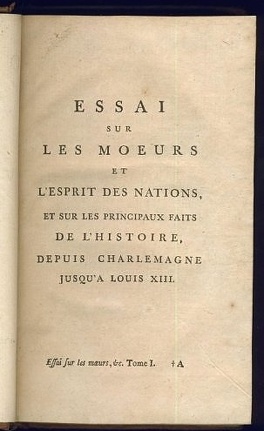









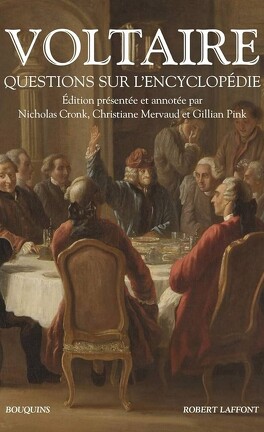








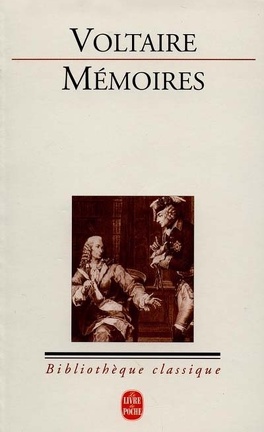

























































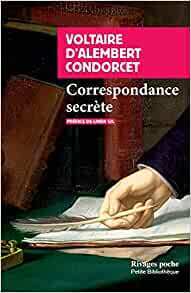






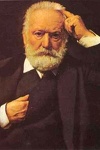
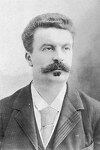


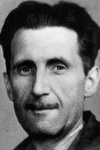
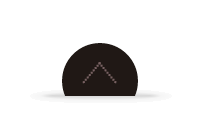
Biographie
François Marie Arouet, dit Voltaire[1], né le 21 novembre 1694[2] à Paris où il meurt le 30 mai 1778, est un écrivain et philosophe qui a marqué le XVIIIe siècle et qui occupe une place particulière dans la mémoire collective des Français. « On n’emprisonne pas Voltaire » dira de Gaulle en 1960 à ceux qui réclament l’inculpation de Sartre dans l’affaire du Manifeste des 121.Symbole des Lumières, chef de file du parti philosophique, son nom reste attaché à son combat contre « l’infâme » (il invente en 1759 le slogan « écrasons l’infâme » par lequel il termine ses lettres à ses intimes), nom qu’il donne au fanatisme religieux. Il n’en finit pas de dresser la liste des malheurs et des crimes qu’il engendre, et, pour lui, il ne peut y avoir de progrès de l’humanité et de la civilisation sans tolérance. Dans ce contexte, son grand ennemi est la religion chrétienne et l’Église catholique de son temps. Ses adversaires l’accuseront de saper les bases de la religion et par là même de la monarchie et de favoriser la dépravation des mœurs.
À près de 70 ans, exilé loin de Paris dans son château de Ferney, il prend, seul, la défense des victimes de l’intolérance religieuse et de l’arbitraire dans des affaires qu’il a rendues célèbres (Calas, Sirven, chevalier de La Barre, comte de Lally) et met son immense notoriété auprès des élites éclairées de l’Europe des Lumières à leur service. C’est ce Voltaire-là, « l’homme aux Calas », le « don Quichotte des malheureux » que le peuple de Paris ovationne, à son retour dans la capitale en 1778. Il inaugure ainsi la figure de l’intellectuel engagé au service de la vérité, de la justice et de la liberté de penser.
De son œuvre littéraire, on lit aujourd'hui essentiellement ses écrits philosophiques en prose : contes et romans (Candide est son ouvrage le plus célèbre), Lettres philosophiques, Dictionnaire philosophique) et sa correspondance (40 000 lettres dont 15 000 retenues dans les 13 volumes de la Pléiade). Son théâtre (René Pomeau a estimé à deux millions de personnes l’affluence attirée par ses tragédies de son vivant[3]), ses poésies épiques, ses œuvres historiques, qui firent de lui l’un des écrivains français les plus célèbres au XVIIIe siècle, sont aujourd’hui largement négligées ou ignorées. Peu d’écrivains ont écrit en français mieux que Voltaire : sa phrase est courte, simple, élégante, toujours précise. Son ironie — la fameuse ironie voltairienne — est mordante. L’audace, la verve, la causticité de sa prose donnent une idée de ce que devait être l’éclat de sa conversation.
Considéré par la Révolution française - avec Rousseau, son ennemi - comme un précurseur (il entre au Panthéon en 1791, le deuxième après Mirabeau), célébré par la IIIe République (dés 1870 à Paris un boulevard et une place portent son nom, puis un quai, une rue, un lycée, un métro…), il a nourri au XIXe siècle les passions antagonistes des adversaires et des défenseurs de la laïcité de l’État et de l’école publique, et au-delà de l’esprit des Lumières. Le mot « voltairianisme » apparaît dans le Littré de 1873 comme « esprit d'incrédulité railleuse à l'égard du christianisme ». Depuis le ralliement progressif de la droite de gouvernement à l’idéal laïque, il fait partie du patrimoine commun de la République.
Afficher en entier