Commentaires de livres faits par lamiss59283
Extraits de livres par lamiss59283
Commentaires de livres appréciés par lamiss59283
Extraits de livres appréciés par lamiss59283
Un coin tranquille à la campagne
8 mai 1317, dans les environs de Florence
Le maître Giotto di Bondone et son collaborateur préféré, Bernardo Daddi, se promènent à cheval dans la campagne des alentours de Florence. Giotto visite des fermes dont il est propriétaire. Le temps est beau et les deux hommes devisent gaiement. Le jeune adjoint du maître, qui n'a pas trente ans, est très honoré d'être ainsi admis au nombre de ses intimes.
- Dites, Maître, figurez-vous que l'on m'a dit que vous étiez berger, dans votre enfance, pas très loin d'ici, dans le Mugello, et que vous dessiniez sur les rochers. C'est vrai ?
Giotto éclate de rire. Ses pommettes saillantes sont agitées quelques instants et il fixe ses yeux et architecte, à la fois puérils et sauvages sur le pauvre Bernardo qui ne sait plus où se mettre :
- Quelles sornettes on peut débiter ! Vraiment, je suis sidéré par toutes les crétineries que l'on peut colporter à chaque heure de la journée sur tout un chacun. Qui t'a raconté ça ?
Tarzan a poussé un hurlement et s'est élancée de la branche. Elle a décrit une grande courbe à travers le feuillage avant de venir s'échouer contre mon épaule gauche dans un bruit flasque et sourd. Le choc m'a propulsé à plusieurs mètres de là, bras et jambes battant comme des ailes.
Disons-le franchement, je n'étais pas à mon avantage la première fois que nous nous sommes rencontrés. Ou, plus exactement, quand elle m'est littéralement tombée dessus.
Et quels ont été ses premiers mots ?
Lâchant la grosse corde avec laquelle elle s'était catapultée, elle s'est exclamée, pas contente du tout :
— Aïe, putain de merde !
Elle s'est frotté le genou qui était un peu rouge après la collision avec ma clavicule et elle m'a reluqué, les sourcils froncés. J'avais en face de moi le portrait tout craché des pires souvenirs de mon institutrice à l'école primaire.
— D'accord, c'était un peu loupé ! a-t-elle dit ensuite. Pardon, excuse-moi, je suis désolée. Mais t'avais qu'à pas venir te balader juste là.
Je suis resté sans voix. La dame m'avait presque tué et voilà qu'elle se permettait aussi de critiquer mes déplacements sur une plage publique !
— Mais ferme-la, espèce de Tarzan de mes deux ! ai-je soufflé.
Elle portait en tout et pour tout une culotte de maillot de bain en tissu léopard. Je la trouvais imbuvable et l'envie me démangeait de lui flanquer une gifle, mais je n'avais pas encore complètement récupéré ma respiration, si bien que je suis resté allongé par terre à faire de l'hyperventilation. Elle s'est accroupie devant moi.
— Rien de cassé ?
Pour toute réponse, mes halètements de chien. Un petit môme blond avec une coupe au bol et de sexe indéterminé est sorti d'un buisson et s'est jeté à son cou par-derrière. Il a décollé du sol et s'est accroché à elle comme un sac à dos de grande randonnée.
— Pourquoi il respire comme ça, le bonhomme ?
Le bonhomme ! Je suppose que pour un mini-modèle comme celui-là, un homme de vingt-neuf ans est un bonhomme. Mais ça m'a fait un drôle d'effet de l'entendre, ça doit être la crise de la trentaine qui couve. Je l'ai toisé avec toute la malveillance dont j'étais capable.
Elle lui a distraitement essuyé le nez avec le dos de la main.
On s'est tamponnés. Va enfiler un pull, Bella ! Tu es restée trop longtemps dans l'eau.
Comment ça, on ? Tu m'as tamponné... ai-je fulminé. Je suis sûr que tu l'as fait exprès ! Si j'ai quelque chose de cassé, je porterai plainte, je te préviens !
Je commençais à en avoir marre de cette nana. Elle était plus vieille que moi, au moins dans les trente-cinq ans, avec des cernes noirs sous les yeux et des rides de bronzage.
J'ai senti quelque chose me brûler la fesse. Putain ! J'avais atterri sur mes lunettes de soleil Armani, celles que je venais juste d'acheter à Hongkong trois semaines auparavant ! Et je m'étais coupé avec les éclats !
— Je ne rigole pas, ai-je réussi à articuler une fois que j'eus fini de haleter comme une femme en couches. Ça s'appelle mise en danger d'autrui par imprudence, ce que tu viens de faire. Je vais te dénoncer à la police !
Elle a rigolé, mais sans la moindre joie.
— Bonne chance ! a-t-elle dit. Tu n'obtiendras pas plus de ma part que ce que l'huissier a réussi à me soutirer cette année. C'est-à-dire rien. Mais jette donc un coup d'œil sur le panneau là-bas, ça va te calmer.
Elle a montré un énorme écriteau au bord dû sentier que j'avais emprunté. On pouvait lire en lettres rouges et irrégulières « ATTENTION ! CORDES DE TARZAN ». Merde !
— Il saigne aux fesses, a fait le mioche. Il lui faudrait une de ces petites couches pour les mamans, tu sais, comme toi tu mets des fois.
La dame a souri et tapoté le bras du môme.
— Peut-être bien ! a-t-elle dit. Un tampax, ça te va ?
Elle a tendu la main et posé un doigt sur mon postérieur.
Là, j'aurais dû rire. Mais pour une raison ou une autre, le cœur n'y était pas. J'ai eu envie de filer des roustes à ses petits seins bronzés et couverts de sueur, pour les voir rebondir et s'étirer, pour lui faire mal. Ils étaient vilains, ses petits seins, comme des oreilles de basset.
Et le maillot ! Elle avait dû faire une descente dans un container devant Emmaüs, rempli de vieilleries dont même les pauvres païens ne veulent pas.
Je me suis relevé doucement en position assise en me frottant l'épaule. À part la blessure aux fesses, tout semblait en état de marche et tous les morceaux à leur place. Ce serait tenter le diable si je portais plainte contre elle.
— Ça ira ? a-t-elle souri.
La môme, une fille de toute évidence, s'était accroupie juste là, sans aucune gêne, pour faire pipi.
— Va te faire voir, ai-je marmonné.
J'avais mal à la fesse et à l'épaule, et une lourde gueule de bois me guettait quelque part derrière l'œil droit, attendant de me planter ses griffes. La dernière chose dont j'avais besoin, c'était bien d'une réconciliation conviviale avec une sorte de rescapée de Dallas. Et quoi encore, il fallait peut-être aussi que je lui propose un verre pour célébrer la paix ? Là elle se payait carrément ma tête. Une goutte de sueur s'est frayé un chemin sur son ventre pour disparaître dans le simili-léopard. Des touffes de poils noirs sortaient de son maillot, en direction de l'aine. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas vu un entrejambe non épilé que pendant une seconde j'ai cru que c'était un petit animal qu'elle avait là.
Je me suis remis debout d'une manière que je n'aurais pas aimé montrer dans une salle de sport. Puis je m'en suis allé d'un pas ferme et décidé qui faisait voler le sable blanc autour de mes tennis, et sans me retourner, surtout.
« Un bonhomme a donné un truc à maman »
Maman a sauté sur un bonhomme et il est tombé et s'est fâché tout rouge et il a dit qu'il allait porter quelque chose contre elle et puis il a dit merde. Mais maman s'est pas du tout fâchée, elle a seulement dit bonne chance et ensuite on a été manger une glace, celle avec de la réglisse dedans et autour et cet imbécile de Billy a laissé tomber la sienne dans le sable et alors maman a dit que je devais lui donner la moitié de la mienne et je l'ai fait mais je l'ai pincé fort dans le dos et il a pleuré et maman a dit merde alors. Mais les enfants ont pas le droit de dire ça. Et ensuite le soir dans la maison avec les lits superposés on a mangé des hot dogs et on a bu du soda à la framboise et j'ai eu une boîte de pastilles et Billy aussi en a en une mais il l'a fait tomber et toutes les pastilles se sont éparpillées et ensuite on a joué aux billes avec et il ne s'est pas rendu compte que je les mangeais avant qu'il en reste que deux et il a pleuré et maman a dit merde alors. Et tante Jenny était là et elle est restée avec nous quand maman est sortie un moment et elle nous a lu des Picsou Magazine et ensuite on devait se coucher et j'ai eu le lit de dessus. On s'est lavé les dents dehors, on a craché dans l'herbe et c'est devenu tout blanc et ensuite je me suis fait mal sur un clou et il y a eu du sang et tante Jenny a mis un pansement et quand maman est arrivée j'ai pleuré mais elle a rien dit. Elle était bizarre et toute rouge et elle avait une drôle d'odeur et elle a dit à tante Jenny qu'un bonhomme lui avait donné un truc, une pèse ou quelque chose, pour faire des buts et j'ai voulu voir mais elle l'avait pas et elle a ri et tante Jenny a ri. Ensuite tante Jenny est partie et maman m'a fait tout plein de bisous et elle a soufflé sur le pansement et a dit ma petite puce et Billy dormait et j'ai pu venir dans le lit de maman et elle avait une drôle d'odeur.
Caroline fit une grimace et continua à se vernir les ongles des pieds. Elle n'avait rien contre la passion de sa fille pour l'équitation, mais elle ne la comprenait pas non plus. Dès leur installation à Bindon, quand ils avaient quitté Seymour Road, Georgina s'était mise à réclamer un poney à cor et à cri. Et naturellement, Patrick avait poussé à la roue pour que les vœux de sa fille soient exaucés.
En fait, le premier poney, Caroline avait fini par s'y attacher. C'était une bête gentille, à la crinière hirsute et au caractère docile. Il lui arrivait d'aller le voir quand il n'y avait personne dans les parages, et elle avait pris l'habitude de lui donner des chocolats Ferrero Rocher à croquer. Mais le dernier en date était un monstre – une énorme créature toute noire qui avait l'air d'une brute. Georgina avait beau être grande et forte pour onze ans, Caroline se demandait comment sa fille parvenait ne fût-ce qu'à grimper sur cet animal, et à plus forte raison à le monter et à lui faire sauter des obstacles.
Elle acheva de se vernir les ongles du pied droit et avala un peu de vin blanc. Le pied gauche était sec, et elle le souleva pour admirer le joli ton nacré à la lumière du soir. Elle était assise sur la vaste terrasse devant le grand salon. La Maison Blanche avait été conçue – une idée que Caroline trouvait assez stupide étant donné le climat anglais – pour capter un maximum de soleil. Les murs tout blancs réverbéraient ses rayons dans la cour centrale, et les pièces principales étaient orientées au midi. Au-dessus de sa tête, une treille qui donnait des raisins plutôt acides avait fini par grimper tant bien que mal le long du mur. Et, chaque été, on agrémentait la terrasse de quelques plantes exotiques que l'on sortait de la serre. N'empêche que c'était l'Angleterre, où l'on meurt de froid. Et à cela, on ne pouvait pas grand-chose.
Pourtant, elle devait reconnaître que cette journée avait été une des plus belles que l'on pût espérer. Ciel bleu et limpide, soleil brûlant, pas un souffle de vent. Elle avait passé le plus clair de son temps en préparatifs pour le lendemain mais, heureusement, toutes les tâches qu'elle s'était assignées – arranger les fleurs, préparer les légumes, s'épiler les jambes à la cire – pouvaient être accomplies à l'extérieur. Les mets principaux – terrine de légumes pour le déjeuner et tartelettes aux fruits de mer pour le dîner – étaient arrivés de chez le traiteur dans la matinée, et Mme Finch les avait déjà dressés sur des plats, avec un haussement de sourcils qui en disait long : « Vous auriez tout de même pu faire l'effort de cuisiner pour huit personnes, non ? » Mais Caroline était habituée à ces haussements de sourcils réprobateurs de Mme Finch et elle n'en tenait aucun compte. Et alors, se dit-elle en se versant un autre verre de vin, à quoi bon avoir de l'argent si ce n'est pas pour le dépenser ?
La leçon d'équitation était terminée, et Georgina arriva en traversant la pelouse à grands bonds, ses nattes blondes, défaites depuis peu, ondoyant dans son dos en flots abondants.
« Maman, cria-t-elle, Dawn a dit que mon trot enlevé était plus maîtrisé que jamais ! Et que, si je montais comme ça au gymkhana d'East Silchester… » Elle regarda sa mère comme si elle voulait l'impressionner. Eh bien quoi ? se demanda Caroline. Tu risques de gagner ? Tu ferais mieux d'abandonner ? Le trot enlevé était-il censé être maîtrisé, ou au contraire parfaitement décontracté ? Elle n'en avait pas la moindre idée. « Et en plus, je fais des progrès en saut d'obstacles, ajouta Georgina.
— Très bien, chérie », dit Caroline. Elle avait la voix rauque, éraillée par les cigarettes et, ces derniers temps, par la bouteille de vin blanc qu'elle avalait presque chaque soir.
« Du vernis à ongles, dit Georgina. Je peux en mettre ?
— Pas sur des ongles aussi sales. Il faut que tu prennes un bain.
— Et quand j'aurai pris mon bain, je pourrai ?
— Peut-être. Si j'ai le temps.
— Je veux du rose vif.
— Je n'ai pas de rose vif, dit Caroline en fronçant le nez. Tout ce que j'ai à te donner, c'est ce joli rose pâle, ou bien du rouge.
— Du rouge, beurk. » Georgina fit la moue. Puis, d'un bond, elle grimpa sur la terrasse et se jeta sur le dossier du fauteuil de bois de sa mère. « Qui est-ce qui doit venir demain ?
— Tu le sais bien, répondit Caroline en appliquant avec soin une seconde couche de vernis au pied gauche.
— Il y aura Nicola ?
— Oui.
— Elle va mieux ?
— Un peu.
— Je pourrai l'emmener faire du poney ? Elle a le droit ?
— Tu demanderas à Annie, mais je ne vois pas pourquoi on l'en empêcherait. Seulement, tu feras bien d'emmener Toby aussi.
— Il est trop petit pour monter Arabia.
— Eh bien, il n'aura qu'à regarder.
— Est-ce que je pourrai participer au tournoi de tennis ?
— Non.
— Je pourrai mettre ma jupe de tennis ?
— Si tu veux.
— Je pourrai ramasser les balles ?
— Si tu veux, mais tu en auras vite assez.
— Non. Je sais comment ça se passe. On les fait rouler le long de la ligne, et puis on les attrape et on les lance aux joueurs. La cousine de Poppy Wharton a été ramasseuse de balles à Wimbledon et elle a vu Navratilova. En plus, je sais servir. »
Elle lança en l'air une balle imaginaire, la frappa à toute volée et, ce faisant, elle heurta le fauteuil de Caroline. Le pinceau fit une bavure.
« Merde, s'écria Caroline sans aigreur.
— De toute façon, personne ne verra tes pieds, dit Georgina. Tu m'en mets aux mains ?
— Quand tu auras pris ton bain. Il faut que tu aies des ongles propres, pas ces ongles crasseux de cavalière. » Mais Georgina n'en avait déjà plus envie, et elle faisait un saut de mains sur la pelouse. Caroline leva les yeux : elle aussi avait eu droit à tout un entraînement de gymnaste autrefois. À présent, se dit-elle en regardant sa fille, on ne leur apprend plus à finir un saut correctement, à se récupérer en beauté et à se présenter devant les juges avec un joli sourire. À l'école de Georgina, personne ne prenait la gymnastique au sérieux. Il s'agissait seulement d'endurcir les élèves pour des activités plus importantes – le netball, la crosse, et le cheval, toujours le cheval. Les compétitions, les exhibitions, les collants de gymnastique et les rubans chatoyants qui avaient été toute son enfance, rien de tout cela ne semblait intéresser les fillettes de maintenant.
Remontant du court de tennis, Patrick Chance vit sa fille, cette beauté agile, qui faisait la roue sur un fond de soleil couchant, et il s'arrêta un instant, séduit par l'aisance et la grâce de ses mouvements, par sa vitalité, son énergie. Était-ce propre à tous les pères de s'émouvoir ainsi ? Quand il parlait avec d'autres parents, il avait du mal à rester placide et détaché comme eux. Alors que les autres passaient sous silence les accomplissements de leurs enfants, lui ne pouvait s'empêcher d'énumérer tout ce que faisait Georgina, interrompant la conversation pour annoncer que sa fille, qui avait tout juste onze ans, venait de participer, au manège, à un concours pour les moins de quatorze ans. Quand les autres parents reprenaient leur bavardage, après un hochement de tête et un petit sourire, son cœur d'incompris battait de rage contenue. Il avait toujours envie de leur crier : Mais regardez-la donc ! Rendez-vous compte ! Et en plus, elle joue du piano, déclarait-il, dans un effort désespéré pour regagner leur attention. D'après son professeur, elle se débrouille très bien. Nous avons même pensé lui faire commencer la flûte.
Il vit que Caroline était de nouveau toute à son vernis à ongles. Il était toujours peiné qu'elle ne partage pas son admiration fervente pour Georgina, et qu'elle ne renchérisse jamais quand il se mettait à faire son éloge, même dans l'intimité. Et cela d'autant plus que, pour être honnête, Georgina tenait beaucoup plus de sa mère que de lui-même. La mère et la fille avaient les mêmes cheveux blonds, le même corps athlétique, la même propension à de bruyants éclats de rire. Mais c'était peut-être justement la raison pour laquelle Caroline était si mauvais public. Elle savait ce que c'était que d'être belle, à l'aise dans son corps et sympathique aux gens. À l'inverse de Patrick, qui était petit, boulot et myope.
Il continua à s'avancer vers la maison et Georgina, marchant en crabe, se dirigea vers lui.
« Bonsoir, papa, dit-elle dans un souffle en s'effondrant par terre.
— Bonsoir, mon petit chat. Ta leçon d'équitation s'est bien passée ?
— Super. » Patrick se tourna vers Caroline. « Tout est en ordre pour demain ?
— Les plats sont déjà prêts, si c'est ce que tu veux dire, répondit Caroline. Et Mme Finch s'est occupée des chambres ce matin.
— Qui va être à côté de moi ? demanda Georgina.
— Les petits jumeaux Mobyn et la jeune fille qui s'occupe d'eux. Comment s'appelle-t-elle déjà ?
— Martina, je crois, dit Patrick. Elle est allemande. Ou autrichienne peut-être bien. » Georgina fronça le nez.
« Pourquoi pas Nicola et Toby ?
— Demande à ton père, répliqua Caroline d'un ton aigre. Il a absolument voulu qu'on donne la grande chambre à Charles et à Cressida, alors, il faut bien installer les jumeaux à côté de toi. Cressida, ajouta-t-elle en prononçant le nom avec une application délibérée, aime bien les avoir tout près d'elle.
— Pourquoi est-ce qu'ils n'iraient pas tous au bout du couloir ? suggéra Georgina. Annie et Stephen auraient la grande chambre, et Nicola et Toby seraient à côté de moi.
— Ton père veut qu'on y mette Charles et Cressida, dit Caroline, parce que ce sont des gens très riches. Il a peur qu'ils nous snobent. » Patrick rougit.
Les scènes du roman les plus mortifiantes étaient celles qui faisaient la chronique de mes relations avec Blair. Et c'était particulièrement mortifiant vers la fin du roman, quand je rompais avec elle dans le patio d'un restaurant qui surplombait Sunset Boulevard, alors que j'étais constamment distrait par une affiche qui annonçait DISPARAÎTRE ICI (l'auteur avait ajouté que je portais des lunettes de soleil quand j'avais déclaré à Blair que je ne l'avais jamais aimée). Je n'avais pas évoqué cet après-midi pénible devant l'auteur, mais il figurait dans le livre dans les moindres détails et c'était à ce moment-là que j'avais cessé de parler à Blair et que je n'avais plus été capable d'écouter les chansons d'Elvis Costello que nous connaissions par cœur (« You Little Fool », « Man Out of Time », « Watch Your Step »), eh oui, elle m'avait bien offert un foulard lors d'une fête de Noël, eh oui, elle s'était bien approchée de moi en dansant et en mimant les paroles de « Do You Really Want to Hurt Me ? » de Culture Club, eh oui, elle m'avait dit que j'étais canon, eh oui, elle avait appris que j'avais couché avec une fille que j'avais ramassée au Whiskey une nuit de pluie, eh oui, c'était l'auteur qui l'en avait informée. En lisant ces scènes nous concernant, Blair et moi, je m'étais rendu compte qu'il n'était proche d'aucun de nous - à l'exception de Blair, bien sûr, et encore pas même d'elle, vraiment. C'était simplement quelqu'un qui flottait au milieu de nos vies et n'avait pas l'air gêné par sa perception stéréotypée de chacun de nous ou par le fait qu'il dévoilait nos échecs les plus secrets au monde entier, préférant glorifier l'indifférence juvénile, le nihilisme rutilant, donner l'éclat du glamour à toute l'horreur du truc.
Mais être furieux contre lui n'avait pas de sens. Lorsque le livre était paru au printemps 1985, l'auteur avait déjà quitté Los Angeles. En 1982, il s'était retrouvé dans la même petite université du New Hampshire où j'avais tenté de disparaître, et où nous n'avions quasiment eu aucun contact (il y a un chapitre dans son deuxième roman qui se déroule à Camden, dans lequel il fait un portrait parodique de Clay - un geste hostile de plus, un rappel cruel de ce qu'il éprouvait à mon égard : bâclé et pas réellement mordant, plus facile à ignorer que tout ce qui se trouvait dans le premier livre qui me décrivait comme un zombie incapable de s'exprimer et troublé par l'ironie des paroles de « I Love LA » de Randy Newman). À cause de sa présence, je n'avais passé qu'un an à Camden et j'avais été transféré à Brown en 1983, même si je suis encore dans le New Hampshire, à en croire le deuxième roman, au cours du trimestre de l'automne 1985. Je m'étais dit que je n'en avais pas grand-chose à foutre, mais le succès du premier livre avait envahi une partie de mon champ de vision pendant une période péniblement longue. C'était lié en partie au fait que je voulais, moi aussi, devenir écrivain et que j'aurais bien voulu, après l'avoir lu, écrire ce premier roman que l'auteur avait mis sur le papier - c'était ma vie et il l'avait détournée comme un pirate de l'air. Mais j'avais dû rapidement convenir que je n'en avais pas le talent, ni la motivation. Je n'en avais pas la patience. Je voulais seulement m'en sentir capable. J'avais fait quelques tentatives limitées et foireuses, et j'en étais venu à cette évidence, après avoir obtenu mon diplôme à Brown en 1986, que jamais ça n'arriverait.
La seule personne qui ait exprimé un certain embarras ou mépris vis-à-vis du roman, c'était Julian Wells - Blair était encore amoureuse de l'auteur et se fichait du livre, tout comme s'en foutaient la plupart des seconds rôles - mais Julian l'avait méprisé à sa manière, joyeuse et arrogante, qui frisait l'excitation, même si l'auteur avait non seulement révélé la dépendance de Julian à l'héroïne, et aussi le fait qu'il se prostituait - pratiquement - pour payer ses dettes à un dealer (Finn Delaney) et servait d'entremetteur à des hommes en voyages d'affaires, venus de Manhattan, de Chicago ou de San Francisco, dans les hôtels le long de Sunset, depuis Beverly Hills jusqu'à Silver Lake. Julian, défoncé, s'apitoyant sur son sort, avait tout raconté à l'auteur, et il y avait quelque chose dans le fait que le livre avait été lu un peu partout et avait transformé Julian en star qui lui donnait apparemment une sorte de concentration qui flirtait avec l'espoir, et je pense qu'il en était secrètement satisfait parce qu'il n'éprouvait pas le moindre sentiment de honte - il faisait seulement semblant. Et il avait été encore plus excité quand la version cinéma était sortie à l'automne 1987, deux ans à peine après la publication du roman.
Je me souviens que mon état de fébrilité à propos du film avait commencé au cours d'une douce nuit d'octobre, trois semaines avant sa sortie, dans une salle de projection des studios de la 20th Century Fox. J'étais assis entre Trent Burroughs et Julian, qui n'était pas encore désintoxiqué et n'arrêtait pas de se ronger les ongles, de se tortiller d'impatience dans le fauteuil noir luxueux (j'avais vu Blair arriver avec Alana et Kim, et, derrière elles, Rip Millar - je l'avais ignorée). Le film était très différent du livre, en ce sens qu'il n'y avait rien du livre dans le film. En dépit de tout - l'immense douleur que j'avais ressentie, la trahison -, je n'avais pu m'empêcher de reconnaître une vérité pendant que j'étais assis dans cette salle de projection. Dans le livre, tout ce qui me concernait avait eu lieu. Le livre était quelque chose que je ne pouvais tout simplement pas désavouer. Le livre était direct et plutôt honnête, alors que le film n'était qu'un joli mensonge (c'était aussi une merde : riche en couleurs, chargé, mais sinistre et cher, et il n'avait pas rapporté l'argent qu'il avait coûté lorsqu'il était sorti en novembre cette année-là). Dans le film, j'étais joué par un acteur qui me ressemblait davantage que le portrait de mon personnage dans le livre : je n'étais pas blond, je n'étais pas bronzé, et l'acteur non plus. J'étais aussi devenu, soudain, la boussole morale du film, débitant des propos tirés tout droit du jargon des Alcooliques anonymes, reprochant à chacun sa manière d'user de la drogue et essayant de sauver Julian (« Je vais vendre ma voiture, dis-je, menaçant, à l'acteur qui interprète le dealer de Julian. Tout ce qui sera nécessaire »). C'était un peu moins vrai pour l'adaptation du personnage de Blair, joué par une fille qui avait réellement l'air d'avoir fait partie de notre groupe - nerveuse, sexuellement facile, vulnérable. Julian était devenu une version sentimentalisée de lui-même, incarnée par un clown talentueux, au visage triste, qui a une aventure avec Blair et s'aperçoit ensuite qu'il doit la laisser partir parce que je suis son meilleur pote. « Sois gentil avec elle, dit Julian à Clay. Elle le mérite. » L'hypocrisie absolue de cette scène avait dû faire blêmir l'auteur. Me souriant secrètement à moi-même avec une satisfaction perverse au moment où l'acteur prononçait cette réplique, j'avais alors jeté un coup d'œil en direction de Blair dans l'obscurité de la salle de projection.
Lorsque la rame s'immobilisa enfin dans un grincement strident à la station Franklin Street, Brooke ressentit une bouffée d'anxiété. Pour la dixième fois en quelques minutes, elle consulta sa montre et s'efforça de se souvenir que ce n'était pas la fin du monde, que même si son retard était inexcusable, Nola, sa meilleure amie, lui pardonnerait – devrait lui pardonner. Tout en jouant des coudes dans la fourmilière humaine de l'heure de pointe, Brooke retint instinctivement sa respiration et se laissa charrier par ce courant qui l'entraînait vers l'escalier. Comme en pilote automatique, elle prit place dans la file indienne de bons petits soldats qui se forma du côté droit de l'escalier et observa ses compagnons de voyage sortir un téléphone portable d'un sac, ou d'une poche, avant de contempler d'un air absent le minuscule écran au creux de leur main, tels des zombies.
— Merde ! lâcha la femme obèse devant elle.
Brooke ne tarda pas à comprendre la raison de ce juron. À l'instant où elle émergea de la bouche de métro, la pluie s'abattit sur elle sans préavis et avec violence. Ce qui, à peine vingt minutes plus tôt, avait été une soirée de mars, frisquette mais potable, venait de virer au cauchemar glacial et diluvien. Fouettés par le vent, des rideaux de pluie s'abattaient sur l'asphalte avec un tel acharnement qu'il ne servait à rien d'ouvrir un parapluie ou de s'abriter sous un journal.
— Et merde ! s'écria Brooke en s'associant au concert de jurons.
Brooke, qui était repassée chez elle pour se changer après sa journée du travail, n'avait rien d'autre qu'une minuscule (et, soit dit en passant, ravissante) pochette argentée pour se protéger. Bye-bye, brushing ! songea-t-elle en s'élançant sous le déluge pour parcourir les trois blocs qui la séparaient du restaurant. Tu vas me manquer, mascara ! J'ai eu plaisir à vous rencontrer, sublimes bottes en daim qui m'avez coûté la moitié de mon salaire hebdomadaire.
Arrivée à destination, elle ruisselait. Le Sotto, petit restaurant de quartier sans prétention où Nola et elle se retrouvaient deux à trois fois par mois, ne servait pas les meilleures pâtes de la ville – ni même probablement du quartier – et son cadre n'offrait rien de remarquable, mais il avait d'autres charmes, somme toute plus importants : des pichets de vin à prix raisonnable, un tiramisu mortel, et un maître d'hôtel italien archisexy qui, tout simplement parce qu'elles étaient des clientes de longue date, leur réservait toujours la table la plus tranquille de la salle, tout au fond.
— Salut, Luca ! lança Brooke au patron tout en essayant de se défaire de son caban en laine sans provoquer d'inondation. Elle est déjà là ?
Luca, qui était au téléphone, posa la main sur le combiné et braqua un crayon à papier par-dessus son épaule.
— La même table que d'habitude. En quel honneur, cette robe sexy, cara mia ? Tu ne veux pas te sécher, d'abord ?
Brooke lissa le plastron du plat des mains en espérant que le compliment était sincère et justifié, que cette robe en jersey noir à manches courtes était réellement sexy et qu'elle la portait bien. Elle avait fini par la considérer comme sa tenue de concert : associée, en fonction du temps, à des escarpins, des sandales à talons ou des bottes, elle l'enfilait presque à chaque fois qu'elle allait voir Julian se produire sur scène.
— Je suis déjà affreusement en retard. Elle est énervée ? Elle râle ? demanda-t-elle en disciplinant au mieux ses mèches pour tenter de les sauver d'une attaque de frisottis imminente.
— Elle a déjà descendu un demi-pichet et n'a pas lâché son portable. Tu ferais mieux d'y aller.
Après l'incontournable échange des trois bises – dans les premiers temps, Brooke avait voulu protester contre ce rituel, mais Luca avait insisté –, elle prit une grande inspiration et gagna leur table. Nola était installée sur la banquette, droite comme un I, la veste de son tailleur jetée sur le dossier. Son petit haut en cachemire bleu marine mettait en valeur ses bras musclés et faisait ressortir l'éclat de sa peau mate ; son dégradé aux épaules était stylé et sexy ; ses mèches blondes brillaient sous les lumières tamisées du restaurant ; son maquillage évoquait la fraîcheur de la rosée. Personne, en la voyant, n'aurait pu deviner qu'elle venait de passer douze heures à un pupitre de négociation, à hurler des ordres dans un micro-casque.
Les deux amies ne s'étaient rencontrées qu'au second trimestre de leur dernière année à Cornell, même si Brooke – comme tout le monde sur le campus – savait depuis longtemps qui était Nola. Elle la terrifiait et la fascinait tout à la fois. À la différence de leurs camarades, toutes abonnées à l'uniforme sweat à capuche et Ugg, Nola soignait sa silhouette de mannequin avec des bottes à talons hauts et des blazers et jamais, absolument jamais, elle n'attachait ses cheveux en queue de cheval. Avant d'entrer en fac, elle avait fréquenté les écoles les plus sélectes de New York, Londres, Hong-Kong ou Dubaï – les capitales dans lesquelles l'avait menée la carrière de son père, un banquier d'affaires –, et joui de la liberté que procure le statut d'enfant unique de parents extrêmement occupés.
Il était impossible de savoir comment elle avait atterri à Cornell plutôt qu'à Cambridge, à Georgetown ou à la Sorbonne, mais nul n'avait besoin de beaucoup d'imagination pour voir qu'elle n'était pas particulièrement impressionnée par le prestige de l'établissement. Pendant que ses camarades s'empressaient d'intégrer une corporation étudiante, se retrouvaient pour déjeuner à la Ivy Room, ou s'enivraient dans les bars en ville, Nola restait fidèle à elle-même. Des bribes de sa vie filtraient : sa liaison, de notoriété publique, avec le professeur d'archéologie ; le défilé d'hommes mystérieux et séduisants, qui disparaissaient aussi vite qu'ils étaient apparus… Mais pour l'essentiel, Nola assistait à ses cours, raflait invariablement de très bonnes notes aux examens et filait dare-dare à Manhattan dès le vendredi après-midi.
En dernière année, dans l'atelier optionnel d'écriture, les deux filles se retrouvèrent en binôme. Chacune devait lire et commenter la nouvelle de l'autre. Brooke était si intimidée que c'était à peine si elle osa lui parler. Nola, comme d'habitude, ne semblait ni particulièrement contente ni spécialement contrariée, mais lorsque, la semaine suivante, elle rendit à Brooke le premier jet de sa nouvelle – une fiction autour d'un personnage qui bataillait pour s'adapter à sa mission des Peace Corps au Congo –, elle l'avait annotée avec des suggestions et des commentaires aussi justes que pertinents. Et puis, sur la dernière page, à la suite d'une note de lecture détaillée, Nola avait écrit : « P.-S. : insérer éventuellement une scène de sexe au Congo ? » Brooke avait été prise d'un tel fou rire qu'elle avait dû quitter la salle un instant pour se calmer.
Après le cours, Nola l'avait invitée dans le salon de thé situé au sous-sol d'un des bâtiments administratifs, un lieu que ni Brooke ni aucune de ses camarades ne fréquentaient et, en l'espace de deux ou trois semaines, elle accompagnait Nola à New York pour le week-end. Même après toutes ces années, Nola n'avait rien perdu de son prestige à ses yeux, mais cela lui faisait du bien de savoir que son amie sanglotait en voyant des images de soldats de retour de la guerre, au journal télévisé, qu'elle nourrissait le rêve obsessionnel de vivre un jour derrière une palissade en bois blanc en banlieue et ce, même si elle en faisait ouvertement un sujet de dérision et qu'elle avait une peur pathologique des petits chiens hargneux. (Ce qui ne concernait nullement Walter, le chien de Brooke.)
— …Oui, oui, parfait. Non, le comptoir, c'est très bien, assura Nola à son interlocuteur tout en regardant Brooke et en levant les yeux au ciel. Non. Inutile de réserver, on trouvera toujours à se caser. D'accord, ça m'a l'air bien. À demain.
Elle rabattit le clapet de son téléphone et se resservit aussitôt du vin rouge, avant de se souvenir que Brooke était arrivée et de remplir également son verre.
— Tu m'en veux ? demande Brooke en posant son caban sur la chaise voisine et en glissant son parapluie ruisselant sous la table.
Elle but une longue gorgée de vin et savoura la caresse du breuvage sur sa langue.
— T'en vouloir ? Pourquoi ? Parce que je poireaute depuis une demi-heure ?
— Je sais, je sais, je suis vraiment désolée. Ça a été l'enfer au boulot. Deux des nutritionnistes à plein temps étaient malades aujourd'hui – ce que je trouve un peu bizarre, si tu veux mon avis – et nous avons dû assurer leurs rendez-vous en plus des nôtres. Évidemment si, de temps en temps, on se retrouvait dans mon quartier, ça me permettrait peut-être d'arriver à l'heure…
Nola leva la main pour l'interrompre.
— C'est bon, j'ai pigé. J'apprécie vraiment que tu fasses tout ce chemin pour me retrouver ici. Mais que veux-tu, aller dîner midtown, ça n'a rien de bien excitant.
— Avec qui parlais-tu ? Daniel ?
— Daniel ? répéta Nola, l'air confus. (Elle fixa un instant le plafond.) Daniel, Daniel… Ah ! Lui. Non, c'est une affaire classée. Je l'ai emmené à un truc de boulot la semaine dernière, et il était bizarre. Super bizarre. Non, là, je prenais rendez-vous pour demain avec un mec que j'ai rencontré sur Internet. C'est le second, cette semaine. À quel moment suis-je devenue à ce point pathétique ? soupira-t-elle.
— Arrête, tu n'es pas…
— Mais si. C'est pathétique, à presque 30 ans, de considérer son petit copain de la fac comme sa seule « vraie » histoire. Et ce qui est tout aussi pathétique, c'est que je suis inscrite sur un tas de sites de rencontres, sur lesquels je fais régulièrement mon marché. Mais le comble du pathétique – et qui confine à l'inexcusable – c'est de me ficher comme d'une guigne de le reconnaître devant n'importe qui disposé à m'écouter.
Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Si ce jour était un mec, il ferait au moins 1,90 m. Je vais bosser chez Teen TV ! Je n'ai pas dormi de la nuit, mais ma fatigue est planquée sous une couche de fond de teint. J'ai mis mes fringues fétiches – un peu serrées, j'ai dû forcer sur le chocolat ces derniers temps. Il me reste trente minutes avant de partir, je me laisse tomber sur le canapé, allume la télé et zappe jusqu'à ma chaîne préférée... Teen TV.
Ado, j'y ai découvert les meilleurs groupes du monde, les premières émissions de télé-réalité, les animateurs british qui parlaient si vite que je devais me concentrer à fond pour les comprendre. J'étais trop fière d'avoir le câble, mes amis venaient regarder la télé chez moi, on chantait, on se sentait en avance sur les autres. Et aujourd'hui... je passe de l'autre côté de l'écran. Ma vie prend un virage passionnant.
Mon portable sonne. C'est Vincent, mon meilleur pote.
— Alors poulette, t'es prête ?
— Je crois !
— Comment ça, tu crois ? Il faut y aller là, c'est l'heure. On fait un dernier check ?
— OK, vas-y.
— It-bag XXL acheté avec moi la semaine dernière ?
— Check.
— Tenue porte-bonheur ?
— Check. J'ai mis mon top chinois, mais il me boudine un peu.
— Rentre le ventre, on n' a plus le temps de se changer là. Pas de miettes de Smacks coincées entre les dents ?
— Check.
— Maquillage ?
— Minicheck. Juste du fond de teint, je ne veux pas passer pour une pétasse.
— Bon point. Et, enfin, le check qui tue : t'es gonflée à bloc ?
— Check, super check. Je vais les manger en brochette.
— Alors, ma belle, tu bouges parce que tu vas être en retard. Appelle-moi tout à l'heure.
J'éteins la TV. C'est parti.
Statut Facebook : Premier jour du reste de ma vie.
Dès que je passe la porte à tambour de Teen TV, les ennuis commencent. À l'accueil, l'hôtesse exige ma carte d'identité en échange d'un badge « visiteur ».
— Je ne suis pas un visiteur mais Marion, la nouvelle assistante de William Desalle. Le directeur d'antenne.
— Je sais qui est William Desalle, mais personne ne m'a parlé de votre arrivée, donc il me faut une carte d'identité. C'est la procédure.
Elle a avalé un balai-brosse et ça lui va bien.
— Les mythomanes prêts à tout pour un casting, je connais. Alors, c'est simple, pas de carte, pas de badge.
Évidemment, je ne l'ai pas sur moi : comme je perds tout, j'évite de me promener avec des trucs importants... C'est une mauvaise technique.
— Vous ne pouvez pas contacter la responsable du personnel ? Ou M. Desalle ? Ils vous confirmeront que je viens d'être embauchée.
— Mme Mignoute est en congé, et William n'est pas encore arrivé. Nous sommes dans une impasse. Désolée.
Heureusement, une fille au décolleté obscène arrive à ma rescousse.
— Lâche-lui la grappe et laisse-la entrer sans discuter.
Ouf, ça marche : l'hôtesse renifle d'un air méprisant, mais elle me tend mon badge. Gagné. Je rattrape en courant la fille qui m'a sauvée.
— ... Euh, merci beaucoup, en fait je ne savais pas qu'il fallait une carte d'identité et... c'est très gentil de votre part...
— C'est pas pour toi que j'ai fait ça. Je ne supporte pas cette nana qui se croit à la CIA et nous gonfle tous les jours avec ses histoires de badge.
Bonjour l'accueil. Ma grand-mère m'a toujours dit de remercier « plutôt deux fois qu'une ». Je crois qu'une suffira amplement. La journée commence fort, mais je ne suis pas du genre à me laisser abattre. Je respire un grand coup, retrouve d'instinct l'open space que m'avait montré William après mon ultime entretien et m'installe derrière le seul bureau libre. Cela m'aura pris huit ans et vingt minutes pour arriver ici.
Nous sommes une dizaine dans l'open space et la chaleur est étouffante. J'apprendrai plus tard que les radiateurs sont bloqués sur 30 mais comme ce n'est le boulot de personne de s'en occuper, ça reste comme ça. Super ! La chaleur me donne soit la migraine, soit la nausée, soit les deux. Note sur mon iPhone pour plus tard : acheter du Spédifen et du Primpéran.
La moquette est tachée, mais les murs sont couverts de disques d'or, et ça, ça me plaît. Chaque bureau dispose de plusieurs télés, de manière à produire le maximum de boucan. J'adore. Les fenêtres sont minuscules, sauf une qui ouvre sur un minibalcon sur lequel on tient à deux, à condition de rester debout. Personne ne me demande ce que je fais là. Je suppose que je devrais me présenter, mais je préfère attendre William. Mon petit bureau est vide. Juste un ordinateur portable et un mug. Le mug n'est pas un cadeau de bienvenue, mais celui de William à qui je dois apporter un thé chaud dès qu'il claque des doigts. Ce mug, c'est mon outil de travail.
Réflexe humain, je jette un coup d'œil rapide autour de moi. Mes collègues sont toutes des filles. Plus précisément des squelettes : la peau sur les os, habillées comme dans les magazines, les cheveux Babylissés. La comparaison avec mon look de la journée me fait mal. Mon top chinois est totalement has been à côté de leurs marinières Jean-Paul Gaultier et leurs jeans Diesel. Idem pour les chaussures : elles portent toutes des talons. De quoi j'ai l'air, avec mes Converse ? Mais le pire, c'est la coupe de cheveux. Avec ma queue-de-cheval, je ressemble à une nana qui passe le concours des ratés de l'Opéra. Ici, la frange est de rigueur. Effilée et oblique. Ou bien droite, style pin-up. Je me suis plantée sur toute la ligne.
En regardant bien, je m'aperçois qu'il y a aussi un garçon, au fond de l'open space. Caché derrière les plantes vertes, il ne bouge pas – si ça se trouve, il est mort. Au milieu de tous ces tas d'os, ça n'aurait rien d'étonnant.
Les yeux baissés, je me répète en boucle que j'ai une chance folle d'avoir trouvé un job ici. Je me suis battue pour être embauchée, avec quatre entretiens, des fringues neuves, des sourires forcés et quelques mensonges. Moi qui ne suis pourtant pas du genre à me la péter, j'ai réussi à leur faire croire :
1° – Que je connais parfaitement les stratégies des chaînes concurrentes (totalement faux).
2° – Que je m'intègre en un clin d'œil dans une nouvelle boîte (alors que ma timidité me pourrit la vie).
3° – Que l'argent compte moins pour moi qu'un travail épanouissant (ce qui est très exagéré).
À 11 heures, mon chef débarque. Il a un look hors du temps, il faudra m'y habituer. Poils de lapin angora fièrement sortis d'un pull moulant col V, cheveux gominés avec la raie au milieu qui dessine des vagues, pantalon en cuir trop court, bottes de moto avec des sangles, genre Easy Rider et dents fluo à la Bon Jovi. Je repense à cet épisode de Friends dans lequel Ross porte un fut en cuir tellement serré qu'il doit mettre du talc pour l'enlever... J'ai envie de rire. Pas lui.
— OK, Marion... alors, t'es grande, tu fais le tour des bureaux et tu te présentes. Je vais balancer un mail pour prévenir de ton arrivée, ils ne vont pas te manger.
Il envoie en effet un mail depuis mon ordinateur, avec une faute à mon prénom (Marine au lieu de Marion). Il me donne aussi les codes d'accès pour lire ses mails.
— Moi, j'ai pas le temps de les lire. Trop de taf, mais tu t'en doutes puisque tu es là pour que je respire. Donc tu gardes les yeux rivés sur ma boîte mail et tu me bipes dès qu'il y a un truc important. Comme tout est important, tu tries parce que je ne veux pas recevoir un texto toutes les cinq minutes. Et tu ne m'appelles pas, je n'ai pas non plus le temps de parler. Tes messages doivent être brefs, clairs et complets. Compris ?
J'ai envie de répondre « Compris chef », mais je me contente d'un petit « Oui, William ». Bref, clair et complet. Pour le moment, il vaut mieux faire profil bas. J'ai bien remarqué aux entretiens que la DRH m'appréciait beaucoup plus que lui. La preuve : il part sans me dire où il va.
En fait, je vais mettre dix minutes pour comprendre que je ne le trouverai nulle part, puisqu'il n'a pas de bureau. Son bureau, c'est le mien. Il viendra quand il en aura besoin et bossera sur mon ordi. Ou bien il me fera faire le boulot, installé sur mon épaule. Le reste du temps, il sera dehors ou en réunion.
Je regarde ses mails dont l'un me concerne directement : « Alors, elle est bonne la nouvelle ? » Super.
Rassemblant tout mon courage, je me présente à mes nouveaux collègues. Ça va vite, personne n'a le temps de bavasser ni de m'expliquer ce qu'il fait – ce qui m'évite de faire semblant de comprendre. Marketing antenne, programmation, bandes-annonces, cross*promo, régie pub... Tout ça me dit quelque chose – de très loin. Je m'étonne à sortir des phrases comme « Ah oui, c'est très très intéressant » en sachant qu'ils ne m'écoutent pas. Tous les termes pro se mélangent déjà dans ma tête, j'ai peur d'avoir vu trop grand en voulant travailler ici. Ils ont l'air super calés, ils parlent de télé comme s'ils racontaient leurs vacances et utilisent des mots comme « Beta num, bug, Q3, Final Cut, conf de presse », sans me donner la traduction.
Perdue dans les couloirs, je passe cinq fois devant les mêmes visages avant de retrouver mon bureau par hasard. Mes collègues doivent me prendre pour une quiche, mais je garde la tête haute, c'est mieux. Planquée derrière mon ordi, j'envoie juste un message de détresse à mes copines :
Objet : Au secours !
Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que je fous là ?
2
Statut Facebook : En mode défaite.
L'heure du déjeuner arrive : gros soulagement, j'ai besoin de sortir respirer. Personne ne me propose de l'accompagner, je fais donc les boutiques du quartier qui n'en manque pas : Opéra, le piège à carte bancaire. Un moche collier plus tard, je me pose sur un banc, déprimée. Pendant cinq ans, j'ai travaillé dans une chambre syndicale. Cinq ans dans la même boîte avec les mêmes personnes. J'étais comme mes nouveaux collègues : je connaissais mon boulot sur le bout des doigts, pouvais répondre à toutes les questions, dépanner en cas de problème (de la formule Excel qui débloque au dossier classé n'importe où). Même si je savais que ma place n'était pas celle-là. Tout ce que j'y ai appris, c'était pour me préparer à la télé. Pour ne pas débarquer sans bagage. Maintenant, je me demande si mon confort ne valait pas mieux... Teen TV, tu es au-dessus de mes compétences. Tu vas me provoquer quelques arrêts cardiaques.
J'ai envie de téléphoner à mes anciens collègues pour entendre des voix familières, mais je ne peux pas. Lorsque j'ai démissionné, j'ai paradé dans les couloirs, toute fière de quitter la chambre syndicale pour un monde de paillettes et de stars. J'étais une warrior, je partais à la guerre pour la gagner. Ça ne faisait pas rêver que moi : j'ai repéré des regards envieux... J'aurais l'air de quoi maintenant, si je leur parlais de mon mal-être ?
Je me sens comme une petite fille le jour de la rentrée des classes, à qui sa mère aurait, en plus, acheté des fringues d'occase. J'ai peur que les gens de la télé soient comme je les imagine... en pire : le nez plein de coke, superficiels, accros au boulot au point d'y dormir, anorexiques, cruels. J'en arrive à me demander ce qui m'a pris de quitter mon job, et pourquoi je ne me contente pas de la regarder avec un pot de Ben & Jerry's, cette fichue télé. J'appelle Vincent pour qu'il me console. Il décroche à la seconde.
—
— Alors, c'est comment de l'autre côté ? Tu t'es fait draguer ? Tu t'es droguée ? T'as vu des stars ?
— Je ne veux pas rester là !
— Non mais t'es folle ! C'est le show-biz, tout ça... Tu ne vas pas laisser tomber, non ? Tu sais combien de filles rêvent d'être à ta place ? Tu vas te remuer un peu le derrière, ma grande !
— Tu ne comprends pas ! Personne ne me parle, je suis grosse, tout le monde est maigre et je n'ai même pas de frange !
Évidemment personne ne te parle, tu y es restée trois heures. T'es pas possible, toi. C'est fini la vie pépère et les horaires de fonctionnaire. Tu as choisi, tu assumes. Et puis c'est quoi, cette histoire d'être grosse ?
— J'ai des bourrelets sur les hanches et mon top est trop petit. J'ai honte, je ne veux pas y retourner.
— Tu n'as aucun bourrelet, tu es parfaite. Bon, écoute-moi bien parce que je le dirai une seule fois : un, tu vas acheter un haut à ta taille dans la première boutique venue. Deux, comme tu vas perdre du temps à l'essayer, tu prends un sandwich. Trois, comme tu n'es pas en forme, tu prends aussi une religieuse au chocolat. Et tu m'appelles ce soir. Et tu souris. Et tu ne chuchotes pas quand on te pose une question, tu ne regardes pas tes pieds, tu t'exprimes. C'est clair ?
— Tu peux répéter à partir de la religieuse ?
— Tu me fatigues. Allez, grouille. Et, oui, une frange t'irait bien.
Je dégote un chemisier noir à manches courtes et bouffantes chez H&M, et une paire de boucles d'oreilles pour détourner les regards de mes cheveux. Je choisis une salade plutôt qu'un sandwich parce que les filles m'ont trop complexée, un Coca light, mais ne fais pas l'impasse sur la religieuse, sinon je ne tiendrai pas tout l'après-midi. Je repars en direction de « Challenge TVe» avec un peu plus de courage – et aussi parce que j'ai plus peur de Vincent que de n'importe quel boulot au monde.
En mon absence, quelqu'un a eu la bonne idée d'installer une télé sur mon bureau. Je m'apprête donc à déjeuner en regardant Teen TV sur mon écran, lorsque je sens le regard pesant de ma voisine d'en face. Elle a l'air aussi étonnée que si j'étais en train de déchiqueter un poulet avec les dents.
— Tu vas vraiment avaler tout ça ?
— Oh... c'est juste une salade et un dessert. J'ai faim... j'ai zappé le petit déj.
Je ne sais pas pourquoi je me justifie devant cette conne qui fait peine à voir avec ses petits bras maigrichons, mais c'est sorti tout seul.
— Ne zappe jamais le petit déj, sinon t'as pas fini de grossir...
— Oui... bien sûr... tu as raison... je...
Sous le choc, je cours ranger ma religieuse au frigo. J'aurais peut-être dû la cacher dès le début maintenant que j'y pense. C'est pas malin, on va me prendre pour une goinfre.
William passe lire ses mails et m'annonce qu'il a du boulot pour moi : il cherche une nouvelle animatrice « fraîche et cool ». À moi de la dénicher. Avec une voix de pré-ado apeurée, je lui parle de la première personne qui me vient à l'esprit, une blonde d'une émission de télé-réalité, à qui il est arrivé de sortir une bonne blague.
— OK, tu la fais venir rapidos, je dois y aller, on se voit demain.
En s’asseyant, il crut vomir de douleur. Il se passa de nouveau la main sur la tête, quelques gouttes de sang tombèrent par terre. C’est une fille qui l’avait entraîné jusqu’ici. Il avait son prénom sur le bout de la langue. Une fille du lycée, une ancienne copine de promo, avec des dents blanches éclatantes et des semelles rouges sous ses chaussures. « Viens dans ma voiture, lui avait-elle murmuré. On sera au chaud. » Ils s’étaient embrassés pendant un moment, la fille adossée à la portière côté conducteur, sa bouche en feu sous la sienne, leurs souffles fumant dans la nuit. Puis elle l’avait repoussé. « Déshabille-toi, lui avait-elle dit. Je veux te voir.
— Mais ça gèle ! » avait-il protesté, tout en commençant déjà à déboutonner sa chemise et à défaire sa ceinture, parce que malgré le froid elle était tellement chaude qu’il n’allait sûrement pas laisser passer cette chance.
Il s’était déshabillé en vitesse, avait retiré son pantalon sans enlever ses chaussures et jeté ses vêtements en tas sur les graviers, et quand il avait relevé la tête, tout nu et frissonnant, cachant son sexe d’une main, elle braquait quelque chose sur lui. Son coeur avait cessé de battre. Un flingue ? avait-il pensé une seconde. Mais non, c’était un téléphone portable.
Le flash l’avait aveuglé.
« Hé ! Qu’est-ce que tu fous ?
— Tu vas voir, avait-elle lancé, hargneuse. Tu vas voir l’effet que ça fait, quand tout le monde se moque de toi ! »
Il s’était jeté sur elle pour attraper le téléphone.
« C’est quoi, ton problème ?
— Mon problème ? »
Elle avait sautillé en arrière dans ses chaussures à semelles rouges.
« C’est toi, mon problème. Tu m’as pourri la vie ! »
Elle avait plongé dans la voiture et claqué la portière avant qu’il ait eu le temps d’atteindre la poignée. Alors qu’elle démarrait dans un vrombissement de moteur, il avait sauté devant elle, pensant qu’elle s’arrêterait. Mais, à en juger par les blessures qu’il avait sur un côté du corps et la douleur atroce qui lui déchirait la tête, elle n’avait sans doute pas pris cette peine.
Il se leva en grognant, puis se tourna vers le country-club, désert et fermé. Dans l’obscurité, il distinguait les courts de tennis, le terrain de golf derrière le bâtiment, les remises et les annexes un peu à l’écart sous un bosquet de pins. D’abord, trouver des vêtements, décida-t-il en boitillant douloureusement vers le bâtiment le plus proche. Des vêtements, et ensuite… la vengeance.
2
Quand j’y repense, j’aurais dû avoir peur en entendant frapper à la porte. Ou au moins être surprise. Ma maison – celle qui m’a vue grandir – se situe dans le dernier virage d’un cul-de-sac à Pleasant Ridge, dans l’Illinois, une banlieue de Chicago de quatorze mille âmes avec des rues tranquilles, des pelouses bien entretenues et de bonnes écoles publiques. On rencontre rarement des piétons dans Crescent Drive. La plupart du temps, le seul signe de vie après dix heures du soir se résume au passage des phares sur le mur de ma chambre les jours où ma voisine, Mme Bass, revient de ses réunions de la Shakespeare Society. Je vis seule, et je suis généralement couchée à dix heures et demie. Quand bien même. Lorsque j’ai entendu frapper, mon pouls ne s’est pas accéléré, mes mains ne sont pas devenues moites. Quelque part dans mon inconscient, là où, selon les scientifiques, se trouvent nos souvenirs, j’attendais depuis des années ce « toc-toc-toc », ce moment où, me dirigeant vers la porte, ma main se poserait sur le cuivre froid de la poignée.
En ouvrant, j’ai retenu mon souffle, les yeux écarquillés. Ma meilleure amie de toujours, Valerie Adler, à qui je n’avais pas adressé la parole depuis l’année de mes dix-sept ans et que je n’avais pas vue depuis la fin du lycée, se tenait sous la lumière du porche. Valerie, avec son visage en forme de coeur, ses lèvres bien dessinées et ses cils aussi denses et sombres que des ailes de papillon de nuit. Elle gardait les mains jointes devant elle, comme pour prier. Une tache sombre marquait l’une des manches de son trench.
Nous sommes restées un instant figées dans le froid, à nous dévisager dans le cône de lumière, et l’idée qui m’a traversé l’esprit avait la chaleur d’un rayon de soleil et la douceur du miel. Mon amie, ai-je pensé en regardant Val. Mon amie est revenue.
J’ai ouvert la bouche – pour dire quoi, je n’en savais trop rien –, mais Val a parlé la première.
« Addie. »
Ses dents brillaient, parfaites et régulières ; sa voix était comme dans mes souvenirs, un peu voilée, une voix qui semblait dire : « J’ai un secret » et qu’elle employait actuellement avec talent pour présenter la météo aux informations du soir, sur la troisième chaîne de télévision la plus regardée à Chicago. Son arrivée à l’écran, six mois plus tôt, avait été annoncée en fanfare, à grand renfort d’affiches le long de l’Interstate. (« Regardez ce que le vent nous amène ! » lisait-on sous une photo de Val, les cheveux détachés, un sourire rouge vif aux lèvres )
«– Écoute. Il est arrivé quelque chose de… de vraiment grave. Tu peux m’aider ? S’il te plaît ? »
Je n’ai rien répondu. Vacillant sur ses talons aiguilles, Val s’est passé les mains dans les cheveux en déglutissant, avant de tripoter la ceinture de son imper. Étais-je consciente qu’elle portait cette coupe de cheveux, cette couleur blond doré, cette longueur en dégradé jusqu’aux épaules avec des mèches qui bouclaient sous la pluie, lorsque j’avais donné le feu vert à mon coiffeur ? Même si je me faisais un devoir de ne pas regarder sa chaîne, j’avais peut-être entrevu Val en zappant, ou bien les panneaux publicitaires m’avaient marquée, car, bizarrement, je me retrouvais là, en pyjama de flanelle et grosses chaussettes en laine, avec les cheveux de mon ex-meilleure amie sur la tête.
« Ma parole ! s’est exclamée Valerie, stupéfaite. Tu es devenue mince !
— Entre, Val. »
Si le temps était une dimension, et non une ligne droite, si l’on pouvait regarder à travers comme on regarde dans l’eau, s’il pouvait onduler et bouger, j’avais déjà ouvert la porte auparavant. J’avais déjà vécu cette scène, et je la revivrais toujours.
— Il manque une chaise.
— Oui, Sibylle.
La maîtresse m'adressait un sourire compatissant.
— Je vais en chercher une dans la classe à côté ?
— Non. C'est exprès, Sibylle.
Je n'étais pas une lumière.
— Pourquoi il n'y a que vingt-deux chaises ? On est vingt-trois !
— C'est le jeu, Sibylle.
— Le jeu, c'est que, y en a un, il ne pourra pas s'asseoir ?
A-t-on jamais enlevé une fourchette à l'un des invités au dîner ? Présente-t-on trois verres d'eau à quatre assoiffés ?
La maîtresse avait détourné la tête pour s'adresser aux autres élèves.
— Je vais jouer du tambourin.
Elle tenait l'instrument en l'air pour que tout le monde voie.
— Lorsque le silence se fera, vous chercherez à vous asseoir. Sans bousculade !
Elle avait insisté sur le terme.
L'enfant resté debout serait éliminé. Elle allait retirer une chaise à chaque tour. À la fin, il n'y en aurait qu'une pour deux.
— Celui qui gagne, c'est le plus malpoli ?
— Garde tes réflexions pour toi.
Fallait-il avoir les nerfs solides !
— J'ai pas envie de jouer !
Bérénice avait compris. Tout le monde allait la pousser, lui écraser les pieds pour un siège.
— Moi non plus.
Éloïse regardait les places à s'arracher avec terreur.
La patiente maîtresse prenait sur elle, on pouvait le voir à son soupir d'épuisement.
— Ce jeu s'appelle les chaises musicales. C'est amusant elle disait, sans rigoler.
Je ne comprenais toujours pas. Des chaises, il y en avait plein l'école. J'allais bientôt refuser de jouer, moi aussi. J'aime pas bouffer avec les doigts, j'aime pas rester debout quand tout le monde est assis.
— Les filles, vous vous êtes plaintes du ballon prisonnier. Alors il faudrait savoir.
— Les garçons lancent le ballon trop fort ! La dernière fois, j'avais une bosse !
Le but : viser la tête de Bérénice.
— Vous vous êtes plaintes des gendarmes et des voleurs. Vous ne voulez pas jouer au foot. Vous n'aimez pas la planche à savon, pas le jeu de massacre.
C'est vrai qu'elles n'aimaient rien, celles-ci, fallait quand même s'avouer.
— Tout le monde participe. On ne peut pas jouer qu'aux scoubidous.
La maîtresse a poussé les chouineuses au milieu des futurs estropiés.
— Prêts ?
Elle a levé la main. On allait bientôt s'amuser.
Je ne savais pas si je devais partir en courant. Où ? Quand ? Comment ? Et si je n'avais pas de chaise ? Quand allait-elle donner le signal ? Fallait-il garder les yeux sur les adversaires, sur les mains de la maîtresse ?
Le son du tambourin a retenti. Tu parles d'une musique... Les coups réguliers ajoutaient à la tension déjà forte. La maîtresse a écarté la main de la peau tendue. Silence.
C'était maintenant qu'il fallait courir !
Un vacarme des plus assourdissants.
Les chaises se sont entrechoquées. Les pieds des enfants se sont entremêlés. Nous nous sommes jetés sans retenue. À s'en déplacer les vertèbres.
Bérénice regardait autour d'elle. Elle ne voulait pas se rendre à l'évidence. Tous les autres étaient assis.
Ben oui, pauvre tache, il n'y a pas assez de chaises pour tout le monde. Elle l'a bien expliqué, la maîtresse !
Les enfants hurlaient de joie, soulagés de ne pas être debout à sa place.
Une voix douce et bienveillante est venue consoler la première victime :
— Tu es hors jeu. Va te mettre contre le mur.
Bérénice a séché ses larmes lorsqu'une nouvelle chaise a disparu. La chouineuse ne resterait pas seule bien longtemps.
Elle guettait : qui allait devenir son ami de déveine ?
Les roulements de tambourin ont repris.
Nous tournions, ralentissions, accélérions. Au prochain tour, je serais assise. N'importe où, sur n'importe quelle chaise, mais j'en aurais une.
Silence.
Le cercle se réduisait de plus en plus. Nous nous bousculions. De plus en plus sauvages, de plus en plus égoïstes, nous nous jetions sur les chaises. Notre vie en dépendait. J'ai tourné, tourné.
Il ne restait plus que deux enfants. Mathieu et moi.
La maîtresse faisait monter la tension. Des coups réguliers sur le tambourin, des coups plus lents. Tatatatin ! Plus un geste dans l'assistance. Qui allait trépasser ? Elle faisait semblant d'arrêter, puis non, elle recommençait. Fausse alerte ! Superdrôle, les éliminés étaient hilares.
Mathieu était le plus fort de la classe, tout le monde le savait. Il courait plus vite que moi, tout le monde avait pu observer dans la cour.
Nous frôlions l'unique chaise dans l'espoir d'y poser nos fesses.
Mathieu a trébuché ! Il se déconcentrait ! Je sentais : j'allais gagner.
Le tambourin s'est arrêté.
Je me suis jetée sur la chaise. Aïe ! Je me suis tordu un orteil !
Peu importe d'avancer sur un pied, à genoux ou en rampant, le but : obtenir la marche du podium.
Alors que je prenais la place du vainqueur, Mathieu s'est éloigné.
Qu'est-ce qu'il fait, ce malade mental ?
La chaise n'a de valeur que si tout le monde la veut. La guillotine n'a d'intérêt que si le condamné veut vivre ! Pourquoi avait-il écarté les bras, en reculant ?
Mathieu laissait la partie se finir sans lui, ma parole !
La victoire m'était offerte comme une pièce à une mendiante, ou quoi ?
— C'est pas du jeu !
Je suis immédiatement allée le pousser. Le fumier s'octroyait mon trône.
Le pourri voulait qu'on comprenne : il n'avait pas besoin de cette gloire, il en avait tant d' autres.
— C'est de la triche ! Voleur !
J'en avais pas beaucoup, des victoires, moi ! Alors tu parles que celle-là, j'allais pas la laisser me passer sous le nez !
— J'aurais eu la place !
Je hurlais à l'injustice.
J'ai jeté un coup de pied dans la chaise. Plus de chaise, plus de perdant, plus de gagnant.
« L'important, c'est de participer. »
C'est ça qu'a dit la maîtresse quand elle m'a attrapé le bras ?
Si c'était ça l'important, je ne me serais pas fait écraser les pieds comme ça !
A-t-on jamais vu le vainqueur partager la couronne ? Qu'est-ce qu'elle racontait maintenant ?
— Ce n'est qu'un jeu.
La maîtresse était devenue folle.
Après avoir foutu une ambiance de mort avec son tambourin qui filait les jetons. Après avoir fait pleurer la classe au complet, elle expliquait : c'était pour rire.
— Personne n'a rigolé à part elle ! j'ai dit au directeur quand j'ai été conduite dans son bureau.
Le directeur a planté ses yeux dans les miens. Sa voix était dure comme de l'acier. Il voulait que ses paroles se gravent dans ma cervelle.
— Quelle que soit la règle, qu'elle te plaise ou non, tu dois la suivre. C'est comme ça qu'on arrive à vivre en collectivité. Tu imagines si tout le monde faisait comme bon lui semble ? Ce serait la jungle.
Si tout le monde faisait comme bon lui semblait, on n'aurait jamais joué à ça, je n'ai pas osé lui répondre.
— Ça ne sert à rien de se bagarrer, surtout pour une chaise, non ?
Je n'ai pas trouvé la réponse, je croyais que c'était ça le jeu, justement.
Il n'y avait qu'une seule chaise dans son bureau ; il était assis dessus.
Mon père avait absolument tenu à rendre un dernier hommage à Tata Lucie, argumentant qu'il ne l'avait pas revue depuis des années (c'était effectivement une bonne occasion de retrouvailles). Il était également désireux de s'occuper de la maison de notre tante jusqu'à ce que la succession soit établie. Louable intention.
Ma mère avait bien un peu tiqué en apprenant qu'il faudrait sacrifier une partie des vacances du mois de juillet, surtout pour se rendre au village de Moncaubet, dans les Pyrénées-Atlantiques, distant de huit cents kilomètres de Paris. Mais mon père, usant de certains arguments convaincants, murmurés à l'oreille maternelle — la pudeur, sans doute —, avait réussi à la décider... Je dirais même plus, à l'enthousiasmer.
Comme je m'étonnais à vive voix de nous voir ainsi faire un tel détour — nous avions initialement décidé de passer le mois à Hossegor, sur le littoral atlantique — pour assister aux obsèques de Tata Lucie que mon père, rappelais-je, avait toujours traitée de « vieille toquée » — entre autres termes —, ce dernier avait tapé des deux poings sur la table de la cuisine où nous achevions de souper en rugissant :
« Et le sentiment familial !... Qu'est-ce que tu en fais du sentiment familial ?... »
Je dois ajouter que, le lendemain matin, une lettre recommandée venant des Pyrénées et adressée à mon père par Me Gérard Lafarge, notaire à Lembeye, n'avait fait qu' encourager le « sentiment familial ».
Je ne saurais préciser le contenu de la lettre, mais il sembla combler de joie son destinataire ; celui-ci, fendu d'un large sourire, le regard rempli d'une gratitude et d'une tendresse subitement retrouvée, avait ordonné que l'on précipite le départ pour Moncaubet.
Je maugréais et traînais les pieds en préparant mes bagages, car je n'avais nulle envie de finir mes vacances dans ce village que j'imaginais comme un trou perdu en pleine cambrousse... Un trou où nous allions enterrer Tata Lucie. Réjouissante perspective ! En plus, moi, la défunte, je ne la connaissais même pas si ce n'est à travers le parfum de scandale qui semblait entourer sa vie.
Les adultes évitaient d'ailleurs soigneusement d'évoquer ce sujet devant les enfants lors des repas familiaux, mais j'avais néanmoins réussi à me faire une vague idée du personnage en saisissant quelques bribes de phrases la concernant :« Quelle honte pour la famille !... Comment a-t-elle pu en arriver là ?... Si cela venait à se savoir !... Chaque famille porte sa croix ! »
Telles étaient les réflexions habituelles que ma mère et mes tantes lâchaient avec force contrariété et mines désolées. Fort curieusement, il suffisait que leurs époux se mêlent à la conversation et celle-ci se terminait toujours en bruyantes démonstrations de rires grivois et de clins d'œil entendus.
Alors qu'un jour, profitant perfidement d'une fin de repas arrosée, je demandais, du haut de mes treize ans, quelque éclaircissement à mon oncle Émile, j' appris plusieurs faits surprenants de sa bouche.
Il m'informa que : « Maintenant j'étais un homme avec du poil sous le nez, sous les bras (et dans des endroits moins avouables de mon anatomie) et qu'en conséquence, cette pilosité envahissante m'autorisait à entrer dans le monde des adultes et à savoir que Tata Lucie... avait fait la vie ! Et, d'après lui, elle devait même être morte d'avoir TROP fait la vie ! »
J'avoue que, sur le moment, mon jeune esprit avait buté devant ces sibyllines déclarations ; comme j'invitais mon oncle à préciser sa pensée, il éclata de rire et répondit en me tapant sur le dos : « Si tu veux l'exacte vérité, mon garçon, notre chère tante, elle avait toujours eu le feu au cul et aucun besoin des pompiers pour l'éteindre ! Un feu qu'elle propageait chez toute la gent masculine du coin ! »
Malencontreusement, ma mère avait saisi la fin de sa phrase et, d'un avertissement impérieux de la tête adressé à Tonton Émile, avait interrompu notre discussion.
Je m'étais fait une idée assez précise du personnage, mais, voulant avoir quelques éclaircissements (curiosité malsaine de mon adolescence, bien entendu), je m'étais donc tourné vers mon frère, alors âgé de vingt ans et donc certainement plus au fait des aptitudes pyromanes de Tata Lucie.
À l'énoncé de ma question, Yves m'avait regardé d'un air navré en me traitant, je le cite, de « puceau » et d'« artichaut » !
Puis il avait lui aussi fini par éclater de rire. Humilié, j'avais décidé une fois pour toutes de ne plus m'intéresser à Tata Lucie : paix à son postérieur.
Un an plus tard, Me Lafarge convoquait mon père à son étude, le deux juillet, juste après l'enterrement de notre tante. Ah ! il fallait voir le paternel se répandre en soupirs attendris et reconnaissants ; ma mère elle-même admit que Tata Lucie, malgré une existence marginale, avait cependant gardé le sens de la famille.
« Le sentiment familial, c'est ce que je disais ! commenta mon père ; et dans la vie, il n'y a rien de plus important... Il est vrai que, de ses quatre neveux, j'ai toujours été son préféré ; ce sont des choses qu'on sent au plus profond de soi... Mais si j'avais pu deviner, s'attendrit-il... si j'avais pu deviner qu'un jour... »
Euphorique, il se jeta soudain sur ma mère, la prit par la taille et entama une valse grossière autour de la pièce en improvisant à tue-tête sur l'air de Plaisir d'amour :
« Tata Lulu... Comment aurais-je pu...
Savoir qu'un jour, tu m' ferais don de tes écus ? »
Mon frère et moi, emportés par l'enthousiasme débridé de notre père, reprenions en riant le refrain qui mettait du soleil dans nos cœurs :
« Tata Lulu... À nous tes beaux écus ! »
Et ma mère, virevoltant autour de la pièce, changeait de cavalier en s'esclaffant comme une gamine. Le visage de mon père — de tempérament déjà sanguin — avait viré à l'écarlate. Il applaudissait à tout rompre devant mes efforts incertains pour accompagner la valseuse.
Cette touchante scène de famille fut brutalement interrompue par la sonnerie du téléphone ; ma mère, encore secouée d'éclats de rire, décrocha le combiné posé sur le poste de télévision. Après une courte formule de politesse, elle tendit gaiement le combiné à mon père :
« Tiens, c'est pour toi, ton frère Gustave !... Il veut te parler. »
Il empoigna le combiné et s'écria :
« Dis donc, le philosophe, on t'a pas souvent au bout du fil ! Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles de la famille ! Alors, continua-t-il sans visiblement laisser à son interlocuteur la chance de placer une parole, toujours à la recherche de la Sagesse ? Sacré Glus ! Quand je pense qu'à l'école, t'étais le plus déluré d'entre nous ! Tout le temps en train de reluquer sous les jupes des filles !... Ah ! où va se nicher la recherche de la Sagesse, hein ?... »
Et il partit d'un rire gargantuesque. C'est qu'il avait son humour, mon père. Il était d'ailleurs souvent son meilleur public. Un humour qui ne brillait pas par sa finesse, certes, mais qui avait le don de le mettre en joie. Heureux homme.
Alors qu'il monopolisait toujours la conversation, ma mère papillonnait autour de lui en le pressant avec force gestes d'abréger ses plaisanteries : les bagages ne se feraient pas tout seuls.
Mais mon père se figea soudain en blêmissant et interrompit d'un regard impérieux le manège de son épouse.
« Quoi ?... Qu'est-ce que tu dis ? Tu peux ré... répéter ? » se mit-i1 à balbutier. Le sang refluait de son visage au fur et à mesure que ses propos perdaient de leur cohérence. « Quoi... que... co... pourq... oui, non, oui... C'est ça, au revoir... à bientôt... »
Livide, il reposa le combiné, considéra pensivement l'écran noir de la télé, puis se tourna lentement vers nous :
« Gustave vient de m'apprendre une terrible nouvelle !... Terrible ! »
Ma mère porta la main à sa bouche dans un geste d'angoisse, craignant sans doute qu'un nouveau décès ne vienne endeuiller la famille. Mon frère et moi nous étions rapprochés, déjà inquiets... quant à la suite de nos vacances.
« Gustave, Émile et Michel ont également reçu une convocation de Maître Lafarge, égrena-t-il d'une voix blanche.
— Oh ! mon Dieu, ce n'est pas vrai ? s'écria ma mère, partagée entre le désarroi et le soulagement. J'ai cru un instant que... mais, d'un autre côté, c'est terrible ! »
Ne saisissant pas le côté « tragique » de la situation, je hasardai une malencontreuse question :
« Qu'est-ce qui se passe ?... On part plus en vacances ?...
— En vacances, en vacances ! Qu'est-ce que tu nous emmerdes avec tes vacances ? vociféra mon père. Mais tu te rends pas compte, non ?...
— Il est trop jeune pour s'intéresser aux affaires d'argent », tenta de le raisonner ma mère.
Elle savait par expérience qu'il fallait éteindre le feu naissant de la colère de son mari avant qu'il ne devienne incendie dévastateur.
« C'est pas la peine de t'énerver et puis...
— Trop jeune ? Trop con, oui ! la coupa-t-il en continuant à rugir. Ah ! la salope ! Ah ! la vieille salope ! Me faire ça, à moi... moi qui l'ai accompagnée dans sa vieillesse ! (En pensée, peut-être, et de loin, sûrement.) Moi ! son neveu préféré, elle le disait toujours !... J'avais même pissé sur sa robe quand j'étais tout gamin et elle en rigolait, et elle en rigolait ! Vous savez ce qu'elle disait à mon sujet : "Regardez ce grand dadais, quand on pense que je l'ai tenu dans mes bras et qu'il m'a pissé dessus !" C'est pas une preuve d'affection, ça ? Hein ?... Et voilà tout le remerciement ! »
Sa voix montait crescendo au fur et à mesure que le feu revenait à ses joues. Il tournait maintenant autour de la table de la cuisine en jurant comme un fou :
« Ah ! la vieille garce !... Me désavantager par rapport à mes frères ! »
Nous l'observions de loin : moi plutôt méfiant, notre mère catastrophée et mon frère, franchement hilare.
« Allons, papa, intervint ce dernier, n'exagère pas... Elle t'a pas désavantagé puisque tu es convoqué au même titre qu'eux.
— Elle m'a pas avantagé ! hurla-t-il... C'est la même chose ! Dans cette maison, personne réfléchit, mais qu'est-ce qu'il va nous rester après le paiement des droits de succession, hein ? Rien !... que dalle ! Une baraque pourrie dans un bled pourri et le tout divisé par quatre ! Et quatre fois que dalle, ça fait pas grand-chose... surtout venant d'une sorcière dépravée !
Le « sentiment » familial devait se retourner dans sa tombe.
« Tata Lulu, se mit à chantonner Yves, je crois que tes beaux écus... nous les avons définitivement dans le... pom pom pom ! »
Il aurait mieux fait de se taire, car cette improvisation lui coûta les vacances sur la côte landaise. Alors que nous finissions de préparer les bagages, je lui expliquai en essayant de le consoler qu'avec les cambriolages qui se multipliaient, il valait mieux que quelqu'un reste pour garder la maison.
J'ai toujours su trouver les mots pour consoler les gens.
En cette matinée de juillet, Paris bâillait dans l'indifférence générale et s'apprêtait à s'endormir pendant deux longs mois. Deux longs mois pour ceux qui restaient dans la capitale, évidemment ; pas pour ceux qui partaient se détendre en s'entassant dans les campings et les plages à la mode.
Depuis notre départ, mon père ne décolérait pas ; d'abord nous avions dû attendre Tonton Émile, sa femme Nathalie et Caroline (leur infernale progéniture) plus d'une heure à l'entrée de l'autoroute. Mon père n'avait pas voulu entendre les explications superflues qu'allait lui présenter son frère sur les embouteillages qui l'avaient retardé et, d'un geste impatient, l'avait invité à franchir le poste de péage.
« On aurait quand même pu leur dire bonjour, avait observé ma mère.
— Pourquoi, tu les vois pas assez souvent ? T'auras tout le temps pour ça quand nous serons arrivés ! »
Une fois le ticket en poche, mon père appuya sauvagement sur l'accélérateur, et la voiture bondit en avant.
Il eut un sourire de satisfaction en constatant qu'il avait cloué son frère sur place ; il faut dire que nous avions une Renault 25 turbo-diesel : le diesel pour l'économie et le turbo pour emmerder Tonton Émile qui ne possédait que la version diesel atmosphérique.
Et comme mon père avait pu, en tant que concessionnaire Renault, acquérir le turbo-diesel au prix du diesel simple, son plaisir était double.
Malheureusement pour lui, la satisfaction qu'il éprouva fut de courte durée, car, cent mètres plus loin, deux gendarmes jaillissaient d'une camionnette banalisée et nous ordonnaient de nous garer sur le côté.
« Pute borgne ! tonna mon père. (C'était là une gaillarde expression qu'il utilisait pour les grandes occasions) Manquait plus que ça ! Qu'est-ce qu'ils me veulent, ces cons ?... »
Il baissa la vitre de sa portière et présenta un visage avenant aux forces de l'ordre. Bonne volonté bien mal récompensée, car l'un des gendarmes, se penchant en avant, jeta d'un ton sec et impérieux :
« Carte grise, carte verte, permis de conduire et talon de vignette ! »
Alors que mon père présentait humblement les papiers demandés, je vis Tonton Émile passer devant nous, hilare. Le turbo l'avait dans le dos !
L'autre gendarme tournait autour de notre voiture comme une mouche autour du cul d'une vache, espérant sans doute découvrir un pneu lisse ou tout autre défaut qui puisse être verbalisable. À chacun son plaisir.
Dépité – sans doute de n'avoir pu terminer son carnet de contravention –, il adressa de la tête un signe maussade à son collègue et rejoignit la camionnette. L'autre rendit les papiers à mon père en maugréant :
« Vous aviez l'air bien pressé tout à l'heure ?...
— C'est que nous nous rendons à un enterrement, Monsieur l'agent, tenta de plaider ma mère.
Serge ne réserve jamais trois mois à l’avance. Serge réserve le jour même ; pour lui, c’est un sport, dit-il. Certains restaurants gardent toujours une table libre pour les gens comme Serge Lohman, et celui-ci en fait partie. Parmi bien d’autres, d’ailleurs. On peut se demander si, dans tout le pays, il existe encore un restaurant où l’on n’est pas pris de convulsions en entendant au téléphone le nom de Lohman. Ce n’est pas lui qui appelle, bien sûr, il demande à sa secrétaire de le faire, ou à un de ses proches collaborateurs. « Ne t’inquiète pas, m’a-t-il dit lors de notre conversation téléphonique il y a quelques jours. Ils me connaissent là-bas, je vais me débrouiller pour avoir une table. » J’avais simplement demandé si nous devions nous rappeler au cas où il n’y aurait pas de place, et sur quel autre endroit nous pourrions nous rabattre. Un soupçon de compassion a percé dans sa voix à l’autre bout du fil, je le voyais presque secouer la tête. Un sport.
Il y avait une chose dont je n’avais vraiment pas envie ce soir-là. Je ne voulais pas être présent quand Serge Lohman serait accueilli comme une vieille connaissance par le restaurateur ou la personne faisant office de gérant ; voir les serveuses le guider vers la plus belle table côté jardin, Serge faire mine de n’y prêter aucune importance, comme si au fond il était toujours resté simple, se sentant par conséquent surtout à son aise parmi d’autres personnes ordinaires.
Je lui avais donc dit que nous nous retrouverions au restaurant et non, comme il l’avait suggéré, au café du coin, un café fréquenté par des gens ordinaires. Voir Serge Lohman y entrer, comme un gars ordinaire, arborant un sourire censé signifier à tous ces gens ordinaires qu’ils devaient non seulement poursuivre à tout prix leurs conversations mais aussi faire comme s’il n’était pas là, de ce spectacle non plus, je n’avais pas envie ce soir.
2
Comme le restaurant n’est qu’à quelques rues de chez nous, nous sommes partis à pied. Nous sommes d’ailleurs passés devant le café où je n’avais pas voulu donner rendez-vous à Serge. J’avais pris ma femme par la taille, elle avait glissé sa main quelque part sous ma veste. Sur la façade du café, une publicité lumineuse annonçant la bière que l’on servait à l’intérieur diffusait une chaude lumière rouge et blanche. « Nous sommes en avance, ai-je dit. Ou plutôt : si nous y allons maintenant, nous serons parfaitement à l’heure. »
Ma femme, il faut que j’arrête d’employer ce mot. Elle s’appelle Claire. Ses parents l’ont appelée Marie-Claire, mais plus tard elle n’a plus voulu porter le nom d’un magazine. Parfois je l’appelle Marie pour la taquiner. Mais je la nomme rarement ma femme – de temps à autre dans des circonstances officielles, dans des phrases comme : « Ma femme ne peut pas vous prendre au téléphone pour l’instant », ou : « Ma femme est pourtant certaine d’avoir réservé une chambre avec vue sur la mer ».
À l’occasion de ce genre de soirée, Claire et moi savourons les moments où nous sommes encore tous les deux. Tout paraît encore ouvert, comme si même le rendez-vous pour le dîner reposait sur une erreur, comme si nous étions simplement tous les deux de sortie. Si je devais donner une définition du bonheur, ce serait celle-ci : le bonheur se satisfait de lui-même, il n’a pas besoin de témoin. « Toutes les familles heureuses se ressemblent, les familles malheureuses le sont chacune à leur façon », dit la première phrase d’Anna Karénine, de Tolstoï. Je me contenterai tout au plus d’y ajouter que les familles malheureuses – et au sein de ces familles en premier lieu les couples malheureux – n’y parviennent jamais seules. Plus il y a de témoins, mieux cela vaut. Le malheur est toujours en quête de compagnie. Le malheur ne peut supporter le silence – et encore moins les silences gênés qui s’installent lorsqu’il se retrouve seul.
Aussi nous sommes-nous souri, Claire et moi, dans le café quand on nous a servi nos bières, sachant que bientôt nous allions passer toute une soirée en compagnie du couple Lohman : nous vivions le plus beau moment de la soirée, tout n’irait par la suite que de mal en pis.
Je n’avais pas envie d’aller dîner au restaurant. Je n’en ai jamais envie. Un rendez-vous dans un proche avenir est la porte de l’enfer, la soirée est l’enfer même. Cela commence le matin devant la glace : que va-t-on bien pouvoir mettre, et faut-il ou non se raser. Tout est alors assertion, que ce soit un jean déchiré et taché ou une chemise repassée. Si l’on garde sa barbe d’un jour, on a été trop paresseux pour se raser ; avec une barbe de deux jours, on vous demande immanquablement si la barbe de deux jours fait partie d’un nouveau look ; et avec une barbe de trois jours ou plus, on n’est plus qu’à un petit pas de la dégradation totale. « Tu es sûr que ça va ? Tu n’es pas malade au moins ? » Quoi qu’il en soit, on n’est pas libre. On se rase, mais on n’est pas libre. Se raser est aussi une assertion. On a visiblement trouvé la soirée si importante qu’on a pris la peine de se raser, voit-on les autres penser – en se rasant on a déjà pris du retard, on est à 1-0.
Et puis Claire est toujours là pour me rappeler, à l’occasion de soirées comme celles-ci, que ce n’est pas une soirée ordinaire. Claire est plus maligne que moi. Mes propos ne sont pas le fruit de considérations mollement féministes pour rentrer dans les bonnes grâces des femmes. Je n’affirmerai d’ailleurs jamais que les femmes sont « en général » plus malignes que les hommes. Ou plus sensibles, ou plus intuitives, ou qu’elles sont « au cœur de la vie » et toutes ces autres idioties qui, tout bien considéré, sont plus souvent proclamées par des hommes prétendument sensibles que par les femmes elles-mêmes.
Claire est tout simplement plus maligne que moi, j’avoue en toute franchise qu’il m’a fallu un certain temps avant de le reconnaître. Les premières années de notre relation, je la trouvais certes intelligente, mais d’une intelligence normale ; somme toute d’une intelligence que l’on pourrait attendre d’une femme qui est la mienne. Je n’aurais sûrement pas tenu plus d’un mois avec une femme bête. Claire était donc en tout état de cause assez intelligente pour que je continue de la fréquenter au bout d’un mois. Et encore aujourd’hui, ce qui fera bientôt vingt ans.
Bon, Claire est donc plus maligne que moi, mais à l’occasion de soirées comme celles-ci, elle me demande encore mon avis sur ce qu’elle doit porter, les boucles d’oreilles qu’elle va mettre, ou si elle doit ou non relever ses cheveux. Les boucles d’oreilles sont à peu près aux femmes ce que le rasage est aux hommes : plus les boucles d’oreilles sont grosses, plus la soirée est importante, festive. Claire a des boucles d’oreilles pour toutes les occasions. On pourrait dire que ce n’est pas malin d’être si peu sûr de ses vêtements. Mais j’ai un autre avis là-dessus. Une femme bête va justement croire qu’elle peut s’en sortir seule. Qu’est-ce qu’un homme connaît à ce genre de choses ? va penser la femme bête, et elle fera le mauvais choix.
J’essaie parfois d’imaginer Babette demandant à Lohman si elle porte la robe qui convient. Si ses cheveux ne sont pas trop longs. Ce que pense Serge de ces chaussures. Les talons ne sont-ils pas trop plats ? Ou au contraire trop hauts ?
Et aussitôt quelque chose ne cadre pas dans le tableau, quelque chose est visiblement inconcevable. J’entends Serge lui répondre : « Non, c’est très bien comme ça. » Mais il est un peu absent, la question ne l’intéresse pas vraiment, et de plus, même si sa femme mettait une robe qui ne convient pas, les hommes n’en tourneraient pas moins la tête sur son passage. D’ailleurs tout lui va bien. Qu’a-t-elle donc à faire tant d’histoires ?
Ce n’était pas un café à la mode, il n’y venait pas de personnages dans l’air du temps – pas cool, aurait dit Michel. Les gens ordinaires étaient de loin majoritaires. Pas spécialement vieux ou jeunes, un ensemble hétéroclite au fond, mais ils étaient surtout ordinaires. C’est ainsi que devraient être tous les cafés.
L’endroit était bondé. Nous étions serrés l’un contre l’autre, près de la porte des toilettes pour hommes. D’une main, Claire tenait son verre de bière et, de l’autre main, du bout des doigts, elle me pressait doucement le poignet.
« Je ne sais pas, disait-elle, mais j’ai l’impression ces derniers temps que Michel se comporte bizarrement. Enfin pas bizarrement, mais pas comme d’habitude. Il est distant. Tu ne trouves pas ? »
Michel est notre fils. Il va avoir seize ans la semaine prochaine. Non, nous n’avons pas d’autre enfant. Nous n’avions pas prévu de mettre au monde un seul enfant mais, à un moment donné, il a été tout simplement trop tard pour en avoir un autre.
« Oui ? ai-je répondu. C’est possible. »
Je devais éviter de regarder Claire, nous nous connaissions trop bien, mes yeux m’auraient trahi. J’ai donc fait mine de regarder autour de nous, d’être particulièrement passionné par le spectacle des clients ordinaires plongés dans des conversations animées. J’étais content d’avoir tenu bon en donnant rendez-vous aux Lohman dans le restaurant ; mentalement, je voyais Serge passer la porte à tambour, avec son sourire pour inciter les gens à surtout ne pas interrompre leurs occupations et à ne pas lui prêter attention.
« Il ne t’a rien dit ? a demandé Claire. Parce que vous parlez ensemble d’autres choses que lui et moi. Peut-être y a-t-il eu une histoire de fille ? Un incident dont il t’aurait parlé plus facilement ? »
Mais celle-ci n’a pas l’air de percuter.
— Minnie, chérie, lâche ce poney.
J’essaie de me montrer calme et déterminée comme Nanny Sue dans son émission à la télé.
— Ponii ! fait Minnie en agrippant le jouet de toutes ses forces.
— Non, pas le poney !
— À Minniiiie ! Mon ponii ! hurle Minnie, folle de rage.
Un mégacaprice ! Tout à fait ce qu’il me faut alors que je croule sous les paquets, le visage trempé de sueur.
Pourtant, jusqu’à maintenant, tout s’était bien passé. Après un tour du centre commercial pour terminer mes courses de Noël, nous nous dirigions, Minnie et moi, vers la Grotte du Père Noël, lorsque que j’ai fait un bref arrêt dans une boutique de jouets pour regarder une maison de poupée. Minnie a tout de suite saisi un poney à roulettes en démonstration et a refusé de s’en séparer. Maintenant je frise le drame.
Une mère en jean slim J Brand, flanquée d’une gamine habillée à la perfection, m’envoie un coup d’œil laser. Je frémis. Depuis la naissance de Minnie, j’ai appris que l’œil laser d’une maman est encore plus féroce que l’œil scanner d’une fille de Manhattan. D’un seul regard de maman à maman, l’œil laser ne se contente pas d’estimer le prix de ce que vous avez sur le dos. Oh, non ! Il évalue ce que porte votre gamin, la marque de sa poussette, son sac à langer, son goûter. Et s’il sourit, crie ou a mauvais caractère.
Bien sûr, ça fait beaucoup en une seconde, mais, croyez-moi, ces mamans dotées de l’œil laser sont capables de faire plusieurs choses à la fois.
Minnie n’a rien à craindre côté fringues. (Robe : exclusivité Danny Kovitz, manteau : Rachel Riley, chaussures : Baby Dior.) Prudemment, je la tiens en laisse (rênes de cuir Bill Amber, hypercool, photographiées dans Vogue). Mais au lieu d’avoir un sourire angélique comme la petite fille du magazine, ma fille piaffe tel un taureau impatient d’entrer dans l’arène. Sourcils levés en signe de fureur intense, joues rose vif, elle s’apprête à hurler en respirant à fond.
— Minnie !
Je lâche la laisse et prends ma fille dans mes bras pour qu’elle se sente en sécurité comme le préconise le livre de Nanny Sue, Soumettre votre enfant rebelle. Je l’ai acheté l’autre jour, par pure curiosité, mais je l’ai à peine feuilleté, étant donné que je n’ai aucun problème avec Minnie. Et qu’elle n’est pas difficile. Ni « incontrôlable et têtue », comme l’a dit l’autre jour la prof de musique complètement idiote du groupe des tout-petits. (D’ailleurs qu’est-ce qu’elle en sait ? Elle est incapable de jouer du triangle convenablement !) Disons que Minnie est… éveillée. Elle a son idée sur tout. Les jeans (elle refuse d’en porter), les carottes (elle refuse d’en manger). À l’instant même, elle a décidé qu’il lui fallait ce poney.
— Minnie chérie, je t’aime beaucoup, dis-je d’une voix douce et suave. Ça me ferait très plaisir si tu me rendais ce poney. Oui, voilà, donne-le à maman…
J’ai presque réussi. Mes doigts se referment sur la tête de l’animal… Ah ! Gagné ! Je regarde autour de moi pour voir si on a observé ma maîtrise de la situation.
— À Minniiie ! Minnie s’est arrachée de mes bras et traverse la boutique en courant. Merde !
— Minnie ! MINNIE !
Ramassant mes paquets, je pars à la poursuite de ma fille qui a déjà disparu dans la section Action Man. Misère ! Pourquoi se donne-t-on tant de mal pour former des athlètes pour les jeux Olympiques, alors qu’il suffirait de lâcher sur le terrain une bande de gamins.
Quand je la rejoins, je suis légèrement hors d’haleine. Il va falloir que je me mette à mes exercices de gym postnatale.
— Donne-moi ce poney !
Je tente de m’en emparer, mais elle s’y cramponne.
— Ponii à Minniiie !
Ses yeux noirs me lancent des étincelles pour faire passer le message. Parfois, en regardant Minnie, je crois voir son père. Ça me fait toujours un choc !
À propos, où est Luke ? On devait faire les courses de Noël ensemble. En famille. Mais il a disparu il y a une heure, prétextant un coup de fil à passer, et je ne l’ai pas revu. J’imagine qu’il est en train de déguster un cappuccino dans un endroit charmant en lisant son journal. Typique !
— Minnie, on ne va pas l’acheter, j’annonce avec fermeté. Tu as déjà une foule de jouets et tu n’as pas besoin d’un poney.
Une fille, le cheveu en bataille, avec deux gamins dans une poussette double m’approuve du regard. Je ne peux m’empêcher de lui lancer un coup d’œil laser : c’est une de ces mères qui portent des Crocs avec des chaussettes tricotées main. (Complètement ringard, non ?)
— C’est monstrueux, vous ne trouvez pas ? s’indigne-t-elle. Ces poneys coûtent 40 livres ! Mes gamins savent qu’ils perdraient leur temps à m’en réclamer un.
Les gamins en question se tiennent tranquilles en suçant leur pouce.
— Une fois qu’on leur cède, ajoute-t-elle, c’est le commencement de la fin. Les miens, je les ai dressés.
Non, mais quelle crâneuse !
— Absolument ! Ce n’est pas moi qui dirai le contraire, je réplique.
— Il y a des parents qui achèteraient ce poney juste pour avoir la paix. Aucun principe. C’est épouvantable.
— Vous avez raison ! dis-je en essayant subrepticement de prendre possession du poney. Mais Minnie esquive ma manœuvre. Malédiction !
— Leur céder, voilà la plus grosse erreur, continue la fille en regardant Minnie d’un air dur. Ensuite ça va de mal en pis.
— Pour ma part, je ne lui cède jamais ! Minnie, tu n’auras pas ce poney, un point c’est tout !
— Ponii, gémit Minnie avant de commencer à sangloter.
Quelle tragédienne ! (Elle tient ça de maman.)
— Bonne chance alors, fait la fille aux Crocs en s’éloignant. Et joyeux Noël !
— Minnie ! Arrête ! j’éructe, dès qu’elle a disparu. Tu nous fais honte à toutes les deux ! D’ailleurs, tu n’as pas besoin de ce jouet ridicule.
— Ponii ! répète-t-elle en câlinant le poney comme si c’était son chien favori qui, après avoir été vendu à un marché à mille kilomètres de là, lui était revenu à pied, les pattes en sang et hurlant à la mort.
— C’est juste un jouet sans intérêt, dis-je en perdant patience. Et d’abord qu’est-ce qu’il a de spécial ?
Pour la première fois, je l’inspecte attentivement.
Waouh ! Je dois admettre… qu’il est irrésistible. Peint en blanc, parsemé d’étoiles scintillantes, avec une tête adorable. Et d’exquises petites roulettes rouges.
— Minnie, tu n’as vraiment pas besoin d’un poney, je répète avec moins de conviction.
Je viens de remarquer la selle. Certainement de cuir véritable. Et sa crinière est en pur crin. Il est vendu avec un mors miniature et une bride. Avec aussi un nécessaire miniature pour le panser !
Dans le fond, il vaut bien ses 40 livres. Tout en jouant avec une de ses roulettes qui tourne parfaitement, je songe : « C’est vrai, Minnie n’a pas de poney. Voilà qui manque à sa collection. »
Pas question pour autant de lui céder.
— Il se remonte ! dit une vendeuse en s’approchant de nous. La clé est dans le socle. Je vais vous montrer. Elle met le mécanisme en marche et, fascinées, nous contemplons le poney qui monte et descend comme un cheval de manège au rythme d’une petite musique cristalline.
Oh, j’adore ce poney !
— Quarante livres, c’est notre offre de Noël. Le reste de l’année, il en coûte soixante-dix. Fabriqué à la main en Suède.
50 % de rabais. Je savais que c’était une bonne affaire. Une occasion à ne pas manquer.
— Il te plaît, n’est-ce pas ?
La vendeuse fait un grand sourire à Minnie qui, calmée d’un coup, lui sourit en retour.
Ce n’est pas pour me vanter, mais elle est vraiment mignonne, ma fille, avec son manteau rouge, ses tresses noires et ses fossettes.
— Alors, vous le prenez ?
— Je… Euh… Je me racle la gorge.
Allons Becky, montre-toi à la hauteur. Sors de ce magasin.
Ma main me désobéit et caresse la crinière.
Mais il est vraiment super. Regardez sa petite tête adorable. Et puis ça ne se démode pas. On ne s’en lassera pas. C’est un bon classique. Une sorte de.… Oui, de tailleur Chanel du jouet.
Et puis c’est Noël. Et c’est un prix spécial. Et, j’y pense soudain, qui sait, Minnie est peut-être douée pour l’équitation. Un poney à roulettes va éperonner sa vocation. Je l’imagine aussitôt, à vingt ans, vêtue d’une veste rouge, tenant un magnifique cheval par la bride et s’adressant aux caméras de télévision des jeux Olympiques : « Tout a commencé à Noël, il y a des années, quand j’ai reçu un cadeau qui a changé ma vie… »
Mon cerveau fonctionne à toute puissance, à la façon d’un ordinateur analysant l’ADN. Comment tout à la fois :
1. Résister à Minnie ?
2. Être une excellente mère ?
3. Acheter ce poney ?
J’ai besoin d’une solution limpide comme celles que Luke achète à prix d’or à des consultants de haut niveau.
La réponse m’éblouit ! Une idée géniale. Incroyable ! Elle aurait dû me venir avant. Je sors mon portable et compose un texto pour Luke.
Luke ! Je viens de penser. Minnie devrait disposer de son argent de poche.
Il répond du tac au tac :
Hein ? Pourquoi ?
Pour qu’elle s’achète des trucs, bien sûr. Je commence à taper puis, prise d’un doute, j’efface ma phrase et envoie :
Les enfants doivent apprendre à gérer leur argent le plus tôt possible. J’ai lu un article sur le sujet. Ça leur donne le sens des responsabilités et des armes pour leur vie d’adulte.
Quelques secondes plus tard, Luke réagit.
Pourquoi ne pas l’abonner au Financial Times ?
Oh ! La ferme ! J’écris. Disons 2 livres par semaine ?
T’es tombée sur la tête ? s’étonne Luke. 10 pence suffisent bien.
Quel radin ! 10 pence ? Qu’est-ce qu’elle va pouvoir acheter avec si peu ?
Et puis on ne pourra jamais s’offrir le poney avec une somme aussi dérisoire.
50 pence par semaine, je tape, exaspérée. C’est la moyenne nationale. (Il ne vérifiera jamais.) Au fait, où es-tu ? Bientôt l’heure d’être avec le Père Noël !!
Bon, comme tu veux. J’arrive, abdique-t-il.
Ce que je suis douée ! En rangeant mon portable, je me livre à un exercice de calcul mental. 50 pence par semaine pendant deux ans font 52 livres. Facile, non ? J’aurais dû penser à l’argent de poche il y a des semaines ! Parfait ! Voilà qui va ajouter une nouvelle dimension à nos emplettes.
Il fut une époque, elle aurait corrigé l’ignorant, émaillé ses propos d’insultes, prononcé les mots littérature, XVIIIe siècle, Pierre-Ambroise Choderlos de Laclos. Pourquoi pas ? Les années passant elle avait policé son discours, comprenant qu’elle ne pesait pas lourd face à l’industrie cinématographique, qu’à force de références culturelles les hommes la prenaient pour une Européenne d’un autre temps, et que la seule façon de pimenter sa vie amoureuse était d’afficher sur son frigo le numéro de téléphone de Steven Spielberg.
Lily vivait à Los Angeles depuis dix ans. Elle avait atterri de Paris sans bagages, danseuse aux jambes lourdes, préretraitée à vingt-cinq ans. Elle avait suivi un amour de transit et finalement adopté cette terre où la foi prend le pas sur les origines, où le soleil ne meurt jamais, où les experts-comptables ont étudié la psychologie et sont accros au yoga. Ici, elle se sentait libre de changer de destinée, de vouloir tout et son contraire. Surtout, comme Françoise Sagan, elle adorait voir défiler les villes à travers les vitres d’une voiture, et elle ne voyait aucune raison de quitter une cité où les passants étaient traqués comme de dangereux criminels.
Bien sûr, Paris lui manquait. Elle regrettait la pierre, les bistrots, l’agitation des rues. Elle pleurait le Café du Théâtre où elle donnait des cours de danse à des petits rats courts sur pattes, la perspective de la place de la Concorde, le désordre des trottoirs, les parcmètres bariolés, l’humour français, noir et noble, la cuisine française, goûteuse et recherchée, l’élégance parisienne.
Heureusement, se disait-elle, la particularité des souvenirs est de s’estomper avec le temps. Un jour ou l’autre, on oublie les sensations de jouissance passées, la vue, le goût, le toucher. On finit par se damner pour un scone aux abricots de chez Starbucks et par s’émerveiller devant l’architecture du Kodak Theater sur Hollywood Boulevard. On adapte son degré d’exigence, on le place au niveau le plus bas sur l’échelle du plaisir. Est-ce pour cela qu’elle était capable de garder son calme face à ce Valmont du dimanche qu’elle fréquentait dans les périodes creuses ? Certes, il bénéficiait d’un physique avantageux et d’une dentition parfaite, mais il possédait la culture d’un enfant de six ans et parlait comme Marlon Brando dans Le Parrain, d’une voix sourde et oppressante, persuadé d’y gagner en charisme, ce qui consternait Lily.
Elle fila sous la douche puis jeta sur le lit les affaires de son invité encore assoupi, le pressant de retrouver ses esprits et de rentrer chez lui. À dix heures trente, Lily était enfin seule, savourant un thé vert et s’étirant avec discipline avant d’accueillir sa première cliente. Depuis quelques années maintenant, elle s’était imposée comme l’une des grandes prêtresses du bien-être californien. Adepte de la médecine chinoise, elle avait érigé le shiatsu au rang du plus puissant des antibiotiques. Son carnet de rendez-vous était complet des semaines à l’avance et ses honoraires déraisonnables, les Américains considérant avec méfiance les commerçants bon marché.
Elle occupait un penthouse au dernier étage d’une petite copropriété de Hollywood, sur Rossmore Avenue, dans le quartier de Larchmont. L’appartement était assez vaste et bien agencé pour lui permettre d’y installer son cabinet. Doyenne de l’immeuble, si l’on excluait la gardienne Cora et Pedro, son époux, qui vivaient là depuis bientôt quarante ans, Lily était également la mieux lotie, ce qui encourageait ses voisins à lui rendre visite avec fidélité.
Il régnait dans cette résidence un esprit communautaire rafraîchissant, chacun s’inquiétant du confort de l’autre tout en respectant une chaleureuse cacophonie. Au premier étage se trouvait Luke, jeune peintre à la cote déclinante dont Lily avait acheté la première toile. Dépressif depuis la fin de son état de grâce, Luke vivait dans un mutisme névrotique, au grand soulagement des habitants qui s’étaient lassés des bœufs nocturnes improvisés dans son appartement du temps de son succès. Surtout Georges, qui habitait juste au-dessus. À soixante-dix ans, le vieil homme n’était plus d’humeur à raccourcir ses nuits, d’autant que les amis de Luke, rockeurs à l’ouïe anesthésiée, étaient loin d’avoir le sens du rythme de son idole, Sylvie Vartan. C’est pour elle que Georges vivait là aujourd’hui. À la mort de son épouse, deux ans plus tôt, il avait liquidé ses biens parisiens et s’était enfui sur les traces de la chanteuse yé-yé, exilée depuis de nombreuses années en Californie. Jusqu’à présent, il n’avait pas réussi à la localiser, mais l’étau se resserrait, il le sentait. Georges partageait le palier avec Jane et Charly, couple trentenaire dont la progéniture était aussi impolie qu’indisciplinée.
Parfois, Lily avait l’impression de vivre dans un joyeux asile de fous, et elle pensait qu’il fallait effectivement avoir érigé la zénitude au rang d’art de vivre pour pouvoir endurer pareille effervescence. Pourtant, pour l’avoir vue trébucher sans grâce dans le hall de l’immeuble et percuter à plusieurs reprises la porte d’entrée, Cora, la gardienne des lieux, commençait à douter de l’équilibre de vie de Lily et de l’utilité de nettoyer les vitres tous les jours.
Lily vivait seule, sans doute parce qu’elle n’avait jamais pu s’adapter aux règles du dating américain où la fidélité est exclue de toute relation amoureuse. Sans doute aussi parce que ses compagnons ne manquaient jamais de la décevoir. Elle les trouvait étriqués, guindés, obsédés par leur image et les codes de leur époque. Elle s’était toujours rêvée en Alice Roosevelt, elle aurait aimé avoir le culot, comme elle en son temps, de se jeter habillée dans une piscine à la face de diplomates austères, préférant la noyade à leur carcan. Cette ambition, elle le savait, était incompatible avec une vie maritale. Alors, pour l’instant, elle se contentait de nager en bikini et de garder la tête hors de l’eau pour faire du gringue au maître-nageur.
Chaque jour, elle se forçait à adopter une attitude positive, un état d’esprit résolument optimiste. Seulement, Lily avait appris à déceler les limites de l’exercice. Le destin est paresseux et pervers, il vous force à vivre par anticipation pour supporter l’ennui et le vide. On s’imagine dans dix, vingt, trente ans, les bras chargés de marmots, jonglant avec un mari exigeant, une nounou capricieuse, une carrière encombrante. Le problème, pensait-elle, c’est que l’on est assez idiot pour croire que la vie se charge de vous surprendre, on imagine qu’elle est un amas d’inconnus et de vertiges alors qu’elle est prévisible et mène quoi qu’il arrive les hommes à leur perte.
Un instant, elle s’était imaginé que le succès et la notoriété effaceraient son tempérament mélancolique, que les hommes la traiteraient avec plus de considération, de déférence, qu’ils arrêteraient de chercher en elle une mère ou une psy sous prétexte qu’elle savait atténuer en quelques pressions leurs douleurs et écouter sans impatience leurs lamentations.
Elle s’était résolue à lire l’œuvre évocatrice du docteur John Van Epp, avait découvert qu’une crise d’identité culturelle accélère souvent, et pour le pire, le processus d’engagement, et que les règles permettant d’éviter les mauvais coucheurs étaient au nombre de trois : ne pas se jeter sur le premier venu, prendre soin de se connaître et le temps de rester seule entre deux ruptures. D’abord affligée par tant de lieux communs, elle avait fini par reconnaître l’utilité de cette méthode, celle-ci vous empêchant tout simplement de rencontrer un homme. Puis elle s’était empressée d’accepter l’invitation de Valmont, désireux d’aller visiter une boutique Prada en plein désert texan, projet qui l’enthousiasma jusqu’à ce que Valmont lui annonce qu’il allait de ce pas réserver une chambre twin au Motel 6.
2
500 Rossmore Avenue
3e étage – chez Lily
12 mars
— Son pouls, ça va ?
— Ça va, répondit Lily tout en maintenant la pression sur le poignet de l’enfant qui, à cet instant, semblait aussi fragile qu’un nouveau-né.
— Pourquoi tu ne le lâches pas, alors ?
— Parce que j’essaie de me concentrer.
— Tu peux l’endormir longtemps comme ça ?
— Jane, s’il te plaît !
— Une mauvaise mère, je suis une mauvaise mère.
— Tu as simplement perdu le sens de la mesure.
— Cet enfant va me rendre dingue.
— Jane, je ne peux pas t’aider si tu m’interromps constamment.
Les gémissements de sa mère réveillèrent Noah qui s’était endormi sous les mains de Lily. Il s’agita un instant sur le tatami avant qu’une pression à l’avant-bras ne le paralyse à nouveau. Ainsi immobile il avait l’air d’un ange, avec cette peau immaculée, ces yeux bleus rieurs et ces mains boudinées qui vous donnaient envie de les croquer.
Jane s’éloigna de la table de travail et alla se caler dans un canapé d’angle au cuir mœlleux. Elle observa son amie malaxer le corps inerte de son fils, ligoter ses cordes vocales, transpercer l’espace bruit. Elle inspira profondément et laissa le silence pénétrer ses pores. Depuis la naissance de Noah, sept ans plus tôt, elle avait sacrifié tant de choses, le sommeil pour commencer. Elle avait honte de l’en blâmer. Après tout, il n’était qu’un enfant et il n’était pas responsable de ses actes. Comment avait-elle pu laisser un gamin capricieux diaboliser son foyer, les éloigner à ce point, réprimer le moindre geste d’affection ? Pourquoi n’avait-elle pas fixé des règles plus tôt, calfeutré le monde où Noah n’avait pas sa place ? Elle aurait pu sauter du train, l’empêcher de quitter la voie, mais il avait fallu que la nature la prive de ce courage, la drape d’apathie.
Elle passait tout à tout le monde. À son fils pour quelques minutes de silence. À son mari pour quelques secondes d’attention. Ils s’aimaient par intermittence, entre deux caprices, les courses, les devoirs, les punitions. Jane avait perdu dix kilos, elle était aussi fragile qu’un fil de laine et nageait dans ses jeans, un uniforme qu’elle ne quittait qu’en de rares occasions. Ses yeux clairs avaient perdu de leur étincelle, même ses longs cheveux blonds semblaient plus ternes. Cette semaine, Noah avait dessiné au feutre sur les murs de l’appartement car il ne trouvait pas de feuille de papier, puis il avait découpé le costard de son père pour se déguiser en Batman avant d’avaler une bille et de s’ouvrir le genou en tombant. Même le diable n’était pas capable de tant d’hostilité en si peu de temps. À plusieurs reprises, Charly avait claqué la porte, laissant Jane creuser seule les tranchées. Ce matin, il était parti travailler sans un mot, ni même un baiser. Jane avait pleuré, avalé un Lexomil par mesure préventive, anticipant une crise d’angoisse qui ne manquerait pas de la foudroyer. Puis elle avait affiché son plus beau sourire pour aller réveiller son fils.
La cuisine avait été refaite juste avant le passage à l’an 2000. Elle avait coûté 100 000 francs, ce qui, à l’époque, était une somme, mais les Royer avaient les moyens. Sans pour autant posséder cette immense fortune dont quelques-uns sont dotés à la naissance, Nathalie Royer détenait un joli patrimoine familial qu’ils avaient fait fructifier sans jamais avoir eu besoin de toucher au capital. Les revenus du couple étant par ailleurs confortables, les Royer n’avaient donc pas hésité à s’équiper, de même qu’ils avaient entièrement repeint leur maison, de cette cuisine Mobalpa dans laquelle se déroule la première scène du roman. Le décor est assez traditionnel, le couple ayant opté pour un classicisme à l’italienne, mais la pièce est conviviale. C’est ici qu’ils prennent leurs petits déjeuners.
Si l’on effectue un zoom arrière, on constate qu’un salon et une salle à manger attenante sont également situés au rez-de-chaussée de cette maison de maître qui date de la fin du XIXe siècle. Les meubles sont essentiellement d’époque Louis XV, commode en marqueterie de fleurs, petites tables en chiffonnière dans les coins et pendule rocaille sur le manteau de cheminée. Cependant, hormis deux sièges et deux bergères sculptées, les Royer ont choisi des canapés en cuir de chez Roche Bobois, plus contemporains et plus pratiques pour recevoir. À l’arrière, l’ancienne lingerie a été réaménagée en un confortable bureau d’une douzaine de mètres carrés. Le premier étage dessert trois chambres, dont deux possèdent leur propre salle de bains. Légèrement en retrait du palier, un petit escalier mène à une autre porte, probablement une quatrième chambre. Mais elle est toujours fermée à clef et il semble que personne n’y aille jamais.
Sur Google Earth, on voit que la maison est située dans le triangle d’or d’une ville résidentielle et huppée des Yvelines, voisine de Saint-Germain-en-Laye mais cependant beaucoup plus petite. La plupart des habitants se connaissent, et souvent d’une génération à l’autre. Car quand on est natif de Bois-Joli, à moins d’un problème grave, on y reste toute sa vie.
Dans cette agglomération, le mandat du maire UMP est reconduit sans heurt depuis une vingtaine d’années, il en a été de même de son prédécesseur RPR, et le taux de fréquentation de l’église est nettement supérieur à la moyenne nationale. Bien que d’esprit très français, Bois-Joli s’est développé en s’inspirant du modèle sociétal anglo-saxon. L’efficacité de ses œuvres de charité et la variété de ses clubs privés en témoignent. Lorsque, au milieu des années 1980, des entreprises européennes et américaines de technologies de pointe ont investi la région, un lycée international a été implanté dans la commune voisine. Depuis, le nombre d’expatriés n’a cessé de croître.
♠
Ce 15 septembre 2008, Nathalie s’est levée d’humeur fragile. Elle aurait préféré rester dans son lit. Ce n’est pas tant le froid, car la température de septembre est encore douce, qui la met dans cet état, mais la bruine persistante lui donne le cafard. Ainsi qu’une ou deux autres choses auxquelles elle essaie de ne pas penser.
Le premier geste de Nathalie en se réveillant est de mettre la cafetière en marche. Puis, pendant que le café filtre lentement, elle passe à la salle de bains. Une fois qu’elle a uriné, elle vérifie sa toison, à la recherche d’un poil grisonnant. Cet examen est parfaitement inutile car Nathalie est blonde et n’a que très peu de cheveux blancs. Mais cette nouvelle manie est due au fait qu’elle approche des cinquante ans, et bien qu’elle n’ait jamais imaginé avoir un jour la vanité de cacher son âge, elle ne l’assume pas. Nathalie trouve que c’est un passage délicat pour une femme, d’autant qu’il s’accompagne de désagréments comme les bouffées de chaleur et les insomnies qui la rendent vulnérable et irascible. Le plus affligeant dans tout ça, pense-t-elle en se lavant les mains, c’est l’altération du désir. Pas tant sur le plan sexuel, car depuis que Patrice ne la sollicitait plus, elle se découvrait au contraire des appétences parfaitement incongrues et qu’elle ne soupçonnait pas. En réalité, ce qui rend Nathalie nostalgique, c’est la perte d’envie. Avant, elle éprouvait, du plaisir à manger un gâteau, à acheter une nouvelle paire de chaussures, à organiser son week-end annuel dans une capitale européenne. Aujourd’hui, elle ne ressent plus rien. Personne dans son entourage ne s’en aperçoit, pas plus Patrice qu’Amélie ou l’une ou l’autre de ses amies. Car Nathalie continue de s’habiller avec soin et se maquille tous les matins. Elle a déjà planifié un voyage à Londres pour le printemps prochain. Elle suit l’actualité, a des idées et les exprime, même si Patrice la contredit systématiquement, et reçoit des gens à dîner. Si rien ne transparaît de son vague à l’âme, c’est parce que Nathalie a toujours voulu sauver les apparences. C’est important pour elle, le qu’en-dira-t-on. Heureusement, son travail lui permet de garder la tête hors de l’eau. Nathalie possède une agence immobilière qui lui fait temporairement oublier que sa vie, tout comme son horloge biologique, est cruellement en train de se détraquer.
Lorsqu’elle pénètre dans la cuisine, Patrice est déjà là. Il s’est servi sa première tasse avant que l’eau ne se soit entièrement écoulée, ce qui a toujours eu le don d’agacer Nathalie. Mais plutôt que de lui en faire la remarque, elle s’assoit en face de lui.
— Tu as bien dormi ? lui demande Patrice en beurrant un toast.
Nathalie avait eu un sommeil agité et s’était réveillée plusieurs fois dans la nuit, ce que Patrice aurait dû savoir s’il faisait plus attention à elle. Elle attend donc qu’il lui dise quelque chose, un mot, n’importe lequel, ou bien qu’une inflexion différente, plus tendre peut-être, lui fasse sentir qu’il est là, avec elle, mais il n’ajoute rien. Il a posé la question comme ça, machinalement, comme le font entre eux les gens bien élevés. Ce qu’ils sont, indiscutablement.
— Il faudrait que tu achètes du beurre. Et du lait. Il n’y en a presque plus.
Nathalie ne répond pas, se lève et allume la radio. La banque d’investissement Lehman Brothers vient d’être déclarée en faillite.
— C’est une catastrophe ! s’écrie Nathalie en augmentant le volume. Tu te rends compte ? Et si notre banque aussi faisait faillite ?
— Ne sois pas ridicule !
— Mais qu’est-ce qu’on peut faire ?
— Qu’est-ce que tu veux faire ? Retirer ton argent et le cacher sous les lames du parquet, comme tes parents en 68 ?
Il ouvre son journal, visiblement agacé, puis le referme brutalement avant d’ajouter :
— J’espère que la populace ne va pas réagir comme toi, sinon l’économie française ira droit à la catastrophe !
Nathalie cherche du regard ses céréales mais Patrice a laissé la boîte dans le placard. Elle n’a pas envie de se lever de nouveau. Elle prend un toast chaud dans la panière et croque dans le pain sec. Puis elle se sert un bol de café fumant. Son estomac est noué.
— Tu es au courant que l’immeuble du boulevard des Sablières est à vendre ? reprend Patrice pour changer de sujet. Axa démantèle en appartements. Tu pourrais te mettre sur les rangs... Il y a déjà plusieurs agences...
— Ce n’est pas mon créneau.
Au loin, ils entendent une porte claquer. Puis une seconde, suivie d’une cavalcade dans l’escalier. Une masse vêtue de noir pénètre dans la cuisine, jette négligemment un sac sur le sol et ouvre le réfrigérateur. Parfois, Nathalie a l’impression que sa fille est un Shadok, un de ces petits personnages qui faisaient un tabac à la télévision dans les années 1970.
— Bonjour Amélie ! dit Nathalie en élevant la voix.
Elle ne supporte pas l’incivilité de sa fille.
— Y a plus rien à manger ici !
— J’aimerais que tu dises bonjour le matin !
Nathalie a pris ce ton glacial qu’elle affectionne depuis toujours.
— C’est trop te demander ?
— Salut salut...
— Par ailleurs, si tu as des doléances sur l’approvisionnement de la maison, le supermarché est à 300 mètres.
— C’est pas ça, mais le matin je bois du Danao ! C’est quand même pas difficile à piger !
— Arrête de te plaindre ! Et coiffe-toi. Tu fais négligée.
Amélie a claqué la porte d’entrée et Patrice s’est éclipsé. Nathalie entend le scooter démarrer et l’eau de la douche s’écouler. Elle regarde ses ongles puis prend un bloc dans lequel elle note les tâches de la journée. Ils reçoivent à dîner et Nathalie ne veut rien oublier. Lorsque Patrice est sur le point de partir, elle le rejoint dans l’entrée.
— À ce soir ! dit-il en l’embrassant sur le front.
Il ajuste sa cravate, prend son attaché-case et sort en laissant derrière lui le sillage boisé de son eau de toilette. Habituellement, à cette heure, Nathalie est également sur le point de sortir, mais pas aujourd’hui. Car aujourd’hui est un jour différent. Une date à propos de laquelle elle aurait aimé que Patrice dise quelque chose.
Elle prend le calendrier 2008 de l’Association familiale catholique de Bois-Joli coincé derrière le radiateur et examine la page du 15 septembre. Saint Notre-Dame-des- Douleurs. Nathalie lit à haute voix la citation de saint Anselme. Votre peine, Vierge sacrée, a été la plus grande qu’une pure créature ait jamais endurée ; car toutes les cruautés que nous lisons que l’on a fait subir aux martyrs ont été légères et comme rien en comparaison de votre douleur. Elle a été si grande et si immense qu’elle a crucifié toutes vos entrailles et a pénétré jusque dans les plus secrets replis de votre cœur. Pour moi, ma très pieuse Maîtresse, je suis persuadé que vous n’auriez jamais pu en souffrir la violence sans mourir, si l’esprit de vie de votre aimable Fils...
La voix de Nathalie se casse. Elle reprend.
Si l’esprit de votre aimable Fils pour lequel vous souffriez de si grands tourments ne vous avait soutenue et fortifiée par sa puissance infinie.
Les pieds de Nathalie effleurent le carrelage à damier et montent l’escalier. Dix-neuf ans ! Comment Patrice avait-il pu oublier cette date ! Son cœur se décroche sous l’effet de la colère. Elle entre dans sa chambre, prend dans le tiroir de sa commode un minuscule objet, qu’elle tient dans son poing serré, et s’assoit sur le bord du lit, les bras repliés, l’esprit ailleurs. Enfin, elle resserre les pans de sa robe de chambre et ramasse ses cheveux en un chignon serré. Puis elle ouvre le placard du palier et prend un balai, un chiffon doux et un spray dépoussiérant. Elle gravit ensuite la dizaine de marches supplémentaires qui mène à la chambre bleue et introduit la clef dans la serrure.
Patrice monte dans sa 607 en pensant que ce sera peut-être la dernière berline haut de gamme produite par Peugeot. Pourtant, il ne se résout pas à acheter allemand ou japonais l’année prochaine. Les Royer sont, de père en fils, fidèles aux marques françaises et l’histoire montre qu’ils ont eu raison. À présent, Patrice lutte à son petit niveau contre l’hégémonie chinoise et refuse cette hypermondialisation qui s’est développée au détriment des plus beaux fleurons français. Il ne sait pas si ses idées s’apparentent à un protectionnisme d’extrême droite ou si elles sont plus proches d’un système de pensée gauchiste, mais cela lui est égal. Il ne se reconnaît aucunement dans les extrêmes, de toute façon, même s’il se situe à droite de la majorité, qu’il considère trop centriste.
Il allume Europe 1 et sourit en entendant la voix de l’humoriste. En roulant à une vitesse raisonnable jusqu’à son cabinet, il pourra entendre l’intégralité de la revue de presse de Nicolas Canteloup. Patrice Royer est avocat. Spécialiste du droit de la famille. 80 % de ses affaires concernent des divorces. Sa clientèle est en partie constituée d’hommes qui pensent que, par solidarité masculine, il défendra mieux leurs intérêts. Ce qui est une absurdité.
Soudain, Patrice jure en freinant. Il réalise qu’il a oublié chez lui un dossier sur lequel il a travaillé la veille. Il met son clignotant à gauche puis refait le chemin inverse en appuyant sur le champignon.
— Tu as l'air pâle, fiston. Tu aurais mieux fait de rester en bas.
— Non, ça va, répondit l'enfant, qui peinait à contenir son anxiété. Mais je descendrai à l'étage suivant.
Je n'arrive plus à respirer !
L'homme se pencha vers lui.
— Je croyais que tu avais vaincu ta phobie, dit-il en lui caressant affectueusement la joue.
Le garçon s'en voulait de décevoir son père, mais le sifflement dans ses oreilles devenait insupportable et occultait toutes ses pensées.
Je ne peux plus respirer... il faut que je sorte de là !
Le liftier racontait quelque chose de rassurant sur les pistons articulés et la structure en fer puddlé. Loin en contrebas, les rues de Paris s'étendaient dans toutes les directions.
On y est presque ! songea le garçon en levant la tête vers la plate-forme panoramique qui approchait. Encore un peu de courage !
Sur la dernière portion du trajet, le puits de l'ascenseur se redressait brutalement pour former un étroit tunnel vertical.
— Papa, je ne crois pas que...
Soudain, une série de craquements résonnèrent au-dessus de leurs têtes. Une secousse agita la cabine, qui oscilla de manière peu rassurante. Des câbles déchirés fouettèrent l'air tels des serpents furieux. Le garçon tendit la main vers son père.
— Papa !
Ils échangèrent un regard terrifié qui ne dura qu'une seconde.
Et ce fut la chute.
Robert Langdon se réveilla en sursaut. Ébranlé par ce cauchemar, il se redressa sur son siège en cuir. Il était le seul passager à bord du Falcon 2000EX, un avion d'affaires spacieux qui était en train de traverser une zone de turbulences ; les deux réacteurs Pratt & Whitney ronronnaient à l'extérieur. Tout allait bien...
— Monsieur Langdon ? grésilla une voix dans l'interphone. Nous amorçons notre descente.
Se redressant, Langdon rangea ses notes dans son sac en cuir. Il était plongé dans le texte de sa conférence sur les symboles maçonniques quand son esprit s'était doucement mis à dériver. S'il avait rêvé de son père décédé, c'était sûrement à cause de l'invitation inattendue qu'il avait reçue le matin même de la part de Peter Solomon, son mentor de longue date.
La seconde personne au monde que je ne voudrais pas décevoir...
Le philanthrope, historien et scientifique de cinquante-huit ans avait pris Langdon sous son aile près de trente ans auparavant, comblant à plus d'un titre le vide laissé par la mort de son père. Langdon avait trouvé chez Peter Solomon une humilité et une bienveillance qui ne s'étaient jamais démenties malgré son immense fortune et le pouvoir considérable de sa famille.
Par le hublot, Langdon vit que le soleil s'était couché. Il parvint néanmoins à distinguer la silhouette effilée du plus grand obélisque du monde, qui se dressait sur l'horizon telle l'aiguille d'un cadran solaire antique. Le monument en marbre de cent soixante-dix mètres de hauteur était édifié au cœur même de la nation, au centre d'une géométrie méticuleuse de rues et de bâtiments historiques.
Même depuis les airs, Washington était auréolé d'une puissance presque mystique.
Langdon adorait cette ville. À l'instant où les roues touchèrent la piste, il se sentit euphorique à l'idée de ce qui l'attendait. L'avion roula jusqu'à une zone de stationnement privée de l'aéroport international de Washington-Dulles.
Après avoir rassemblé ses affaires et remercié les pilotes, Langdon émergea de la cabine luxueuse et descendit les marches escamotables. L'air froid de janvier le calma aussitôt.
Respire, Robert ! pensa-t-il en se réjouissant de retrouver l'air libre et les grands espaces.
La nappe de brouillard qui recouvrait le tarmac donnait à la piste des airs de marécage.
Une voix chantante perça la brume.
— Bonjour ! Professeur Langdon !
Levant la tête, il aperçut une femme d'une quarantaine d'années, munie d'un badge et d'un bloc-notes, qui s'approchait d'un pas vif en agitant joyeusement le bras. Ses cheveux blonds bouclés dépassaient d'un bonnet en laine.
— Bienvenue à Washington, professeur !
— Merci, fit Langdon en souriant.
— Je suis Pam, du service passager de la compagnie, déclara-t-elle avec une exubérance presque dérangeante. Si vous voulez bien me suivre, une voiture vous attend.
Tous deux se dirigèrent vers le terminal Signature, qui était cerné de jets privés scintillants.
Une borne de taxi pour gens riches et célèbres ! songea Langdon.
— Pardon de vous importuner, hasarda la femme timidement, mais vous êtes bien le Robert Langdon qui écrit des livres sur les symboles et la religion ?
Après un instant d'hésitation, il hocha la tête.
— J'en étais sûre ! Dans mon club de lecture, nous avons lu votre livre sur le féminin sacré et l'Église. Vous avez provoqué un de ces scandales ! C'était absolument merveilleux ! Vous aimez donner des coups de pied dans la fourmilière, vous !
— Ce n'était pas vraiment mon intention.
La femme sentit que Langdon n'était guère enclin à discuter de son travail.
— Je suis désolée. Toujours en train de jacasser. Vous devez en avoir assez que les gens vous reconnaissent. Mais c'est de votre faute, dit-elle en désignant ses vêtements d'un geste taquin. Votre uniforme vous trahit.
Mon uniforme ?
Langdon baissa les yeux : il portait l'un de ses habituels cols roulés gris anthracite, une veste Harris Tweed, un pantalon de toile et des mocassins en cuir. Sa tenue standard pour les cours, les conférences, les photos officielles et autres sorties en société.
— Vos pulls sont complètement démodés, expliqua la femme en gloussant. Vous auriez l'air beaucoup plus chic avec une cravate.
Pas question, je n'aime pas les nœuds coulants !
À l'époque où Langdon fréquentait la Phillips Exeter Academy, il était obligé de porter des cravates six jours sur sept. Le directeur de l'université avait beau attribuer à la cravate l'origine romantique de la fascalia en soie que les orateurs romains portaient pour se réchauffer les cordes vocales, Langdon savait que le mot cravat était dérivé étymologiquement d'une bande de mercenaires « croates » sans pitié qui partaient au combat avec un foulard noué autour du cou. Des siècles plus tard, cet accessoire était devenu l'attribut des guerriers modernes qui menaient leurs batailles dans des salles de réunion, avec la même volonté d'intimider l'ennemi.
— Merci pour le conseil, répondit Langdon avec un petit rire. J'y penserai à l'avenir.
Par bonheur, un homme en costume sombre sortit à ce moment-là d'une luxueuse Lincoln noire et lui fit signe.
— Monsieur Langdon ? Beltway Limousine. Charles, à votre service, fit-il en ouvrant une portière. Bonsoir et bienvenue à Washington, monsieur.
Langdon laissa un pourboire à Pam pour son accueil chaleureux, avant de s'installer dans l'habitacle somptueux de la voiture. Le chauffeur lui indiqua les commandes de la climatisation et lui proposa de l'eau minérale et un panier de muffins chauds. Quelques secondes plus tard, la Lincoln quittait l'aéroport par une voie privée.
C'est donc ça le quotidien des riches ?
Tout en accélérant sur Windsock Drive, le chauffeur consulta sa feuille de route et passa un coup de fil.
— Ici Beltway Limousine, déclara-t-il avec une concision toute professionnelle. Comme vous l'avez demandé, j'appelle pour confirmer la prise en charge de mon passager. Oui, monsieur, ajouta-t-il après un silence, votre invité, le professeur Langdon, est bien arrivé. Je le déposerai au Capitole pour 19 heures.
Il raccrocha.
Langdon ne put s'empêcher de sourire.
Toujours aussi méticuleux...
Le souci du détail était l'une des grandes qualités de Peter Solomon ; c'était ainsi qu'il gérait son immense pouvoir avec une aisance déconcertante.
Avoir quelques milliards de dollars sur un compte en banque facilitait également bien des choses...
Langdon s'enfonça avec délice dans la banquette moelleuse et ferma les yeux tandis que les bruits de l'aéroport s'estompaient derrière lui. Le Capitole était à une demi-heure de route, ce qui lui laissait quelques instants de répit pour mettre de l'ordre dans ses pensées. Les événements de la journée s'étaient succédé à une telle vitesse qu'il n'avait pas eu le loisir de réfléchir sérieusement à l'incroyable soirée qui s'annonçait.
*
À une quinzaine de kilomètres du Capitole, un personnage solitaire attendait avec impatience l'arrivée de Robert Langdon.
Je contemplai mon reflet dans le miroir. Je n’étais pas vraiment jolie, mais ma chevelure épaisse me caressait les épaules. J’étais plus bronzée sur les bras et le visage que sur le reste du corps, mais au moins ne serais-je jamais blanche comme un cachet d’aspirine grâce aux racines amérindiennes de mon père. Samuel avait refermé la coupure que j’avais au menton de deux points de suture et un bleu me noircissait l’épaule (des dégâts minimes étant donné que j’avais combattu une chose qui aimait manger des enfants et avait déjà mis KO un loup-garou). Le fil chirurgical noir ressemblait, sous certains angles, aux pattes noires et brillantes d’une araignée. En dehors de ces petites blessures, mon état physique était parfait. Le karaté et la mécanique me maintenaient en forme.
C’était loin d’être le cas pour mon âme, mais cela, je ne pouvais le voir dans mon miroir. Avec un peu de chance, personne d’autre ne s’en apercevrait. C’étaient ces dégâts invisibles qui m’empêchaient de sortir de la salle de bains et d’affronter Adam, qui attendait dans ma chambre. Et cela, même si je savais parfaitement que jamais Adam ne me ferait subir quoi que ce soit contre mon gré… et même si c’était quelque chose que je désirais depuis un bon bout de temps.
Je pouvais toujours lui demander de partir. J’avais besoin de temps. Je dévisageai la femme dans le miroir, mais elle se contenta de me dévisager en retour.
J’avais tué celui qui m’avait violée. Allais-je le laisser obtenir la victoire finale ? Le laisser me détruire, comme cela avait été son intention première ?
— Mercy ?
Adam n’avait nul besoin de hausser la voix. Il savait que je l’entendais.
— Attention, répondis-je en arrachant mon regard du miroir et en enfilant une culotte propre et un vieux tee-shirt. J’ai une canne antique et je sais m’en servir.
— La canne se trouve sur ton lit, remarqua-t-il.
Quand je sortis de la salle de bains, Adam aussi se trouvait allongé sur mon lit.
Ce n’était pas un homme très grand, mais il n’avait pas besoin de ça pour ajouter à son charisme. Ses pommettes larges, ses lèvres charnues et sensuelles qui couronnaient un menton volontaire lui donnaient une beauté de star du cinéma. Lorsque ses yeux étaient ouverts, ils étaient d’un brun chocolat à peine plus clair que les miens. Son corps était presque aussi beau que son visage, même si je savais qu’il ne voyait pas les choses ainsi. Il se maintenait en forme parce qu’il était l’Alpha et considérait son corps comme un outil nécessaire au bien-être de sa meute. Avant le Changement, il avait été soldat, et sa formation militaire était encore flagrante dans la manière dont il se déplaçait et dans celle dont il prenait les choses en main.
— Quand Samuel rentrera de l’hôpital, il ira passer le reste de la nuit chez moi, dit Adam sans ouvrir les yeux.
Samuel était mon colocataire, c’était un médecin et un loup solitaire. La maison d’Adam se trouvait juste derrière la mienne. Elles étaient séparées par un terrain de quatre hectares, le quart de celui-ci m’appartenant et le reste à Adam.
— Nous avons le temps de parler, reprit-il.
— Tu as une mine atroce, lui dis-je, sans vraiment le penser. (Il avait effectivement l’air épuisé et des cernes marquaient ses yeux, mais à moins qu’il se fasse mutiler, je ne pensais pas qu’il puisse vraiment avoir une mine atroce.) Ils n’ont pas de lits, à Washington ?
Il avait dû se rendre à Washington (la capitale, pas l’État où nous nous trouvions) le week-end précédent pour tenter de régler quelques petits problèmes dont j’étais à l’origine. Bon, évidemment, s’il n’avait pas réduit le cadavre de Tim en morceaux devant une caméra, et si le DVD qui en avait résulté n’avait pas atterri sur le bureau d’un sénateur, il n’y aurait pas eu le moindre problème. Donc, d’un certain côté, c’était aussi partiellement sa faute.
Mais c’était surtout celle de Tim, et de celui qui avait fait une copie du DVD et envoyé celui-ci au sénateur. Je m’étais occupée de Tim. Et visiblement, Bran, le grand chef loup-garou de tous les grands chefs loups-garous, avait l’intention de se charger de l’autre personne. L’année dernière, je me serais attendue à une annonce de funérailles pour celle-ci. Mais cette année, avec les loups-garous qui venaient à peine de rendre leur existence officielle aux yeux du monde, Bran se montrerait probablement plus circonspect, Quant à savoir ce qu’il allait faire, c’était une autre histoire.
Adam ouvrit les yeux et les posa sur moi. Dans la demi-pénombre de la chambre (il avait seulement allumé ma petite lampe de chevet), on aurait dit qu’ils étaient noirs. Il arborait une expression morne, absente l’instant d’avant, et je savais que c’était à cause de moi. Parce qu’il n’avait pas été en mesure de me protéger… et les gens comme Adam ont tendance à prendre ce genre de choses très à cœur.
Personnellement, j’estimais qu’il me revenait d’assurer ma propre sécurité. Et même si cela impliquait parfois que j’appelle des amis à l’aide, il s’agissait néanmoins de ma propre responsabilité. Toutefois, Adam le considérait comme un échec.
— Alors, as-tu pris ta décision ? demanda-t-il.
Allais-je l’accepter comme compagnon ? Voilà ce qu’il voulait dire. La question se posait depuis bien trop longtemps et cette incertitude influençait sa capacité à garder la maîtrise de sa meute. D’une manière plutôt ironique, ce qui s’était passé avec Tim avait réduit à néant mes objections quant à une relation avec Adam. Je me disais que si j’avais été capable de résister à la potion magique des fées que Tim m’avait fait boire, ce n’était pas le mojo de l’Alpha qui serait en mesure de me transformer en esclave docile.
Peut-être aurais-je dû le remercier avant de le frapper avec le démonte-pneu.
Adam n’est pas Tim, me répétai-je. Je repensai à la rage avec laquelle Adam avait défoncé la porte de mon garage, à son désespoir lorsqu’il avait dû me contraindre à boire de nouveau à ce fichu gobelet fae. En dehors de sa capacité à m’ôter toute volonté, l’artefact avait aussi un pouvoir de guérison, et j’avais grand besoin d’être guérie à ce moment-là. Il avait obtenu l’effet escompté, mais gardait l’impression de m’avoir trahie, et il pensait aussi que j’avais toutes les raisons de le haïr désormais. Mais cela ne l’avait pas empêché de le faire. À mon sens, c’était la preuve qu’il ne mentait pas quand il disait m’aimer. Lorsque je m’étais cachée sous forme de coyote à cause de la honte (je le mettais sur le compte de la potion des fées, parce que je savais… oui, je savais que je n’avais aucune honte à ressentir à ce propos), il m’avait tirée de sous son lit, m’avait mordu le nez pour me punir d’être idiote avant de me serrer dans ses bras pendant toute la nuit qui avait suivi. Puis il m’avait procuré la sécurité et la compagnie de sa meute, que je le veuille ou non.
Tim était mort. Et de toute façon, il avait toujours été un loser. Et il était hors de question que je sois la victime d’un loser… ou de qui que ce soit d’autre, d’ailleurs.
— Mercy ?
Toujours allongé sur mon lit, Adam restait sur le dos, en position de vulnérabilité.
Pour toute réponse, j’ôtai mon tee-shirt et le laissai tomber au sol.
Il se leva plus rapidement que je l’avais jamais vu bouger, l’édredon dans les mains. Je n’eus même pas le temps de cligner des paupières qu’il l’avait déjà enroulé autour de moi… et que je me retrouvai serrée contre lui, mes seins nus contre sa poitrine. Il avait légèrement tourné la tête et mon visage était plaqué contre sa joue.
— J’avais l’intention de nous séparer avec l’édredon, à la base, dit-il d’un air coincé. (Je sentais nos cœurs battre à l’unisson et ses bras contractés tremblaient.) Je ne veux pas que tu te sentes obligée de coucher avec moi ici et maintenant. Un simple « oui » aurait suffi.
Je sentais son excitation… N’importe qui aurait pu la sentir, même sans mon odorat de coyote. Je fis glisser mes mains de ses hanches à son ventre musclé, puis le long de ses côtes, savourant l’accélération de son rythme cardiaque et la fine rosée de sueur recouvrant son visage sous l’effet de mes douces caresses. Je sentis les muscles de sa mâchoire se contracter alors qu’il serrait les dents, la chaleur qui envahissait sa chair. Je soufflai doucement dans son oreille et il s’écarta de moi, comme si je l’avais touché avec une baguette électrique.
Des stries ambrées marquaient à présent ses iris, et ses lèvres étaient plus pleines et rouges qu’auparavant. Je laissai tomber l’édredon sur mon tee-shirt.
— Bon sang, Mercy !
Il détestait jurer devant les femmes. C’était toujours un petit triomphe personnel quand je parvenais à lui faire proférer des insanités.
— Ça ne fait même pas une semaine que tu t’es fait violer, reprit-il. Je ne coucherai pas avec toi tant que tu n’auras pas parlé à quelqu’un, un thérapeute, un psychologue, que sais-je ?
— Je vais bien, répliquai-je, même si en fait, une fois hors de sa portée et du sentiment de sécurité qu’il m’apportait, je sentais effectivement mon estomac se retourner. Adam fit face à la fenêtre, me tournant le dos.
— Non, tu ne vas pas bien. Souviens-toi, chérie, on ne peut pas mentir à un loup.
Il laissa échapper un soupir forcé, puis se passa vigoureusement la main dans les cheveux en essayant de se débarrasser de son trop-plein d’énergie. Son geste fit se dresser sur le sommet de son crâne une myriade de petites boucles qu’il gardait ordinairement parfaitement disciplinées.
— Et de qui parlons-nous là ? demanda-t-il, pas vraiment à mon adresse. De Mercy. Une fille pour qui parler de soi est aussi agréable que de se faire arracher les dents. Quant à parler de soi à un étranger…
Je ne m’étais jamais considérée comme une personne ayant des difficultés particulières pour s’exprimer. À vrai dire, on me reprochait plutôt d’avoir une trop grande gueule. Samuel m’avait souvent dit que j’augmenterais mon espérance de vie si j’apprenais parfois à tenir ma langue.
J’attendis donc, sans un mot, qu’Adam prenne sa décision quant à la suite des événements.
Il ne faisait pas vraiment froid dans la chambre, mais je frissonnai néanmoins. Sûrement les nerfs. Mais si Adam ne se dépêchait pas de faire quelque chose, je risquais de retourner vomir dans la salle de bains. J’avais passé beaucoup trop de temps à vénérer la déesse de porcelaine, depuis que Tim m’avait gavée de jus de fées, pour qu’une telle perspective me réjouisse.
Adam ne me regardait pas, il n’en avait nul besoin. Les émotions ont une odeur. Il se retourna vers moi en fronçant les sourcils et vit en un seul regard dans quel état je me trouvais.
Il poussa un juron et s’avança vers moi avant de me prendre dans ses bras. Il me serra tout contre lui en émettant des bruits de gorge graves et rassurants. Il me berça doucement.
J’inspirai l’air saturé par son odeur à pleins poumons et tentai de mettre un peu d’ordre dans mon esprit. En temps normal, cela n’aurait pas dû me poser le moindre problème. Mais normalement, je ne me trouvais pas quasiment nue dans les bras de l’homme le plus sexy que je connaisse.
J’avais mal compris ce qu’il voulait.
Pour m’en assurer, je m’éclaircis la voix.
— Donc, quand tu m’as dit que tu voulais une réponse à ta demande aujourd’hui, tu ne pensais pas au sexe ?
Je sentis son corps secoué par un rire soudain et sa joue frotter contre la mienne.
— Tu penses donc que je suis le type de personne qui ferait ce genre de chose ? Après ce qui s’est passé la semaine dernière ?
— Je croyais que c’était le seul moyen d’accepter ta proposition, grommelai-je en me sentant rougir.
— Pendant combien de temps as-tu vécu au sein de la meute du Marrok ?
Il le savait très bien. Il se moquait juste de moi.
— Personne n’a cru nécessaire d’aborder le sujet de l’accouplement avec moi, répliquai-je sur la défensive, à part Samuel.
Adam rit de nouveau. Il avait une main sur mon épaule et l’autre me caressait doucement la fesse, un contact qui aurait dû chatouiller, mais ce n’était pas le cas.
— Et j’imagine que de son côté, il ne te racontait que la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, pas vrai ?
Je resserrai mon étreinte. Bizarrement, mes mains avaient atterri sur le bas de son dos.
— Probablement pas. Donc, tout ce dont tu avais besoin, C’était de mon accord ?
Il poussa un grognement.
— Ça ne suffira pas pour la meute, pas tant que ce ne se sera pas concrétisé. Avec Samuel hors jeu, il me semblait que tu serais en mesure de déterminer si tu étais intéressée ou non. Si tu ne l’avais pas été, j’aurais pu reprendre les rênes de la meute. Mais maintenant que tu as manifesté ton intérêt, je suis prêt à t’attendre jusqu’aux calendes grecques.
Ses paroles semblaient parfaitement raisonnables, mais son odeur me disait autre chose. Elle m’apprenait que ce que j’avais dit avait calmé ses inquiétudes et que son esprit était désormais concentré sur tout autre chose que notre discussion.
Comme pour bon nombre de gens qui ont leur propre entreprise, mes journées de travail sont longues et commencent tôt. Autant dire que lorsque quelqu'un m'appelle au milieu de la nuit, il a plutôt intérêt à ce que ça soit une question de vie ou de mort.
— Bonsoir, Mercy, susurra la voix aimable de Stefan à mon oreille. Je me demandais si tu pouvais me rendre un service.
Vu que Stefan était mort depuis un moment, je ne vis aucune raison d'être aimable.
— J'ai déjà répondu au téléphone à (je regardai mon réveil) 3 heures du matin.
Bon, d'accord, ce n'est peut-être pas exactement ce que j'ai dit. Il est fort possible que j'aie ajouté certains de ces mots que les mécaniciens utilisent lorsqu'un boulon leur résiste ou qu'un alternateur leur atterrit sur les pieds.
— J'imagine que tu pourrais me demander un deuxième service, ajoutai-je, mais j'aimerais assez que ça soit lors d'un coup de fil ultérieur à une heure décente.
Il rit. Peut-être pensait-il que j'essayais de faire de l'humour.
— J'ai un travail à faire et il me semble que tes talents si particuliers pourraient m'être très précieux pour réussir cette mission.
D'après mon expérience, les créatures anciennes ont toujours tendance à rester un peu vagues lorsqu'elles vous demandent un service. Je suis une femme d'affaires, et je préfère avoir tous les détails aussi rapidement que possible.
— Tu as besoin d'une mécanicienne à 3 heures du matin ?
— Je suis un vampire, Mercy, me dit-il gentiment. Trois heures du matin, c'est le début de soirée, pour moi. Mais ce n'est pas d'un mécanicien dont j'ai besoin. C'est de toi. Tu me dois une faveur.
Ce maudit vampire avait parfaitement raison. Il m'avait donné un coup de main lorsque la fille de l'Alpha local s'était fait kidnapper. Et il m'avait avertie que, un jour ou l'autre, il demanderait un service en retour.
Je m'assis dans mon lit en bâillant et en abandonnant tout espoir de me rendormir.
— D'accord. Que puis-je faire pour toi ?
— Je suis censé remettre un message à un vampire qui se trouve dans les environs sans la permission de ma maîtresse, dit-il en allant droit au fait. J'ai besoin d'un témoin qu'il ne remarquera pas.
Il raccrocha sans me laisser le temps de lui répondre, ou même de me dire quand il passerait me prendre. Ça lui ferait bien les pieds si je me contentais de me rendormir.
En marmonnant, j'enfilai quelques vêtements : un jean, mon tee-shirt de la veille, orné d'une belle tache de moutarde, et mes chaussettes dont à peine une seule était trouée. Une fois plus ou moins habillée, je me traînai jusqu'à la cuisine et me servis un verre de jus de cranberry.
C'était la pleine lune, et mon colocataire, en bon loup-garou, était allé courir avec la meute locale. J'étais donc dispensée de lui expliquer que je sortais avec Stefan. Ce qui était une bonne chose.
Non pas que Samuel soit un colocataire difficile, mais il avait un peu tendance à se montrer possessif et autoritaire. Non que j'aurais toléré qu'il le soit, mais la négociation avec un loup-garou était un exercice nécessitant beaucoup de subtilité, trop pour moi à - je regardai ma montre - trois heures et quart du matin.
Même si j'ai grandi parmi eux, je ne suis pas un loup-garou, ni un quoi que ce soit garou, d'ailleurs. Je ne suis pas esclave des phases de la lune et, sous la forme de coyote qui est la mienne quand je ne suis pas humaine, je ressemble à n'importe quel canis latrans : les marques de chevrotine sur mon arrière-train le prouvent.
On ne peut en revanche pas confondre un loup-garou avec un loup :les garous sont bien plus gros que leurs cousins non surnaturels... et bien plus effrayants.
Moi, je suis une marcheuse, bien que je sois sûre qu'il y a autrefois eu un autre nom pour ceux de ma sorte : un nom indien, cannibalisé par l'influence dévorante de l'Europe sur le Nouveau Monde. Peut-être mon père aurait-il pu m'en dire plus s'il n'était pas mort dans un accident de la route sans même savoir que ma mère était enceinte. Les loups-garous m'avaient donc appris tout ce que je savais, et ce n'était pas grand-chose.
Le terme « marcheur » vient des « Marcheurs de peau » des tribus indiennes du Sud-Ouest américain. Mais d'après mes lectures, j'ai moins de points communs avec eux qu'avec les loups-garous. Je ne suis pas magicienne, je n'ai nul besoin d'une peau de coyote pour me métamorphoser... et je ne suis pas maléfique.
Je sirotais mon jus de fruits en regardant par la fenêtre. Je ne voyais pas la lune, seulement sa lumière argentée qui effleurait le paysage nocturne. Penser au Mal était plutôt de circonstance, alors que j'attendais qu'un vampire vienne me ravir. Au moins, ce genre de pensées m'empêcherait-il de me rendormir. Je suis comme ça, moi : j'ai vraiment peur du Mal.
Dans notre monde moderne, le terme peut sembler... démodé. Quand il montre brièvement son vrai visage en la personne d'un Charles Manson ou d'un Jeffrey Dahmer, on trouve toujours plein d'explications : trop de drogues, une enfance malheureuse ou une maladie mentale...
Les Américains, en particulier, sont presque naïfs dans leur foi absolue en la science en tant que réponse à tout. Quand les loups-garous ont enfin révélé leur existence, il y a plusieurs mois, les scientifiques se sont immédiatement mis à la recherche d'une bactérie ou d'un virus pouvant expliquer le Changement : leurs laboratoires et leurs ordinateurs n'étaient pas équipés pour détecter la magie. Aux dernières nouvelles, la prestigieuse fac de médecine Johns Hopkins avait toute une équipe consacrée à la question. Sans doute obtiendraient-ils des résultats, mais je pariais qu'aucune explication scientifique ne pourrait justifier qu'un homme de quatre-vingts kilos puisse se transformer en loup-garou de cent vingt kilos. La science ne laisse pas plus de place à la magie qu'au Mal.
Cette croyance béate dans le fait que le monde est explicable est à la fois un terrible point faible et une solide armure. Le Mal préfère que ses victimes ne croient en rien. Les vampires, pour donner un exemple, pas tout à fait au hasard, vont rarement tuer des gens au hasard dans la rue. Quand ils vont chasser, ils partent à la recherche de victimes qui ne manqueront à personne et qu'ils ramèneront chez eux, là où elles seront chouchoutées et engraissées... comme des vaches dans une ferme d'élevage intensif.
La science reine avait permis que les bûchers de sorcières, ordalies et autres lynchages publics soient relégués au passé. En échange, le citoyen modèle, respectueux de la loi et rationnel, n'avait pas à s'inquiéter des créatures qui erraient dans la nuit. J'aurais parfois préféré être l'un de ces citoyens modèles...
Les citoyens modèles n'ont pas droit aux visites de vampires.
Et les meutes de loups-garous ne déclenchent pas en eux un sentiment d'inquiétude. Enfin, si, mais pas exactement le même que le mien.
Le coming out avait été une étape cruciale pour les loups-garous. Cela pouvait très bien se retourner contre eux. Le regard perdu dans la nuit, j'imaginai ce qui se passerait si les gens recommençaient à avoir peur. Les loups-garous n'étaient pas des êtres maléfiques, mais ils n'étaient pas non plus les héros pacifiques et respectueux de la loi pour lesquels ils essayaient de se faire passer.
On frappa à ma porte.
Les vampires sont maléfiques, eux. Je le savais. Mais Stefan était plus qu'un simple vampire. Parfois, j'étais quasi certaine qu'il était mon ami. Raison pour laquelle aucun sentiment de peur ne m'animait jusqu'à ce que je voie ce qui se tenait sur mon paillasson.
Le vampire avait plaqué ses cheveux en arrière, offrant la peau livide de son visage à la lumière blafarde de la lune. Vêtu de noir de pied en cap, il aurait dû ressembler vaguement à un figurant sorti d'un mauvais film sur Dracula. Pourtant, cette tenue, qui allait du long pardessus noir en cuir jusqu'aux gants de soie, semblait plus authentique sur Stefan que ses habituels jeans pourris et tee-shirts flashy. On aurait dit qu'il venait d'ôter un déguisement plutôt que l'inverse.
Il avait l'air de quelqu'un qui tuait avec autant de difficulté et de scrupules que j'en aurais eu pour changer une roue.
Ses sourcils mobiles s'arquèrent comiquement et il redevint le vampire qui avait repeint son vieux minibus Volkswagen pour qu'il ressemble à la Mystery Machine de Scoubidou.
Je ne me rendis pas immédiatement compte qu'il s'agissait d'un loup-garou.
Mon odorat n'est pas à son meilleur quand il est saturé de cambouis et d'huile de vidange, et ce n'était pas comme s'il y avait beaucoup de loups-garous errants qui galopaient dans le coin. Aussi, quand j'entendis, près de mes pieds, quelqu'un s'éclaircir la voix pour attirer mon attention, je crus d'abord que c'était un client.
Je me trouvais sous le compartiment moteur d'une Jetta, affairée à y réajuster une boîte de vitesses que j'avais réparée. L'un des désavantages d'être seule à m'occuper d'un garage, c'est que je devais interrompre mon travail dès que le téléphone sonnait ou qu'un client s'annonçait. Ça me mettait en rogne, ce qui n'est jamais une bonne chose quand on tient un commerce. Mon fidèle employé de bureau et aide-mécano était parti à l'université, et je n'avais pas encore eu l'occasion de le remplacer – sans compter que trouver quelqu'un pour faire ce qu'on ne veut pas faire n'est pas tâche aisée.
— Je suis à vous dans une seconde, lançai-je, en essayant de dissimuler mon agacement.
J'essaie, autant que possible, de ne pas effrayer mes clients éventuels.
Avec les vieilles Jetta, les bras hydrauliques ne servent à rien, les seuls qui peuvent caser la boîte de vitesse dans son compartiment biscornu sont actionnés par des muscles solides. Parfois, être une femme a ses avantages dans mon boulot, comme mes petites mains qui se glissent dans des endroits inaccessibles à de grandes pattes viriles. La plupart du temps, je mets amplement à profit l'effet levier, mais parfois rien ne se substitue à la pure puissance musculaire. Là, j'en avais tout juste assez pour maintenir la boîte en place.
Avec un grognement, je la calai avec une main et mes genoux et, de l'autre main, je l'amarrai d'un premier écrou. J'étais loin d'avoir terminé, mais au moins cette boîte resterait-elle en place en attendant que je m'occupe de mon client.
Je respirai un grand coup et étirai brièvement mes lèvres pour m'entraîner au sourire commercial avant de me dégager de sous la voiture. Essuyant mes mains huileuses avec un chiffon qui traînait, je demandai :
— Puis-je vous aider ? avant de me rendre compte que, si ce gamin n'avait certainement pas l'apparence d'un client, il avait en tout cas l'air d'avoir besoin que quelqu'un l'aide.
Son jean était troué aux genoux et taché de ce qui ressemblait à de la boue et du sang séché. Il portait une chemise de flanelle trop petite sur un tee-shirt sale, une tenue bien peu adaptée à un mois de novembre dans l'est de l'État de Washington.
Son aspect émacié laissait penser qu'il n'avait rien mangé depuis un bon moment. Mon nez me disait, même à travers les vapeurs d'antigel, d'essence et d'huile, qu'il n'avait pas non plus vu de douche durant cette période.
Et, derrière la saleté, la sueur et la peur, se tapissait l'odeur caractéristique du loup-garou.
— Je me demandais si vous n'auriez pas du boulot pour moi ? demanda-t-il d'un ton peu assuré. Pas un vrai travail, m'dame, juste de l'aide, ici ou là. (Le parfum d'anxiété qui émanait de lui fut noyé par une décharge d'adrénaline quand il vit que je ne répondais pas immédiatement par la négative. Il se mit à bégayer.) Un vrai travail, ça m'irait aussi, hein, c'est juste que comme je n'ai pas ma carte de sécurité sociale, il faudrait que ce soit en espèces...
La plupart du temps, ce sont les immigrés clandestins qui sont intéressés par du travail au noir, entre la saison des semailles et celle des récoltes. Ce garçon, lui, avec ses cheveux châtains et ses yeux noisette, était indubitablement américain – enfin, en plus d'être loup-garou. Il aurait pu avoir dix-huit ans, si l'on en jugeait par sa taille, mais mon instinct, en général pas mauvais, me disait qu'il était plus proche de la quinzaine. Avec ses épaules, larges mais osseuses, et ses mains un peu trop grandes, il semblait encore devoir grandir un peu avant d'atteindre sa taille adulte.
— Je suis costaud, dit-il. Je ne m'y connais pas beaucoup en réparation de voitures, mais j'aidais mon oncle à entretenir sa Coccinelle.
Ça, qu'il soit costaud, je voulais bien le croire : les loups-garous sont connus pour l'être. Depuis que j'avais senti cette odeur si particulière de musc et de menthe, je ressentais le besoin instinctif de le chasser de mon territoire. Cependant, n'étant pas un loup-garou, je suis capable de maîtriser mes instincts, et de ne pas me laisser dominer par eux. Évidemment, ce pauvre gamin qui grelottait dans l'humidité de novembre déclenchait aussi chez moi d'autres instincts, plus profonds...
J'ai pour principe de respecter la loi. Je conduis sous la limite de vitesse, mes voitures sont toutes en règle question assurance, et je paie même un peu trop d'impôts. Il m'est parfois arrivé de donner un ou deux billets de vingt dollars à des gens qui en avaient besoin, mais jamais je n'ai embauché quiconque ne pouvant apparaître dans ma comptabilité. Le fait qu'il soit un loup-garou, et un jeune si je ne me trompais pas, n'aidait pas non plus : les garous récents ont encore moins de prise sur leur loup que les autres.
Il n'avait fait aucun commentaire sur le fait qu'une femme mécano, ça n'était pas habituel. Bien sûr, il devait avoir pris le temps de m'observer et de se familiariser avec le concept, mais tout de même, il avait réussi à ne rien dire, et ça, c'était un bon point pour lui. Mais pas assez bon pour ce que je m'apprêtais à faire.
Il se frotta les mains et souffla sur ses doigts rougis par le froid pour les réchauffer.
— Bon, on va voir ce qu'on peut faire, dis-je doucement.
Ça n'était pas la plus raisonnable des réponses, mais c'était la seule que je pouvais lui donner en le voyant ainsi agité de longs frissons.
— Il y a une buanderie et une douche derrière cette porte, repris-je en désignant l'arrière-boutique. Mon ancien assistant a laissé quelques bleus de travail sur les patères. Tu peux prendre une douche, laver tes fringues et en enfiler un en attendant que ça sèche. Il y a un sandwich au jambon et du soda dans le frigo. Déjeune, et reviens me voir quand tu seras prêt.
J'insistai particulièrement sur le « déjeune » : il était hors de question que je travaille avec un loup-garou affamé à moins de deux semaines de la pleine lune. La plupart des gens vous diront que les loups-garous ne peuvent se métamorphoser qu'à la pleine lune, mais, d'un autre côté, ils vous diront aussi que les fantômes n'existent pas.
Le garçon sentit mon ton impérieux et se raidit, m'interrogeant du regard. Puis il marmonna un « merci » et partit vers l'arrière-boutique, fermant doucement la porte derrière lui. Je laissai échapper un soupir de soulagement. Je savais qu'il était délicat de donner des ordres à un loup-garou – à cause de toutes ces histoires de dominance.
Les instincts des loups-garous sont assez malcommodes. C'est pour cela qu'ils ne vivent pas vieux, généralement. Ce sont les mêmes instincts qui ont causé la défaite de leurs frères sauvages face à la civilisation, alors que les coyotes abondent, même dans les zones urbaines comme Los Angeles.
Les coyotes sont mes frères. Non, je ne suis pas un coyote-garou — je ne pense même pas que cela existe. Je suis ce qu'on appelle une « changeuse ».
Le terme vient de la « changeuse de peau », une sorcière des tribus du sud-ouest des États-Unis, qui utilise une peau d'animal pour se transformer en coyote ou en tout autre animal et pour répandre la maladie et la mort dans les tribus ennemies. Les colons blancs ont adopté le terme de manière abusive pour qualifier tous les métamorphes natifs d'Amérique du Nord, et le nom est resté. Nous ne sommes pas en position de protester contre ce terme inadapté, bien que, comme les autres faes¹ inférieurs, nous ayons fait notre coming-out. Nous ne sommes simplement pas assez nombreux pour que quelqu'un en ait quoi que ce soit à faire.
Je ne pense pas que le gamin ait su ce que j'étais, sinon, il aurait été incapable de me tourner le dos, à moi, un autre prédateur, pour aller se doucher dans l'arrière-boutique. Les loups ont généralement un odorat très développé, mais le garage était saturé d'odeurs plus que prégnantes, et je doutais qu'il eût jamais senti quelqu'un comme moi de sa vie.
— Tu viens de trouver un successeur à Tad ?
Je pris soudain conscience de la présence de Tony derrière moi, arrivant par les portes ouvertes. Il avait probablement espionné notre conversation de l'extérieur, c'était sa spécialité, et son boulot.
il avait plaqué ses cheveux noirs en une courte queue-de-cheval et s'était rasé de près. Je remarquai quatre trous sur son oreille droite, avec trois petits anneaux et un clou en diamant, ce qui en faisait deux de plus que la dernière fois où je l'avais vu. Sa veste à capuche était ouverte sur un tee-shirt moulant mettant en valeur les heures qu'il avait passées en salle de sport. Il ressemblait au modèle d'une campagne de recrutement pour les gangs hispaniques du coin.
— Nous sommes en période d'essai, rétorquai-je. C'est du temporaire, pour le moment. Tu es en service ?
- Non. J'ai eu un jour de repos pour bonne conduite. (Son attention était toujours braquée sur mon nouvel assistant, semblait-il, puisqu'il continua :) Je l'ai vu traîner dans le coin, ces jours derniers. Il m'a l'air OK. Peut-être un fugueur.
« OK », cela voulait dire ni drogue ni violence, ce qui, pour ce dernier point en particulier était rassurant.
Quand j'avais ouvert mon garage, neuf ans auparavant, Tony tenait une petite boutique de prêt sur gages juste au bas de la rue. Comme c'était là que se trouvait le distributeur de boissons fraîches le plus proche, je le voyais assez souvent. Puis la boutique avait changé de mains plusieurs fois, et je ne pensais plus du tout à lui quand je l'ai soudain senti alors qu'il traînait à un coin de rue avec une pancarte disant qu'il était « prêt à travailler contre de la nourriture ».
Je dis bien « senti », parce que le gamin aux yeux cernés qui tenait la pancarte ne ressemblait en rien au joyeux et discret prêteur sur gages d'une trentaine d'années. Surprise, je l'avais appelé par le nom sous lequel je le connaissais alors, et il m'avait regardée comme si j'avais perdu l'esprit. Mais le lendemain matin, Tony m'attendait au garage et m'expliqua ce qu'il faisait dans la vie. Je n'avais même pas conscience qu'un endroit de la taille des Tri-Cities² avait des agents de police infiltrés.
À partir de ce moment-là, il prit l'habitude de venir me rendre visite au garage, les premiers temps en changeant de costume chaque fois. Les Tri-Cities ne sont pas très étendues, et mon garage se trouve juste à la limite de ce qu'on pourrait éventuellement appeler le quartier chaud de Kennewick. Il était donc possible qu'il vînt seulement quand il avait une mission dans le quartier, mais je me rendis rapidement compte qu'en fait c'était surtout pour voir si, cette fois-ci, je le reconnaîtrais. Je pouvais difficilement lui dire que j'avais senti son odeur, n'est-ce pas ?
De mère italienne et de père vénézuélien, le mélange de gènes lui avait donné un visage et un teint qui lui permettaient de passer aussi bien pour un Mexicain que pour un Afro-Américain. Il pouvait sembler avoir dix-huit ans, alors que je le pensais âgé de quelques années de plus que moi, dans les trente-trois ans. II parlait couramment espagnol et pouvait teinter son anglais d'une variété d'accents.
Toutes ces caractéristiques faisaient déjà de lui le candidat idéal à l'infiltration, mais son avantage décisif, c'était son aisance à manier le langage corporel : il pouvait avoir la démarche déhanchée et ondulante du beau mec hispano, ou l'allure secouée de tics nerveux du drogué en manque.
Au bout d'un moment, il finit par accepter que je le reconnaîtrais toujours, même quand ses copains et, me répétait-il, sa propre mère ne le reconnaissaient pas, et nous devînmes amis. Il continuait à venir me rendre visite pour boire un café ou un chocolat chaud et discuter de choses et d'autres.
— Tu as l'air très jeune, et très macho, remarquai-je. Les boucles d'oreilles, c'est le nouveau look de la police de Kennewick ? Genre, à Pasco, ils ont deux anneaux, donc ceux de Kennewick doivent en avoir quatre ?
Son sourire le fit paraître à la fois plus vieux et plus innocent.
— Ça fait quelques mois que je travaille à Seattle, expliqua-t-il. J'ai un nouveau tatouage, aussi. Heureusement, il se trouve à un endroit que ma mère ne verra jamais.
Tony disait vivre dans la terreur de sa mère. Je ne l'avais jamais rencontrée, mais tout en lui respirait le bonheur, non la peur, quand il parlait d'elle, et je devinais que c'était loin d'être la harpie qu'il décrivait.
1. Terme issu de la « fée » française, mais rassemblant ici tous les êtres dits surnaturels, elfes, lutins, gnomes, etc. (NdT)
2. La métropole des Tri-Cities, dans l'État de Washington, rassemble les villes de Kennewick, Pasco et Richland. (NdT)
« Ce n'est pas un présage, décida Torak. Juste une plume de chouette gisant sur la neige. Rien de plus. »
Il l'ignora.
Première erreur.
En silence, il revint sur les traces qu'ils suivaient depuis l'aube. Elles semblaient toutes fraîches. Il ôta ses gants et toucha les empreintes. Pas de glace dessus. Elles étaient bel et bien fraîches.
Il se tourna vers Renn, postée en haut de la colline. Il montra sa manche, leva un doigt et le pointa vers le bois de bouleaux.
« C'est un chevreuil, et il se dirige vers le nord. »
Renn acquiesça. Sortit une flèche de son carquois. L'encocha, prête à tirer.
Comme Torak, elle était quasiment invisible, dissimulée dans son manteau en peau de daim et ses pantalons en cuir. Sur son visage, de la cendre masquait ses traits et, surtout, son odeur. Comme Torak aussi, elle avait faim. Elle avait à peine ingurgité une tranche de sanglier séché depuis le début de la journée. Il lui en fallait davantage, pour la rassasier !
Mais, contrairement à Torak, elle n'avait pas vu la plume de chouette.
« Inutile de lui en parler », pensa-t-il.
Et il ne dit rien.
Ce fut sa seconde erreur.
Quelques pas devant les deux amis marchait Loup. Il reniflait une touffe moussue que leur proie avait dégagée de la neige pour y croquer. Même traqué, quel chevreuil résisterait à une bouchée de lichen ?
Loup plia les oreilles. Sa fourrure d'argent frémit sous l'effet de l'excitation. Perçut-il le malaise de Torak ? Si ce fut le cas, il n'en laissa rien paraître. Il inspira derechef, leva le museau pour mieux sentir les odeurs environnantes et croisa le regard du jeune humain.
« Mauvaise odeur. »
« Comment ça ? » demanda Torak dans un grognement de loup.
Les moustaches du quadrupède s'agitèrent. « Museau pas bon état. »
Torak s'approcha. Il examina ce que Loup avait découvert. Une trace jaune traînait par terre. Pus ou bave, peu importait. Ce que le garçon en concluait, c'est qu'il s'agissait d'un vieux chevreuil. Ses dents étaient pourries. Il avait passé trop d'hivers à grignoter du lichen gelé.
Torak adressa un sourire de loup à son frère de meute pour le remercier de l'information. Puis, après un coup d'œil à Renn, il descendit la colline en silence.
Ou plutôt : le moins bruyamment que l'autorisaient ses bottes en cuir de castor. Donc pas assez discrètement au goût de Loup qui battit des oreilles d'un air de reproche. L'animal aurait beau faire, il ne réussirait donc jamais à apprendre à son frère de meute comment se déplacer avec souplesse. Lui, quand il coursait une proie, il pouvait être aussi discret qu'une volute de fumée... voire plus !
Torak et Loup se faufilèrent entre les arbres. Tout était paisible. Des chênes aux troncs sombres et des bouleaux opalins luisaient sous leur couverture de gel. Çà et là, le garçon apercevait l'éclair sanglant de baies de houx. Un épicéa vert vif semblait monter la garde près de ses frères endormis.
La Forêt se taisait. Le gel avait statufié les cours d'eau. Tous les oiseaux paraissaient avoir déserté les futaies pour gagner le sud.
Sauf une chouette.
Torak avait deviné l'origine de la plume immédiatement. La partie supérieure ne laissait aucun doute au fin connaisseur qu'il était : elle était légèrement duveteuse. Ce qui permettait d'étouffer le bruit des ailes, lorsque l'oiseau de nuit partait en chasse.
Si la plume avait appartenu à une simple chouette, Torak n'aurait pas paniqué. Il l'aurait prise pour la remettre à Renn. La jeune fille s'en servait pour garnir ses flèches.
Mais la plume était brun-noir et tachetée. Ombre et flamme. Elle appartenait à l'oiseau de nuit le plus impressionnant qui fût. Presque plus une chouette : un grand duc.
Souvent, les grands ducs préfèrent les terrains escarpés et découverts pour chasser. Néanmoins, l'hiver, il leur arrive de chasser sur des territoires plus plats.
Trouver une de leurs plumes pouvait être un présage, mais pas forcément. C'est du moins ce dont Torak essayait de se convaincre. Même s'il savait que cette plume n'était jamais bon signe.
Jamais.
Loup tordit le museau.
Torak se tint sur ses gardes.
À travers le rideau d'arbres, il aperçut le chevreuil qui grignotait un tronc moussu. Ses sabots craquaient sur le sol dur. Son haleine dessinait de grands nuages dans l'air glacé.
Torak put ainsi vérifier qu'ils avaient vent de face. L'animal ne risquait pas de les repérer.
Aussitôt, l'image de la plume disparut. La remplaça celle de morceaux de viande juteux, à la chair grasse et savoureuse.
Derrière le garçon, un bruit étouffé : Renn avait tendu son arc. Torak encocha une flèche à son tour. Puis il pensa qu'il cachait la vue à son amie. Il posa un genou à terre. Elle tirait mieux que lui. Bien mieux. À elle l'honneur !
Le chevreuil se déplaça. Gagna un bouleau... et donc un répit. Ses prédateurs devraient attendre qu'il réapparût. Ils savaient que le pire ennemi du chasseur était la précipitation. Un geste mal anticipé, et des jours de traque pouvaient se retrouver perdus, parfois irrémédiablement.
Torak attendit. La patience faisait partie des premières qualités dont devait disposer un chasseur.
Le garçon avisa un épicéa, à cinq pas de lui. Il eut l'impression que l'arbre étendait ses bras couverts de neige comme pour le repousser ou le mettre en garde.
Le garçon serra son arc. Fixa sa proie. Une bourrasque secoua les bouleaux dressés derrière lui. Les dernières feuilles tremblèrent sur les branches, pareilles à de vieilles mains noueuses et sèches.
Torak se mordit les lèvres. Même s'il s'obstinait à penser que la plume n'était pas un présage, il devait constater que les signes (ou les découvertes qui pouvaient être interprétées comme des signes) se multipliaient. La Forêt essayait de lui dire quelque chose. Et, plus elle s'obstinait, plus il s'efforçait de ne pas la comprendre.
Au-dessus de lui, une branche ploya. Un paquet de neige tomba sur le garçon. Son cœur se serra.
Un grand duc venait d'apparaître. Les oreilles pointues, acérées comme des lances. D'énormes yeux orange, tels deux soleils jumeaux. Qui fixaient le jeune chasseur.
Torak se releva d'un bond en poussant un cri.
Le soleil miroitait sur la haie de saules touffus. Soudain, le rideau d'arbres s'écarta, et elle apparut de l'autre côté du ruisseau.
C'était une femelle aurochs. Plus grande qu'un homme de haute taille. Pourvue de gigantesques cornes incurvées, propres à éviscérer un sanglier. Si elle chargeait, Torak était en très mauvaise posture.
Par malchance, il était sous le vent. Il retint son souffle en la voyant froncer sa gueule massive pour humer son odeur. Elle renâcla. Gratta la terre avec un sabot monstrueux.
C'est alors que le garçon remarqua son petit qui émergeait de derrière les saules. Son estomac se serra. Les aurochs sont des créatures paisibles. Sauf quand ils ont des petits.
Sans un bruit, Torak recula dans l'ombre. L'aurochs l'avait repéré ; mais, s'il ne l'avait pas effrayée, elle ne l'attaquerait peut-être pas. Il s'immobilisa : de nouveau, l'animal avait renâclé. D'un mouvement de corne, elle avait fouetté les hautes herbes qui l'entouraient. Le sort du garçon se jouait à cet instant précis.
La femelle s'étala dans la boue. Torak frissonna de soulagement : elle avait compris qu'il ne la chassait pas. Elle allait le laisser tranquille.
Le petit aurochs s'approcha de sa mère, glissa, tenta de se rattraper... et bascula. Sa mère leva la tête. Du museau, elle le remit sur pattes puis se roula sur le dos pour son plus grand plaisir.
Accroupi derrière un genévrier, Torak se demanda ce qu'il devait faire. Fin-Kedinn, le chef du clan, l'avait envoyé chercher un tronc de saule qu'il avait laissé à tremper dans le courant. Le garçon ne voulait pas rentrer au campement sans avoir accompli sa mission. Et il ne voulait pas non plus mourir piétiné par un aurochs en fureur.
Il décida d'attendre que le mastodonte s'éloignât.
On était aux premiers jours de la Lune Sans Obscurité. Une chape de soleil assommait la Forêt. Le chant d'un oiseau se réverbérait dans les frondaisons. Une chaude brise du sud parfumait l'air d'une douce senteur d'agrume. Peu à peu, les battements de cœur de Torak se ralentirent. Le garçon entendit des verdiers se disputer à grands cris de la nourriture dans un buisson de noisetiers. Tournant la tête, il avisa une vipère lovée sur un rocher. Il essaya de ne plus penser qu'au serpent. Mais, malgré ses efforts, c'est un autre animal qui accapara son esprit.
Loup.
Loup devait avoir pratiquement atteint l'âge adulte à présent. Que restait-il en lui du petit louveteau que Torak avait connu - ce petit animal qui tombait, maladroit, et quémandait des baies à son nouvel ami humain¹ ?
Le garçon ne voulait pas penser à lui. C'était trop douloureux. Loup était parti. Il ne reviendrait pas. Jamais. Torak devait se concentrer sur l'aurochs. Sur la vipère. Sur ce qui...
Le garçon sursauta. Il venait de voir un chasseur.
L'homme était sur la même berge que Torak. À vingt pas en amont. Face au vent. L'aurochs ne pouvait pas le repérer. L'ombre était trop dense pour qu'on distinguât ses traits ; cependant, Torak vit que, comme lui, le chasseur portait un gilet sans manches en peau de chèvre, un pantalon qui lui arrivait aux genoux et des bottes en cuir brut. Seule particularité : autour du cou, il portait une défense de sanglier nouée à un collier. Il appartenait au clan du Sanglier.
En temps ordinaire, Torak aurait été rassuré. Les membres de ce clan étaient plutôt alliés à ceux du clan du Corbeau, avec qui le garçon vivait depuis six lunes. Mais ce chasseur n'était pas normal. Quelque chose clochait. Sa démarche était curieuse. Il dodelinait de la tête. Et il visait l'aurochs.
Il portait deux haches de lancer à la ceinture. Il en dégaina une, qu'il soupesa et serra dans sa main droite.
Un fou ! Ce ne pouvait être qu'un fou ! Personne ne chasse un aurochs seul ! Dans la Forêt, nulle proie ne dépasse ces créatures en taille ou en force. En attaquer un seul ? Autant se trancher la tête tout de suite...
Inconscient du danger qui le guettait, l'aurochs barbotait dans la boue, grognant de joie d'être enfin libéré des moucherons qui l'assaillaient sur la terre ferme. Son petit jouait avec une touffe d'épilobe en attendant que sa mère eût fini.
Torak leva un pied et adressa de vifs signaux de la main au chasseur. « NON ! criait-il en silence. Recule ! Ne fais pas ça ! »
Le chasseur ne le vit pas. Il plia son bras musculeux. Visa. Et lança sa hache.
L'arme retomba à une main à peine du petit, qui recula, paniqué. La mère poussa un meuglement indigné. Se releva, flairant l'air à la recherche de son agresseur. Mais le chasseur restait invisible. Tant qu'il resterait face au vent, il ne s'exposait à aucun danger. Lui.
Torak le vit dégainer sa deuxième hache. Et comprit en un éclair ce qui risquait de se passer.
Si la hache atteignait son but, l'aurochs serait impossible à arrêter. Par contre, si elle n'était qu'effrayée, comme elle l'était à cet instant, au lieu d'être blessée, elle se contenterait peut-être d'une attaque préventive, puis elle s'enfuirait avec son petit. Il devait la protéger... pour se protéger lui-même.
Il sauta à découvert et, agitant les bras frénétiquement, il cria :
- Par ici ! Par ici !
Sa manœuvre réussit. En un sens : l'aurochs beugla, rageur, et fonça vers le garçon, qui bondit derrière un chêne. La deuxième hache s'enfonça dans la boue, à l'endroit où l'animal se trouvait un instant plus tôt.
En entendant l'animal franchir le cours d'eau, Torak paniqua. Pas le temps d'escalader le tronc. La bête était trop près. Déjà, elle grognait pour se hisser sur la berge. Déjà, les trépidations de ses sabots faisaient trembler le sol. Encore un instant, et...
Et rien du tout : l'animal avait pivoté, interrompant sa charge. D'un puissant mouvement de queue, elle avait indiqué à son petit de la suivre ; et elle s'était laissé avaler par les entrailles de la Forêt, abandonnant derrière elle un silence assourdissant.
Torak haletait. Sur son visage, la sueur dégoulinait à grosses gouttes. Appuyé contre le chêne, il fixait, incrédule, le chasseur qui continuait à dodeliner de la tête.
- Tu es fou ? rugit le garçon, le souffle court. Tu voulais notre mort ?
L'homme ne lui répondit pas. Ne le regarda seulement pas. D'un pas calme, il alla récupérer ses haches, les passa à sa ceinture et revint sur ses pas. Torak ne parvenait pas à distinguer ses traits. Par contre, les muscles puissants de l'individu et son grand couteau acéré avaient attiré son attention. Si le chasseur l'attaquait, son sort était scellé. Lui-même n'avait pas treize étés. Il n'était pas de taille à lutter contre une telle masse.
Mais l'homme n'était pas en état de l'agresser. D'un coup, il s'était plié en deux et s'était mis à vomir.
Oubliant sa peur, le garçon se précipita vers lui pour l'aider.
L'homme était à quatre pattes, à présent, crachant une bile jaune. Son corps était secoué de convulsions. Un grand hoquet le prit, puis il rejeta un caillot noir et visqueux qui avait la taille d'un poing d'enfant. On aurait dit... on aurait dit des cheveux.
Une brise souffla dans les branchages ; et, dans le rayon de soleil qui en profita pour se faufiler jusqu'à eux, Torak distingua le visage de l'inconnu pour la première fois.
Il s'arrachait des poignées de cheveux et de barbe. Par endroits, sa chair était à vif. Ses joues, son front, ses lèvres étaient semés de croûtes purulentes, d'une couleur jaunâtre qui rappelait celle des bouleaux galeux. De sa gorge sortaient encore des glaires et des cheveux. Quand ses nausées se calmèrent, l'homme se redressa sur ses talons et se mit à gratter une cicatrice sur son avant-bras.
Torak recula. Toucha le talisman de son clan - la fourrure de loup cousue sur son gilet. Mais qu'est-ce que c'était donc que ça ?
1. Voir le tome 1 de ces Chroniques des Temps obscurs : Frère de Loup.
♦
J'avais eu plus que mon compte d'expériences mortifères, phénomène auquel on ne s'habitue pas.
Il semblait cependant inévitable que j'affronte de nouveau la mort. À croire que j'étais marquée du sceau de la catastrophe. J'avais beau y avoir échappé à maintes reprises, elle ne cessait de revenir à moi.
Pour autant, cette fois différait beaucoup des précédentes.
Il est possible de fuir celui que l'on craint, de lutter contre celui que l'on hait. Je savais réagir face à ce genre de tueurs - monstres et ennemis.
Lorsqu'on aime son assassin, on n'a plus le choix, cependant. Car comment fuir et lutter si cela signifie blesser l'aimé ? Si la vie est la seule chose à lui donner, comment la lui refuser ?
Quand on l'aime réellement ?
1
♦
FIANÇAILLES
« Personne ne te regarde. Personne ne t'observe. Personne ne t'épie », me rassurai-je.
Comme j'étais incapable de mentir de façon convaincante, y compris à moi-même, je me sentis obligée de vérifier, néanmoins.
En attendant que l'un des trois uniques feux de Forks passe au vert, je jetai un coup d'œil sur ma droite - à l'intérieur de son monospace, Mme Weber avait le buste tourné dans ma direction. Son regard me transperça, et je tressaillis. Pourquoi me fixait-elle ainsi ? N'était-il pas impoli de toiser ainsi les gens ? Ou cette règle ne s'appliquait-elle plus à moi ? Puis je pris conscience que les vitres teintées de la voiture étaient si sombres qu'elle ne se rendait sans doute pas compte que je m'y trouvais, encore moins que je l'avais surprise en train de me reluquer. Je tâchai de me consoler en concluant que ce n'était sans doute pas moi qu'elle examinait ainsi, mais le véhicule.
Mon véhicule. Je poussai un soupir.
Un nouveau coup d'œil, à gauche cette fois. Un gémissement m'échappa. Deux piétons s'étaient figés sur le trottoir au lieu de traverser la rue. Derrière eux, M. Marshall était pétrifié dans la vitrine de sa petite boutique de souvenirs. Du moins n'avait-il pas le nez collé au carreau. Pas encore.
Le feu passa au vert et, toute à ma hâte de fuir, j'appuyai sur l'accélérateur sans réfléchir, comme je l'aurais fait pour ébranler mon antique camionnette Chevrolet. Le moteur grondant comme une panthère en chasse, la voiture bondit avec une puissance telle que je fus plaquée sur le siège en cuir noir, et que mon estomac s'écrasa contre ma colonne vertébrale.
— Aaahhh ! criai-je en cherchant la pédale de frein.
Je l'effleurai, ce qui n'empêcha pas l'engin de s'arrêter net, avec un soubresaut. Je n'osai inspecter les alentours afin de jauger les réactions des témoins. Si quelqu'un avait eu des doutes quant au conducteur de cette automobile, ce n'était plus le cas à présent. De la pointe de ma chaussure, j'enfonçai l'accélérateur d'un millimètre, et la voiture repartit à toute vitesse.
Je parvins à atteindre mon but : la station-service. Si je n'avais pas été fébrile, je ne me serais même pas donné la peine de descendre en ville. Je me privais de bien des choses, ces derniers mois, des biscuits aux lacets, rien que pour éviter de passer du temps en public.
Me mouvant comme si je courais un marathon, je ne mis que quelques secondes à ouvrir le volet du réservoir puis ce dernier, à glisser ma carte de crédit dans la pompe et le bec verseur dans le réservoir. Naturellement, je ne pouvais rien pour accélérer le débit, et les nombres défilèrent avec paresse, comme pour m'agacer.
La journée avait beau être typique - maussade et humide -, j'avais l'impression qu'un projecteur était braqué sur moi, attirant l'attention sur la bague délicate à ma main gauche. En pareils moments, imprégnée du sentiment que des yeux se vrillaient sur mon dos, il me semblait qu'elle clignotait, tel un néon : « Regardez-moi, regardez-moi ! »
Je savais qu'il était idiot d'être aussi gênée. Hormis celle de mes parents, que m'importait l'opinion des gens à propos de mes fiançailles ? De ma nouvelle auto ? De ma mystérieuse acceptation dans une université de l'Ivy Leaguel ? De la carte de crédit noire et luisante qui, après avoir réintégré ma poche arrière, paraissait brûler comme un fer chauffé à blanc ?
— Qu'ils pensent ce qu'ils veulent, rouspétai-je dans un souffle.
— Mademoiselle ? lança une voix masculine.
Je me retournai et le regrettai aussitôt. Deux hommes se tenaient devant un 4 x 4 tape-à-l'œil sur le toit duquel étaient fixés des kayaks flambant neufs. Ni l'un ni l'autre ne me regardait - ils étaient bien trop intéressés par la voiture. Personnellement, ce genre de passion m'échappait - il est vrai que j'étais déjà fière de savoir repérer les logos distinguant une Toyota d'une Ford ou d'une Chevrolet. Ce véhicule-là était noir, brillant et joli - pour moi, il restait un moyen de locomotion.
— Désolé de vous déranger, mais pourriez-vous me dire quel est ce modèle ? demanda le plus grand.
— Euh... une Mercedes, non ?
— Oui, je sais, acquiesça poliment l'inconnu, cependant que son camarade levait les yeux au ciel. C'est juste que... il s'agit bien d'une S 600 Guard ?
Il s'était exprimé avec respect. Il se serait bien entendu avec Edward Cullen, mon... mon fiancé (cette triste vérité était désormais incontournable, vu que le mariage était prévu pour dans quelques jours).
— Elles ne sont pas encore sorties en Europe, poursuivait le type. Encore moins ici, donc.
Pendant que ses prunelles s'attardaient sur ma voiture - laquelle, à mes yeux, ressemblait à toutes les autres berlines de la même marque -, je réfléchis brièvement aux problèmes que me posaient les mots « fiancé », « mariage », « mari », etc. Des termes auxquels je n'arrivais pas à donner un sens. Non seulement j'avais été élevée dans la crainte des robes blanches meringuées et des bouquets, mais il m'était impossible d'assimiler l'image sérieuse, respectable et terne de mari avec l'idée que je me faisais d'Edward. C'était comme d'embaucher un archange en guise de comptable ; je ne l'imaginais pas dans un rôle aussi commun.
À ma mauvaise habitude, penser à Edward m'entraîna dans un tourbillon vertigineux de fantasmes. L'inconnu fut obligé de se racler la gorge pour attirer mon attention. Il attendait encore ma réponse concernant le modèle de mon véhicule.
— Je n'en ai pas la moindre idée, avouai-je honnêtement.
— Ça ne vous ennuie pas si je me prends en photo à côté ?
Je mis une seconde à comprendre sa requête.
— Vous voulez vraiment être photographié avec ma voiture ?
— Oui. Sinon, personne ne me croira. Ce sera une preuve.
— Hum. D'accord. Pas de souci.
Je m'empressai de terminer le plein et de regagner mon siège afin de me cacher, cependant que l'enthousiaste sortait un énorme appareil de son sac à dos. Son ami et lui prirent la pose tour à tour près du capot, puis à l'arrière.
— Ma camionnette me manque, marmonnai-je pour moi-même.
Ma Chevrolet avait poussé son dernier soupir quelques semaines seulement après l'accord bancal auquel Edward et moi étions parvenus. Ce qui était vraiment très, très bien tombé. Trop bien tombé. Un détail du compromis stipulait en effet que je l'autorisais à remplacer mon pick-up lorsqu'il rendrait l'âme. Edward avait juré qu'il fallait s'y attendre ; ma fourgonnette avait eu une longue vie bien remplie avant de mourir de causes naturelles. Ça, c'était sa version. Naturellement, je n'avais aucun moyen de vérifier ses allégations, non plus que de tenter de ressusciter la Chevrolet, puisque mon mécanicien préféré...
J'étouffai dans l'œuf cette pensée, peu désireuse de la laisser m'entraîner vers des conclusions désagréables. À la place, je tendis l'oreille à ce que les deux hommes se racontaient, dehors, leurs voix atténuées par l'épaisseur de l'habitacle.
— ... sur la vidéo en ligne, ils y allaient au lance-flammes. Ça n'a même pas écaillé la peinture.
— Bien sûr que non. Un tank ne viendrait pas à bout de cette merveille. Mais il n'y a pas de vrai marché pour elle, ici. Elle a surtout été conçue pour les diplomates du Moyen-Orient, les trafiquants d'armes et les seigneurs de la drogue.
— Tu crois qu'elle en est ? demanda le plus petit des deux en baissant le ton.
Je me courbai en deux, les joues rouges.
— Bof, répondit le grand. Peut-être. Je ne vois pas qui aurait besoin de verre antimissile et de deux tonnes de carrosserie blindée par ici. Elle doit sûrement se rendre dans des parages plus dangereux.
Une carrosserie blindée... deux tonnes de carrosserie blindée. Et du verre anti-missile ? Super ! Qu'était-il advenu des bonnes vieilles protections pare-balles ? En tout cas, ce cadeau luxueux avait une signification, maintenant. À condition d'avoir un sens de l'humour dévoyé.
Certes, je m'étais attendue à ce qu'Edward tirât avantage de notre marché, qu'il fit pencher la balance en sa faveur, histoire d'offrir beaucoup plus qu'il ne recevrait. J'avais accepté qu'il remplace ma camionnette en temps voulu, n'ayant pas envisagé que ça se produirait aussi vite. Lorsque j'avais été contrainte d'admettre que la Chevrolet était devenue une nature morte le long du trottoir, j'avais deviné que la voiture qu'il comptait m'acheter me mettrait dans l'embarras. Qu'elle ferait de moi l'objet des regards et des racontars. Et j'avais eu raison. Cependant, même dans mes pires cauchemars, je n'avais pas imaginé qu'il m'en donnerait deux.
La voiture « d'avant » et celle « d'après », m'avait-il expliqué quand j'avais piqué une crise.
1. Groupement des universités américaines les plus prestigieuses. Toutes les notes sont du traducteur.
Bella,
Je ne comprends pas pourquoi tu obliges Charlie à porter des notes à Billy, comme si nous étions encore à l'école primaire. Si j'avais envie de te parler, je répondrais aux
Tu as fait un choix, d'accord ? Tu ne peux pas gagner sur les deux tableaux, alors que
Dans "ennemis mortels", quel mot est trop compliqué pour que tu
Ecoute, je sais que je suis nul, mais il n'y a pas d'autre solution
Il nous est impossible d'être amis quand tu passes ton temps avec une bande de
Penser à toi trop souvent ne fait qu'aggraver la situation, alors n'écris plus
Oui, tu me manques aussi. Beaucoup. Ça ne change rien. Désolé.
Jacob
Mes doigts caressèrent la feuille, s'arrêtant sur les creux où il avait appuyé si fort sa plume que le papier avait failli se déchirer. Je l'imaginais rédigeant cette missive, traçant maladroitement de son écriture grossière les mots furieux, barrant ligne après ligne les phrases insatisfaisantes, jusqu'à briser de ses mains puissantes, peut-être, son stylo, ce qui expliquerait les taches d'encre. Je devinais ses sourcils sombres se fronçant sous l'effet de la frustration, les rides de son front. Aurais-je été là-bas, je me serais esclaffée : « Pas la peine de te coller la migraine, Jacob. Crache le morceau. »
Rire était cependant la dernière chose dont j'avais envie, tandis que je relisais ces mots que je connaissais par cœur. Sa réponse à ma supplication – transmise par l'intermédiaire de Charlie et de Billy, exactement comme des élèves de primaire, ainsi qu'il l'avait souligné – ne me surprenait pas. J'avais pressenti la teneur du pli avant que de l'avoir ouvert.
M'étonnait toutefois la force avec laquelle chacune de ses lignes raturées me blessait, à croire que les pointes les lettres étaient tranchantes. Et puis, tous ces débuts rageurs cachaient mal un océan de douleur ; la souffrance de Jacob me tailladait plus que ma propre peine.
Fourrant la page froissée dans ma poche arrière, je descendis à toutes jambes au rez-de-chaussée. Juste à temps ! Le bocal de sauce tomate que Charlie avait flanqué dans le micro-ondes n'avait effectué qu'un tour lorsque j'interrompis vivement les opérations.
— Qu'est-ce que j'ai encore fait ? grommela mon père.
— Tu es censé retirer le couvercle avant, papa. Le métal bousille les micro-ondes.
Tout en parlant, j'ouvris le bocal, en vidai la moitié dans un bol que je plaçai au four avant de ranger le restant de sauce dans le réfrigérateur. J'enclenchai la minuterie et appuyai sur le bouton.
— M'en suis-je mieux tiré avec les pâtes ? s'enquit Charlie.
Il m'avait observée agir, lèvres pincées. Je regardai, sur la cuisinière, la casserole – source de l'odeur qui m'avait alertée.
— Remuer aide, lui répondis-je gentiment.
Dénichant une cuiller, j'entrepris de décoller le tas gluant qui avait attaché au fond. Il soupira.
— Explique-moi un peu ce qu'il t'arrive, lançai-je.
Mon père croisa les bras sur son torse et fixa la pluie qui, derrière les fenêtres, tombait à seaux.
— Je ne vois pas de quoi tu parles, marmonna-t-il.
Charlie aux fourneaux ? J'étais perplexe. Ajoutons-y son attitude revêche. Edward n'était pas encore là ; d'ordinaire, mon père réservait ce genre de comportement à mon petit ami, déployant des trésors d'imagination tant dans ses paroles que dans ses postures afin de lui faire sentir à quel point il n'était pas le bienvenu. Ces efforts étaient d'ailleurs inutiles – Edward savait très précisément ce que pensait Charlie sans avoir besoin de ces représentations.
Petit ami... Je me surpris à mordiller l'intérieur de ma joue, en proie à une tension familière. Ces mots n'étaient pas les bons, n'exprimant en rien l'engagement éternel qui était le nôtre. Certes, les termes « destinée » ou « sort » sonnaient ridicules dans une conversation courante. Edward en avait un autre à l'esprit, origine de ma tension. Rien que d'y songer, j'étais nerveuse. « Fiancée ». Pouah ! J'en frissonnai.
— Aurais-tu quelque chose à m'annoncer repris-je. Depuis quand prépares-tu le dîner ? Ou, du moins, t'y essayes-tu ? ajoutai-je en enfonçant dans l'eau les spaghettis amalgamés.
— Nulle loi n'interdit que je cuisine dans ma propre maison, rétorqua Charlie avec un haussement d'épaules.
— Tu serais en effet au courant, répliquai-je avec bonne humeur en regardant le badge de shérif épinglé sur son blouson de cuir.
— Très drôle.
Il retira le vêtement, comme si, avant mon coup d'œil, il avait oublié qu'il le portait encore, et alla le suspendre à la patère. La ceinture et l'étui de son pistolet s'y trouvaient déjà. Il n'avait pas jugé nécessaire de les emporter au commissariat depuis plusieurs semaines. Les disparitions susceptibles de troubler la petite ville de Forks, dans l'État de Washington, avaient cessé. Plus aucun témoin ne venait jurer avoir aperçu de mystérieux loups géants dans les bois de cette région éternellement humide.
Je n'insistai pas, sachant que Charlie finirait par m'avouer en temps voulu ce qui le préoccupait. Il était d'un naturel taciturne ; ses tentatives malheureuses pour orchestrer le dîner à ma place laissaient supposer qu'il avait nombre de choses à dire ce soir-là. Par habitude, je jetai un coup d'œil à la pendule, geste que j'avais tendance à répéter fréquemment à cette heure. Plus que trente minutes.
Les après-midi constituaient l'étape la plus difficile de mes journées. Depuis que mon ancien et meilleur ami (loup-garou de surcroît) Jacob Black avait crié haut et fort que je faisais de la moto en douce – trahison destinée à ce que je sois punie et privée de la compagnie de mon amoureux (et vampire) Edward Cullen –, ce dernier n'avait l'autorisation de me fréquenter que de dix-neuf à vingt et une heures trente, dans le confinement de ma maison et sous la surveillance rapprochée, réprobatrice et grincheuse de mon père. Ce châtiment s'ajoutait aux mesures de rétorsion que j'avais récoltées pour avoir disparu sans explication durant trois jours et m'être amusée à sauter dans la mer du haut d'une falaise.
Certes, je continuais à côtoyer Edward au lycée, Charlie ne pouvant décemment s'y opposer. Par ailleurs, Edward passait presque toutes ses nuits dans ma chambre, ce dont mon géniteur n'était toutefois pas averti. La faculté qu'avait mon ami de se hisser sans bruit jusqu'à ma fenêtre, à l'étage, était aussi utile que sa capacité à déchiffrer les pensées de mon père.
Bref, les après-midi avaient beau être les seuls moments où j'étais séparée d'Edward, ils me pesaient, interminables. J'endurais pourtant ma condamnation sans protester : et d'une, je l'avais amplement méritée ; et de deux, je n'aurais pas supporté de heurter Charlie en déménageant (j'étais majeure, après tout), alors qu'une séparation beaucoup plus définitive se dessinait à l'horizon, ce qu'il ignorait.
Bougon, il s'attabla et déplia le journal humide ; quelques secondes après, il émettait des claquements de langue mécontents.
— Je ne comprends pas pourquoi tu lis les nouvelles si ça doit te mettre dans cet état, papa.
— Voilà pourquoi tout le monde souhaite habiter de petites villes, éluda-t-il en plissant le nez.
— Allons bon ! Que reproches-tu aux grandes, à présent ?
— Seattle est en bonne position pour décrocher le titre de capitale du meurtre. Cinq homicides non élucidés ces deux dernières semaines. Tu te vois vivre dans pareille ambiance ?
— Il me semble que Phoenix est plus dangereuse, or j'y ai vécu des années.
Et je n'avais jamais autant risqué d'être victime d'un assassinat que depuis mon installation dans la charmante bourgade de Forks qu'il croyait si sûre. Plusieurs tueurs étaient encore à mes trousses, du reste. Dans ma main, la cuiller trembla, déclenchant les frissons de l'eau.
— Eh bien moi, on me paierait que je refuserais d'y emménager, décréta Charlie.
Renonçant à sauver notre repas, je le servis. Je dus recourir à un couteau à viande pour couper les spaghettis. Mon père affichait une mine penaude. Il recouvrit sa part de sauce et s'y attaqua. Je suivis son exemple sans grand enthousiasme. Nous mangeâmes en silence pendant quelques instants. Charlie étant retourné à ses articles, je m'emparai de mon exemplaire défraîchi des Hauts de Hurlevent et tentai de me perdre dans l'Angleterre de la fin du XIXe siècle en attendant qu'il daigne m'adresser la parole.








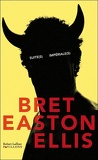









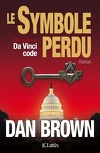








Élégie première
À Albert Samain.
Mon cher Samain, c’est à toi que j’écris encore.
C’est la première fois que j’envoie à la mort
ces lignes que t’apportera, demain, au Ciel,
quelque vieux serviteur d’un hameau éternel.
Souris-moi pour que je ne pleure pas. Dis-moi :
« Je ne suis pas si malade que tu le crois. »
Ouvre ma porte encore, ami. Passe mon seuil
et dis-moi en entrant : « Pourquoi es-tu en deuil ? »
Viens encore. C’est Orthez où tu es. Bonheur est là.
Pose donc ton chapeau sur la chaise qui est là.
Tu as soif ? Voici de l’eau de puits bleue et du vin.
Ma mère va descendre et te dire : « Samain... »
et ma chienne appuyer son museau sur ta main.
Je parle. Tu souris d’un sérieux sourire.
Le temps n’existe pas. Et tu me laisses dire.
Le soir vient. Nous marchons dans la lumière jaune
qui fait les fins du jour ressembler à l’Automne.
Et nous longeons le gave. Une colombe rauque
gémit tout doucement dans un peuplier glauque.
Je bavarde. Tu souris encore. Bonheur se tait.
Voici que nous rentrons sur les pauvres pavés,
voici la route obscure au déclin de l’Été,
voici l’ombre à genoux près des belles-de-nuit
qui ornent les seuils noirs où la fumée bleuit.
Ta mort ne change rien. L’ombre que tu aimais,
où tu vivais, où tu souffrais, où tu chantais,
c’est nous qui la quittons et c’est toi qui la gardes.
Ta lumière naquit de cette obscurité
qui nous pousse à genoux par ces beaux soirs d’Été
où, flairant Dieu qui passe et fait vivre les blés,
sous les liserons noirs aboient les chiens de garde.
Je ne regrette pas ta mort. D’autres mettront
le laurier qui convient aux rides de ton front.
Moi, j’aurais peur de te blesser, te connaissant.
Il ne faut pas cacher aux enfants de seize ans
qui suivront ton cercueil en pleurant sur ta lyre
la gloire de ceux-là qui meurent le front libre.
Je ne regrette pas ta mort. Ta vie est là.
Comme la voix du vent qui berce les lilas
ne meurt point, mais revient après bien des années
dans les mêmes lilas qu’on avait cru fanés,
tes chants, mon cher Samain, reviendront pour bercer
les enfants que déjà mûrissent nos pensées.
Sur ta tombe, pareil à quelque pâtre antique
dont pleure le troupeau sur la pauvre colline,
je chercherais en vain ce que je peux porter.
Le sel serait mangé par l’agneau des ravines
et le vin serait bu par ceux qui t’ont pillé.
Je songe à toi. Le jour baisse comme ce jour
où je te vis dans mon vieux salon de campagne.
Je songe à toi. Je songe aux montagnes natales.
Je songe à ce Versailles où tu me promenas,
où nous disions des vers, tristes et pas à pas.
Je songe à ton ami et je songe à ta mère.
Je songe à ces moutons qui, au bord du lac bleu,
en attendant la mort bêlaient sur leurs clarines.
Je songe à toi. Je songe au vide pur des cieux.
Je songe à l’eau sans fin, à la clarté des feux.
Je songe à la rosée qui brille sur les vignes.
Je songe à toi. Je songe à moi. Je songe à Dieu.