Votre profil Booknode a été créé !
Prisoner n° 73863
Auteur
- Philippe Combes (Écrivain)
Achat Neuf
Amazon : Voir les prix Amazon.ca : Voir les prix Fnac : Voir les prix Rakuten : Voir les prixAchat Occasion
Acheter neuf
Acheter d'occasion
Classement en biblio - 2 lecteurs
Thèmes principaux du livre
Prisoner n° 73863
extrait
Philippe COMBES
PRISONER NO 73863
RECIT
La véritable histoire de Philippe Combes
Innocent emprisonné et torturé pendant 2 ans au Maroc
Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction sur quelque support que ce soit, intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code Pénal.
Philippe Combes ®
A mes enfants : Cédric,
Amandine,
Romain,
Baptiste.
Les yeux fermés, je me laisse emporter. Elle est là comme si c’était hier. J’entends les goélands criards et le cliquetis des mâts des bateaux. L’odeur du vent marin doux et chaud m'enivre. C’est une de ces journées que nous aimons tant partager et dont on ne se lasse toujours pas depuis plus de deux ans que nous nous connaissons. Elle, comme à son habitude est blottie contre moi, nous marchons sur la plage de Sainte-Maxime, entourés de tous ces gens qui n’existent pas, seuls au monde, savourant le bonheur de cet amour intense, pur et partagé. Demain sera un nouveau départ dans notre vie, car nous prenons un tournant professionnel qui nous amène à quitter la France pour trois ans au moins. Mais dans un premier temps, elle part s’installer quelques jours chez ses parents alors que je m’envolerai vers Marrakech.
Curieux mélange d’excitation et d’angoisse. Heureux de cette belle expérience à vivre, mais déchirés à l’idée de devoir nous séparer pendant huit jours.
Depuis notre rencontre et l’évidence de notre amour, nous avons déjà connu des moments difficiles. Mais ils ont toujours été provoqués par le monde extérieur et souvent dus à l’improbabilité, au regard des gens, de notre couple : elle a vingt-et-un ans et moi quarante-sept. Je ne suis pas un amoureux de la littérature et encore moins de celle de Corneille, mais j'ai envie de le paraphraser pour dire : « Elle est jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées la valeur n’attend pas le nombre des années ». Parce qu’elle est ainsi : petite par l’âge mais grande de l’intérieur. D’une famille modeste, elle a gardé de son éducation les valeurs de la simplicité.
Moi qui vis bien, et même plus que bien, sans prétention aucune, j’aime cependant profiter de l’argent que je gagne en fréquentant les beaux restaurants, aimant les belles choses que je peux acheter sans en regarder le prix, je roule en voiture luxueuse, habillé des plus beaux costumes... Elle aime ce que je lui offre sans pour autant porter d’importance à la valeur matérielle des choses : elle en est même parfois gênée. Elle aime conduire ma voiture, mais jamais elle n'aurait désiré se rendre à son volant chez ses parents ou à un rendez-vous avec ses amies. Elle garde précieusement son vieux sac à main, le préférant à ceux de grande marque que je lui offre lorsqu’elle se rend dans sa famille. Une femme-enfant comme il en existe très peu, et elle est à moi, entièrement. Je savoure à chaque instant la chance de l’avoir à mes côtés. Quelle fierté j'éprouve de voir dans chacun de ses regards admiratifs, cet amour inconditionnel qu’elle me porte avec toute la simplicité, la grandeur et la sensibilité qui la caractérisent.
Dans la finance et l’investissement immobilier depuis bien des années, je connais parfaitement mon métier et j'ai toujours mis une pointe d’honneur à être le meilleur dans tout ce que j’entreprends.
Quand nous nous sommes rencontrés, elle finissait une licence en immobilier et, bien qu’aimant ce métier, toutes ces années d’études l’avaient lassée. Notre rencontre fut un déclic pour elle, au point qu’elle envisagea d’arrêter son cursus. L’idée de la garder auprès de moi à chaque instant, de ne plus la voir partir des journées entières pour ses cours ou de la savoir concentrée sur ses devoirs quand elle est à la maison m’a paru, pendant quelques secondes, alléchante. Ma motivation la plus profonde est son bonheur. En aucun cas je n’aurais pu vivre sachant que je pourrais être, à un moment donné, un frein à son équilibre et à son bonheur. Il n’était pas bon pour son avenir qu’elle arrête à quelques mois de son diplôme. Je l’aime trop pour ne pas la convaincre d’aller jusqu’au bout du processus.
Elle est aussi aimante et entière qu’intelligente, elle n’a donc eu aucun problème à comprendre son intérêt et à obtenir son diplôme avec brio. Une fois sa licence en poche, elle a tout naturellement mis à profit ses connaissances au service de mes investissements. Ce n’est d’ailleurs plus mon travail, mon métier, mon business, mais le nôtre. Au fil des mois et des années elle est devenue ma collaboratrice la plus précieuse. Aussi instinctifs et complémentaires dans notre vie personnelle que professionnelle, nous en sommes arrivés à ne plus pouvoir nous passer l’un de l’autre, d’où le déchirement de ces quelques jours de séparation. Mais nous savons que c’est un mal pour un bien, car cette nouvelle vie, nous la désirons profondément, nous sommes invincibles tous les deux et tout ne peut que nous réussir.
*
Quelques jours m'ont suffi pour trouver notre petit nid à Marrakech. Un bel appartement dans le quartier européen de Gueliz avec tout ce qu’il faut pour protéger notre bonheur et travailler comme nous l’aimons. Elle m'a rejoint quelques jours plus tard.
J’avoue que cette ville s'accorde parfaitement à notre bonheur et j’aime la voir s’émerveiller de son architecture et de ses décorations. Notre quotidien me plaît autant qu’à elle. Le rythme effréné de notre emploi du temps professionnel, l’ébullition constante de la place Jamaâ El Fna, les senteurs d'épices et la chaleur du climat : autant de choses que nous aimons comparer aux endroits très européens que nous fréquentons !
Mais surtout, ne pas oublier d’où nous venons !
Cet endroit magnifique est à l’image de notre bonheur : beau et exaltant.
Nos dix heures de travail quotidien se trouvent très vite payantes. Ma connaissance du métier et des affaires, son intelligence et sa réactivité dans tout ce que j’entreprends font de nous un duo de choc et rien ne nous résiste.
Chaque journée est un nouveau bonheur, celui d’un quotidien magnifique, digne des plus beaux films romantiques : les journées à flâner dans les souks ou les grandes boutiques, les dîners au restaurant ou les soirées dans les bars les plus chics. Nos fous rires et nos moments de complicité, l’excitation de tout ce que nous accomplissons comme des géants invincibles : moi dans les affaires, elle dans la communication. Elle comprend ce que je veux avant même que je ne termine ma phrase.
Nous sommes l’un et l’autre, l’un avec l’autre, l’un pour l’autre, nous sommes UN, conscients de la chance que nous avons de vivre, à chaque instant, un bonheur unique et sans tache que rien, absolument rien, ne pourra jamais détruire.
*
Ce 28 avril 2011, comme d’habitude, nous sommes au bureau depuis le matin. Sur le moment, je ne comprends pas ce que l’une des clientes en face de moi me dit après avoir raccroché son téléphone :
- Il y a eu une explosion Place Jamaâ El Fna !
Je me revois soudain à la terrasse du Café de Paris sur cette même place où se trouve le Café Argana. C’était hier, Elle, souriante, me rejoint avec son sorbet aux fruits qu’elle vient d’acheter chez le glacier.
Nos clients quittent calmement le bureau et nous fermons les portes tout en regardant le poste de télévision installé dans la salle de réunion. Les images d’horreur qui défilent sont en train d’être filmées à deux pas de nous. Nous sommes comme hébétés. Huit Français et neuf autres personnes de différentes nationalités viennent de perdre la vie à la terrasse d’un café que nous fréquentons régulièrement. Nous prenons doucement conscience que cet attentat va nous obliger à faire une parenthèse dans notre joie de vivre pour réfléchir à notre sécurité.
Quelques jours suffisent à nous faire ressentir les conséquences : des postes de sécurité se mettent en place un peu partout. Nous sommes fouillés dès que nous entrons dans un établissement. Nous passons nos journées au téléphone, à comptabiliser toutes les personnes qui, prises de panique, décident de quitter le territoire ou de stopper les projets en cours.
Le dimanche étant notre seul jour de congé, nous allons presque naturellement, main dans la main, sur la place Jamaâ El Fna. Nous découvrons un théâtre de désolation à la place de ce lieu, d’habitude si vivant. Les marchands ont disparu : les restaurants ambulants ne les remplaceront pas ce soir. Les cafés sont fermés, l’Argana éventré et le glacier ne reviendra plus. Le paysage magnifique qui a si bien accueilli notre bonheur ainsi défiguré nous serre le cœur. Nous remontons l’avenue Mohamed V, blottis l’un contre l’autre. Sans même rien se dire, nous connaissons déjà notre décision : Nous restons ici. Nous mettrons tout notre amour pour le Maroc et tout notre investissement professionnel au service de ce pays pour qu’il retrouve son effervescence et son sourire.
C’est donc avec ardeur et toujours autant de plaisir que nous nous remettons au travail ce matin. Et il y a de quoi faire. Fortes du journal local, des entreprises de construction et d’investissement que nous dirigeons, notre plus beau projet en cours porte bien son nom « Le Domaine », tout comme « l’hivernage » et « Gueliz » sont connus et reconnus dans tout Marrakech, le « Domaine » sera l’adresse de référence au Maroc. Un investissement de grande ampleur qui nous motive à chaque instant : Sur soixante-trois hectares, nichés au cœur de la Palmeraie, nous sommes en train de mettre au monde le nouveau trésor de la ville rouge. Plus de huit cents appartements et villas, un hôtel luxueux et un centre commercial comprenant cent-quatre-vingt boutiques et vingt-deux restaurants. Tout cela dans l’atmosphère unique qui nous caractérise si bien tous les deux : le bien-être, la sérénité, à travers le charme du Maroc et le savoir-faire européen. Chaque instant que nous passons à la création de cet endroit magnifique nous transporte. Toute la communication nécessaire à sa réalisation est entre ses mains, et tout comme j’aime m’y abandonner avec complicité, c’est aveuglément que je lui laisse cette partie importante du projet. Elle excelle dans chacune des étapes à réaliser. Je peux ainsi me consacrer à ce que je sais faire de mieux : les transactions financières et immobilières.
Avec cette allure effrénée, les jours et les mois passent à l’image du ciel marocain : pas un nuage, que du bonheur. La plénitude d’une vie à deux qui s’écoule au rythme du travail et des moments de tendresse. Il nous arrive, parfois même, d’oublier que nous ne sommes pas sur notre terre natale.
Le rappel se fait ce matin : elle doit prendre l’avion dans deux jours pour rentrer en France afin d’y voir sa famille, mais elle s’est rendu compte hier que l’on avait dépassé les trois mois légaux sur le territoire. Ce n’est rien de bien important, tous les étrangers le savent : il suffit de passer au poste de police pour préciser cet oubli et de payer l’amende de cinq cents Dirhams. Une fois cette formalité accomplie, je la vois rentrer dans nos bureaux avec ce sourire radieux qui lui est propre, mais je sens dans son regard une pointe de tristesse. Je sais qu’elle déteste que nous nous éloignions l’un de l’autre. Je n’aime pas cela non plus, mais l’âge m’a donné la capacité de l’accepter plus qu’elle ne pourrait le faire.
*
Pourtant, ce soir, je retarde mon retour à la maison. Je sais qu’elle ne sera pas là, puisqu’elle a pris l’avion aujourd'hui. Quand je rentre dans l’appartement vide, je ne suis pas surpris de voir un post-it collé sur l’ordinateur. Reconnaissant bien la main qui a griffonné quelques mots dessus, je suis les instructions qui s’y trouvent : j’allume l’appareil. Voyant son visage sur l’écran, j'appuie sur la lecture de la vidéo : le regard embué de larmes, elle m’explique avec déchirement à quel point elle est heureuse de rentrer voir ses parents, mais torturée de devoir me quitter pour ces quelques jours. Je prends conscience à quel point le seul but qui m’anime, la seule chose qui me donne envie de vivre, respirer, avancer, c’est de la voir heureuse. Mon plus grand bonheur c’est le sien.
Son absence m’incite à me fondre dans le travail. Autour de notre grand projet immobilier central, gravitent un tas d’autres possibilités de réaliser ce que nous désirons le plus : participer à l’évolution et à la beauté de notre terre d’accueil.
*
Comme cela arrive souvent, je passe la matinée avec un homme venu me proposer son terrain. Un certain Monsieur Jaouad m’explique qu’il s’agit d’une parcelle de cinq hectares située à la sortie de Marrakech. L’emplacement me paraît idéal, car pouvant convenir à bon nombre de nos clients désirant un endroit calme, éloigné des grands domaines déjà existants.
La visite que nous faisons du terrain me convainc définitivement et nous nous accordons sur le prix. Étant prêt à effectuer ma première transaction foncière au Maroc, je décide de m’entourer de professionnels locaux afin que tout soit établi dans les règles du pays. Monsieur Jaouad me propose alors de me rapprocher de son notaire, maître Said Brahim et de son avocat maître Nakh Mohamed, avec qui il a l’habitude de traiter ses propres affaires.
Le lendemain, dans le taxi qui m’amène à l’étude notariale, j’ai la tête et le cœur en ébullition. La transaction que je m’apprête à conclure va être un très beau projet et, comme ma belle rentre de France ce soir, je devine déjà son sourire et son enthousiasme s’associer aux miens. Je suis un homme profondément heureux.
A mon arrivée, le notaire, l’avocat et le propriétaire sont déjà là. Les documents, prêts à être signés, trônent sur le bureau et je m'apprête à sortir mon stylo lorsqu'ils me réclament un chèque de quatre millions de Dirhams pour preuve de mon engagement. Le notaire et l'avocat m'expliquent que c'est la procédure habituelle dans ce type de transaction et que le chèque, en aucun cas encaissé, reste dans le dossier au coffre de l'étude jusqu'à la signature de l'acte définitif. Peu surpris par cette requête tout à fait normale dans bien d'autres pays et confiant en ces deux hommes de loi, bien plus au courant que moi des procédures légales au Maroc, je leur remets le chèque et l’affaire est conclue en toute simplicité. Nous finissons tous les quatre au Café Renaissance ; ils me parlent de futures transactions foncières envisageables, mais j’ai l’esprit ailleurs : j'envisage déjà la masse de travail qu’il va falloir accomplir et je pense au plaisir de savourer la présence de ma chérie, dans seulement quelques heures. La joie de nos retrouvailles fait vite place à l’enthousiasme de ce nouveau projet à réaliser. Tout aussi heureuse que moi de s’investir dans cette aventure, elle me harcèle de questions. Je lui donne tous les détails, lui montre les plans du terrain et tout ce qu’il est envisageable de faire dessus. Le compromis signé le matin même, étant encore à l’étude pour enregistrement, je ne peux le lui montrer pour qu’elle réalise vraiment, mais je lui en explique toutes les closes : ce terrain étant agricole, le compromis est soumis à la condition suspensive d’obtenir La Vocation Non Agricole, dossier que le propriétaire actuel s’est engagé à monter dès le lendemain afin que nous puissions signer la vente définitive et commencer les travaux le plus rapidement possible. Le chèque que j’ai remis au notaire est actuellement dans le coffre de l’étude notariale, comme prévu dans l’acte additif où il est précisé que celui-ci ne sera remis au vendeur qu’à la signature de l’acte définitif, après validation de toutes les clauses suspensives et de toutes les autorisations nécessaires à la réalisation du projet immobilier prévu.
Une fois de plus, je vois l’admiration dans son regard. Elle sait que j’ai pris toutes les précautions nécessaires pour que cet investissement puisse voir le jour et porter ses fruits. Même si la rapidité de la transaction va nous obliger à redoubler d’activité, je la sens transportée, prenant même cette nouvelle comme un cadeau de bienvenue pour son retour à la maison.
*
Pendant les jours qui suivent, nous mettons toute l’équipe sur le dossier. Le bureau est une vraie ruche et l’équipe technique sur le pied de guerre. Elle prépare le plan de communication pendant que je m’attelle au dossier financier.
Je suis à peine attentif lorsque le téléphone sonne, ce matin-là et que j’entends la voix du banquier :
- Monsieur Combes, j’ai un chèque de quatre millions de Dirhams à l’encaissement.
Je reste un peu perplexe et mets du temps à comprendre à quoi correspond ce montant. Mais après vérification, il n’y a aucun doute : il s’agit bien du chèque censé être dans le coffre du notaire. Impossible de laisser partir une telle somme, alors qu’aucun acte définitif n’a été signé. Je m’évertue à tenter de joindre le propriétaire afin de savoir d’où vient l’erreur de cette mise à l’encaissement, mais aucune réponse. Même chose pour le notaire et l’avocat. Au bout de quelques jours, le portable de Jaouad décroche, enfin mais je tombe sur son frère qui m’annonce en toute décontraction que celui-ci est parti pour trois semaines en pèlerinage à la Mecque avec maître Nakh et maître Said. Je suis décontenancé. J’ai conscience que l’Islam est une part importante de la vie des Marocains, mais beaucoup de mal à comprendre comment ils ont pu, sans même m’avoir informé, laisser en plan une affaire d’une telle importance qui devait être finalisée sous quinze jours.
Ce n'est qu’au bout de trois semaines que le propriétaire m’appelle pour me donner rendez-vous au café où nous avions amicalement finalisé la transaction. Ravi de son retour, je ne m’attends pas pour autant à ce qu’il m’annonce : il a décidé de ne plus vendre. Dans ces circonstances, il me demande de me rendre chez le notaire pour signer un acte de désistement amiable qui m’y attend déjà.
Dans le taxi qui m’amène à l’office notarial, je ressens un mélange de colère et d’incompréhension. Tout ce travail acharné de l’équipe pour rien ? Mais mon expérience d’homme d’affaires me dit de ne pas forcer cet achat. Si cela ne se fait pas, c’est que ça ne doit pas se faire, voilà tout. Je décide quand même de faire un détour par la chambre de Commerce de Marrakech afin de me renseigner sur l’état du terrain, et j’apprends de source sûre qu’il était impossible que cette parcelle devienne un jour constructible. Voilà donc la réponse à toutes mes interrogations : le propriétaire a dû se rendre compte, en déposant le dossier VNA, qu’il n’aboutirait jamais et a donc décidé de se désister.
Après avoir signé la fin amiable de cette transaction avortée, j’appelle immédiatement le vendeur :
-Jaouad, c'est Monsieur Combes. Je viens de remplir les papiers d'annulation de vente mais j'aimerais récupérer mon chèque.
-Écoute, ici c'est dangereux de garder un tel document, alors j'ai préféré le brûler, c'était plus sûr.
Je trouve cette attitude bien peu conventionnelle, mais à quoi bon faire un scandale pour des cendres qu'il ne peut de toute façon plus me rendre ?
Je rentre donc chez moi, frustré mais finalement soulagé que tout cela soit terminé. La douceur de ses bras ne met pas longtemps à me faire oublier toute cette escapade et ce temps perdu. Nous avons tant d’autres projets à faire aboutir qui, eux, iront jusqu’au bout !
Les journées reprennent leur cours, partagées entre le travail et nos moments de tendre complicité. Toujours les premiers au bureau, nous avons nos petits rituels : elle allume son ordinateur pour préparer ses priorités du jour, de façon très studieuse et organisée. Je sais qu’elle aime ce moment de calme avant l’effervescence existante dès l’arrivée des collègues, j’ai donc pris l’habitude de lui laisser ce moment de solitude apprécié, pour descendre à la terrasse du Café de Paris et prendre un moment de détente matinale. Je savoure le brouhaha de la place Jamaâ El Fna. Je me souviens des images de désolation qui m’ont tellement marqué après l’attentat d’Argana, alors je suis heureux de participer au pansement de ses blessures. La chaleur de la vie marocaine reprend ses droits et cela me motive chaque matin, puisant dans cette renaissance pour revenir au bureau, retrouver son sourire quand je passe la porte et me mettre moi aussi au travail. Le « Domaine » occupe la plus grande partie de notre investissement professionnel, nous y mettons toute notre énergie, impatients de voir la pose de la première pierre. Nous savons que ce sera une grande victoire et une grande fierté d’avoir contribué à la réalisation de cet endroit magnifique. Tellement concentrés sur notre travail, nous sommes toujours étonnés de voir la fin de journée arriver si vite. Il est déjà 19 heures, même bien passé, lorsque nous fermons les portes du bureau pour nous consacrer simplement à nous. Sur le chemin qui nous mène à notre petit nid d’amour, je m’arrête souvent à « Le Renaissance » où je me relaxe autour d’un verre. Elle m’accompagne de temps en temps, mais le plus souvent, elle préfère rentrer directement. Je sais que lorsque je rentrerai à la maison, elle aura pris une douche, se sera changée et m’attendra étendue sur le canapé avec un petit apéritif déjà préparé pour nous deux. Je savoure cette routine faite de moments à nous, de fous rires et de douce passion.
Notre seul jour de congé, nous continuons à découvrir les beautés qui nous entourent : la splendeur du palais Bahia, les senteurs de la place des Epices, la douceur des jardins de la Ménara et la vue magnifique des montagnes de l’Atlas enneigées. Chaque découverte est un nouvel émerveillement. Je me délecte de son ravissant sourire, quand nous décidons d’aller flâner dans la rue des Princes. Elle redevient soudain une petite fille toute excitée devant les vitrines des boutiques qui défilent au rythme de nos promenades. Je sais qu’elle adore ça, mais depuis quelque temps, elle refuse de sortir seule. Il lui est arrivé trop souvent d’aller faire quelques courses sans moi et de revenir en pleurs. Sa sensibilité est mise à vif lorsqu’elle se fait siffler ou alpaguer par quelques Marocains pour lesquels une belle femme est un objet. Le respect de la gente féminine ne faisant pas partie de leur culture, ils font souvent preuve d’un manque de décence qui leur est très caractéristique. Cela la touchait profondément, elle s’en sentait salie et avait fini par ne même plus descendre chercher un peu de pain en bas de chez nous, sans que je ne l’accompagne. Elle est ainsi ma tendre femme, d’une fragilité sincère derrière sa prestance apparente, invoquant chez moi un instinct de protection empreint d’un amour inconditionnel.
*
Cela fait bientôt un an maintenant que nous sommes au Maroc. Malgré le bonheur de notre quotidien et le plaisir de chaque instant passé ici, je sais que le manque de sa famille restée en France se fait ressentir, accentué par cette peur désagréable de sortir seule dans les rues de Marrakech. La Saint Valentin approchant à grand pas, je décide de lui faire le plus beau des cadeaux.
Je réserve une table au Karobaz, un restaurant magnifiquement romantique qui sera le plus bel écrin de la surprise que je lui prépare. Le jour J, je lui demande de se préparer, ce qu’elle s’empresse de faire, les yeux brillants d’excitation comme une enfant le soir de Noël, devant le sapin illuminé.
Lorsque nous nous asseyons à la table qui nous est réservée, nous sommes bercés par l’ambiance qui nous accueille. Je ne pouvais pas espérer mieux : les bougies et la douce lumière bleutée mettent encore plus en valeur la beauté de son visage, décuplant l’amour qui m’étreint le cœur.
Lorsqu’elle soulève sa serviette et découvre la petite boite en velours qui est dissimulée dessous, c’est avec un sourire radieux qu’elle l’ouvre, les mains légèrement tremblantes. Ses yeux s’embrument de larmes en voyant la bague qui s’y trouve et je ne peux m’empêcher de pleurer aussi à la vue de son émotion. L’intensité de ce moment est si palpable qu’un silence s’abat sur la salle, les gens autour de nous n’existent plus. Nous sommes là : assis l’un en face l’autre, laissant couler nos larmes de bonheur. Seule, résonne dans tout mon être, sa voix vibrante d’émotion qui ne cesse de répéter avec douceur : oui, oui, oui.
Elle me tend la bague que je lui passe tendrement et nous nous embrassons avec passion comme si c’était la première fois que nos lèvres se rencontraient. Au terme de ce baiser qui lie notre amour et notre engagement l’un envers l’autre, je lui demande d’ouvrir le menu qui se trouve sur la table. Lorsqu’elle y découvre les deux billets d’avion pour la France que j’avais achetés la veille, elle explose de joie !
Le dîner se poursuit dans une ambiance romantique et exaltée. Nous nous laissons porter par tous les projets que cette nouvelle étape dans notre bonheur nous amène à envisager : l’annonce de notre mariage à nos familles d’ici quelques jours, l’organisation de cet événement et la façon dont nous voulons qu’il soit à la hauteur de la beauté de nos sentiments. Nous nous remettons même à parler du rêve d’avoir un enfant. Nous avions déjà évoqué ce sujet à maintes occasions, mais soudain cela devient concret et je sais qu'elle désire une fille. J'ai compris à quel point elle a envie de porter en elle une partie de nous deux.
Au moment du dessert, le serveur nous amène un gâteau que j’avais fait faire pour l’occasion : sur le fond blanc de la crème se trouve un cœur brillant d’un glaçage rouge écarlate avec pour seule inscription en lettres joliment dessinées : « Léa » … C’est ainsi que nous avions décidé d’appeler le fruit de notre amour.
De retour à la maison et malgré l’épuisement des émotions qui avaient étreint nos cœurs, nous nous donnons l’un à l’autre avec toute l’intensité de deux corps qui ne font plus qu’un. Chaque baiser, chaque caresse, chaque étreinte a un goût d’éternité. Nous les savourons avec délice et passion.
*
C’est avec la joie de deux enfants insouciants que nous montons dans le taxi ce matin. Après vérification de nos visas, nous nous sommes rendu compte, encore une fois, que nous avions dépassé le temps des trois mois autorisés sur le territoire. Même cela nous fait sourire car nous réalisons à quelle allure le temps passe sans que nous ne nous lassions de chaque instant vécu l’un avec l’autre. Donc, avant d’aller au bureau aujourd’hui, il est quand même nécessaire que nous fassions un détour par le commissariat de la police touristique afin de nous acquitter de l’amende en vigueur et de pouvoir prendre notre avion, comme prévu dans deux jours.
Étant presque devenus des habitués des lieux, certains policiers nous saluent à notre entrée, comme si nous les connaissions bien. L’officier de service prend naturellement mon passeport et tapote sur son clavier d’ordinateur. J’en profite pour détourner mon attention vers elle qui me fait un clin d’œil malicieux. Nous prêtons à peine attention à celui-ci, lorsqu’il nous demande de patienter quelques minutes et quitte la pièce avec mon passeport. Son absence ne fut effectivement pas longue, mais nos échanges et taquineries complices durant ces quelques instants se transforment en étonnement lorsque le policier me demande de le suivre.
Je lui fais part de ma surprise et il m’explique simplement que le service dont les bureaux sont à l'étage du dessous, a besoin de me voir sans qu’il ne sache exactement pourquoi, mais que ça ne prendra pas longtemps.
Quoique perplexe nous le suivons sans sourciller. Il nous fait descendre un escalier et rentrer dans une pièce où j’aperçois une Marocaine assise en face d’une table vide, attendant certainement d’être entendue. On nous fait asseoir devant un bureau où se trouve un policier en civil tenant un dossier dans une main et mon passeport dans l’autre.
-Vous êtes bien Monsieur Philippe Combes ?
Je réponds par l’affirmative ne comprenant pas encore les raisons de ce changement de procédure pour un simple retard de visa. Puis, en me mettant une feuille devant les yeux, il me dit :
-J’aimerais vous entendre au sujet d’un chèque sans provision.
Je regarde le papier qu’il me tend et découvre la photocopie du chèque de quatre millions de Dirhams que j’avais fait pour l’achat annulé du terrain de Monsieur Jaouad. Je ressens un ouf de soulagement : ce n’est donc que ça ! Parce que mine de rien, ils sont en train de nous mettre en retard pour le travail et de désorganiser toute notre journée, notamment les préparatifs nécessaires à notre départ prochain ! J’explique donc tranquillement au policier que ce n’est rien, que ce chèque n’existe plus et que je ne comprends même pas comment sa photocopie a fini sur son bureau. Je lui raconte comment j’ai rédigé ce document dans le cadre d’un compromis qui n’a finalement pas abouti et que toute cette affaire s’est terminée par un acte de renonciation amiable… Mais il ne semble pas comprendre ce que je lui explique, me rétorquant :
-Ce n’est pas les informations que j’ai.
Je décide donc de joindre Jaouad, dont j’ai encore le numéro de portable dans mon téléphone, afin qu’il lui explique dans sa langue natale ce qu’il ne semble pas comprendre en français : mais malgré mes appels répétés toutes les deux minutes, il ne décroche pas.
Le policier me dit que, quoi qu’il en soit de l’appel que je veux passer, il a besoin de m’entendre sur cette affaire. Je la regarde perplexe : mais je viens de lui expliquer ! Elle me sourit et me conseille d’être plus simple dans les termes de mon récit car cet officier ne semble pas comprendre un traître mot de ce qu’est un compromis ou une clause suspensive. Je m’attelle donc à lui réitérer les choses plus simplement et soudain il percute sur le nom du propriétaire :
-Monsieur Jaouad est bien le vendeur ?
-Oui, c’est bien ce que je vous dis, mais il ne vend plus son terrain.
-Et bien, si, Monsieur Combes, il vend toujours !
-Pardon ? Excusez-moi, je vais essayer de le rappeler.
Je prends mon téléphone et compose son numéro pour la sixième fois, espérant sincèrement qu’il va enfin décrocher. Je ne pensais pas être un jour soulagé d’entendre sa voix au bout du fil, surtout après le coup qu’il m’avait fait quelques mois auparavant, mais là, les circonstances l’imposaient.
Je lui explique brièvement la situation et après un échange bref mais direct durant lequel il essaie de me rassurer, me disant qu’il n’y a aucun problème et que tout ça n’est rien du tout, il me demande de lui passer le commissaire pour tout arranger.
La pièce dans laquelle nous nous trouvons est séparée du bureau du commissaire par une simple vitre, ce qui permet au policier de lui faire signe afin qu’il prenne ma conversation téléphonique en cours. Je lui tends le téléphone et pendant qu’il parle en arabe avec Jaouad, je me penche vers Elle pour la rassurer, sentant l’inquiétude qui l’envahissait. Il n’y a pas de souci à se faire, cette transaction s’est terminée dans les meilleurs termes, tout comme va se finir cette visite imprévue des bureaux de la police marocaine.
Le commissaire raccroche, me tend mon téléphone et quitte la pièce avec l’officier. Je les aperçois à travers la vitre discuter tous les deux. Soudain, la Marocaine que j’avais aperçue à mon entrée se tourne vers nous :
-Vous savez, le monsieur que vous avez eu au téléphone, ce n’est pas une personne bien. Ce qu’il vous a dit à vous en français, ce n’est pas ce qu’il a dit en arabe au commissaire.
Mais de quoi elle se mêle ? Je regarde ma future femme qui me sourit avec cette complicité qui nous est propre : en quoi cette personne se permet-elle d’intervenir dans notre bonheur ? Cet épisode désagréable se termine et lorsque nous sortirons tout à l’heure, nous en rirons comme deux gamins qui viennent de passer un mauvais moment sans importance !
Après quelques instants, le policier rentre dans la pièce où nous l’attendons et me demande de lui expliquer à nouveau de quoi il s’agit. Pensant qu’il est juste question de taper son rapport pour clore ce dossier, je prends mon mal en patience et lui explique à nouveau le déroulement de cette histoire. Mais il ne semble toujours pas comprendre un traître mot de ce que je lui dis, il bute entre autre sur le terme « clause suspensive », me demandant même de le lui écrire sur un bout de papier. Vu qu’il tape son rapport en arabe, je suis prêt à lui écrire ce qu’il veut, tant qu’il le termine et nous laisse partir. Je n’ai vraiment pas envie de passer la journée sur une affaire qui n’a même jamais existé et qui m’a déjà fait perdre quelques semaines de mon temps, il y a plusieurs mois ! A force de questions sans fondement et de justifications linguistiques, je finis par rappeler Jaouad pour savoir si ce cinéma va durer encore longtemps.
-Écoute Philippe, tout ça ce n’est qu’un excès de zèle de maître Nakh. Ne t’inquiète surtout pas, il suffit qu’il faxe un désistement au commissariat et tout est réglé !
-Ok, et bien qu’il l’envoie son désistement !
-Pas de souci, je l’appelle tout de suite et je te rappelle dès que c’est fait.
Je raccroche, soulagé, mais j’avoue que l’heure avançant, l’énervement commence à monter. J’ai déjà passé trop de temps et d’énergie sur un projet qui n’aura jamais vu le jour, et me voilà de nouveau à perdre des heures précieuses. La présence de ma compagne en rajoute à ma colère montante : elle n’a rien à faire là, surtout devant des policiers qui sont certainement doués pour régler leur compte à des pickpockets de souks, mais en aucun cas compétents pour traiter un dossier concernant une transaction dont ils ne comprennent même pas les termes basiques.
Je ne cesse de regarder mon téléphone : Jaouad ne rappelle pas. Je finis par demander à l’officier de nous laisser partir travailler, notre bureau étant à huit cents des leurs, il lui suffira de m’appeler dès que tout cela sera réglé afin que je signe les papiers nécessaires.
-Non Monsieur Combes, je ne peux vous laisser partir comme ça, sinon on croira que vous m’avez payé.
Sa réponse me surprend autant qu’elle lui semble évidente :
-Mais donnez-moi le compromis correspondant à ce chèque et je vais voir ce que je peux faire.
Je la regarde avec un sourire malin :
-Oh ! Ma chérie ! Je suis vraiment un nul ! En partant ce matin pour mettre à jour mon visa, j’ai complètement oublié de prendre le compromis d’un terrain que je n’ai pas pu acheter !
L’humour face à l’incompétence est devenu instinctif après toutes mes années de métier. Mais il faut croire que les Marocains sont aussi habiles avec le français qu’ils le sont avec mon humour.
Le policier insiste :
-Donnez-moi ce compromis et on verra.
-Mais je ne l’ai pas ! Je suis venu avec mon passeport, pas avec un document qui n’a même plus raison d’exister, puisqu’il est caduc !
Aïe ! Il ne comprend pas ce que veut dire caduque ! Je la regarde : dans deux jours, nous serons dans un avion pour la France où nous retrouverons des personnes qui comprennent chacun de nos mots. Je découvre au fur et à mesure des heures qui s’écoulent, à quel point ce pays dont nous nous sentions si proche devient soudainement si lointain.
Mon téléphone sonne, enfin c’est Jaouad ! Il m’explique que je n’ai plus à m’inquiéter, car il a pu parler à maître Nakh :
-Il envoie le désistement dès que tu as pu envoyer l’argent.
-Quel argent, de quoi tu me parles Jaouad ?
-Le maître dit qu’il peut faxer le désistement dès que tu lui donnes quatre-cent-cinquante mille Dirhams.
Moi qui suis un homme d’affaires habitué aux chiffres, pour la première fois de ma vie, je n’arrive pas à comprendre. Quatre-cent-cinquante mille Dirhams soit quarante-cinq mille Euros pour un fax ?
Après avoir raccroché sans vraiment saisir ce que tout cela veut dire, je présente la situation au policier qui me répond naturellement :
-C’est le Maroc !
Sa réponse est comme une détonation dans ma tête : NON ! Ce n’est pas ça le Maroc ! Ce pays ? c’est le bonheur que je partage avec elle depuis plus d’un an ! C’est notre raison de travailler, c’est notre nid douillet. Ce n’est pas ça ! Je conçois à peine ce qu’il me demande lorsqu’il nous annonce :
-Nous allons vous garder le temps d’éclaircir cette affaire.
Comment ça me garder ? Je me tourne vers Elle et l’angoisse de ses yeux suffit à prendre sur moi : Il faut qu’elle quitte cet endroit. Je lui explique que l’on a besoin d’elle au bureau et qu’elle reviendra me chercher vers seize heures, qu’on ira boire un café sur n’importe qu’elle terrasse tant qu’on est tous les deux pour oublier ce mauvais moment.
Après son départ, on me fait prendre un autre escalier. Depuis mon arrivée au commissariat de la Police Touristique, je prends conscience qu'à chaque marche, ma descente est de plus en plus profonde… Au fur et à mesure des paliers je découvre des murs détériorés jusqu'à ce que je rentre dans une pièce d’à peine dix mètres carrés avec seulement une armoire et une table. On me demande de vider mes poches, l’officier de police qui m’a interrogé semble m’octroyer un privilège lorsqu’il précise au gardien que je ne suis pas obligé d’enlever mes lacets de chaussures. Il ouvre la grille rouillée du couloir où s’alignent les cellules. Une odeur nauséabonde me lève le cœur lorsqu’il me fait rentrer dans une de ces cages. Parce que ce n’est rien d’autre que cela : des cages. Autant de barreaux formant des cellules encastrées dans le seul mur qui les aligne.
*
Moi, qui m’étais préparé comme à mon habitude pour aller au bureau, prêtant toujours attention à ma tenue vestimentaire, j’avais mis un de mes plus beaux costumes, mes boutons de manchette, mes chaussures cirées à la perfection, je m’étais rasé de près et parfumé : je me retrouve là, seul, au milieu de cette cellule vide et sale. Pas une chaise, pas un lit, rien.
Je regarde le sol en ciment, noir de traces de pas mouillés. Je me rends compte qu'un liquide coule des toilettes situées juste à côté et je comprends à cet instant d’où provient l’odeur d'urine suffocante qui semble imprégner chaque fibre de mes vêtements. Les barreaux sont semblables aux immondices sous mes pieds. L’unique mur en béton est envahi de crachats séchés. Je me rassure en me disant que je n’ai que quelques heures à passer dans cet endroit infâme. Conscient que je ne peux ni m’adosser, ni m’asseoir, je décide de rester debout et de marcher pour ne pas m’engourdir.
Le temps qui s’écoule est d’une longueur interminable. Je pense à la journée de travail que je suis en train de perdre. Aux heures de préparatifs pour notre départ qui s’envole. Mon estomac me rappelle que le café de ce matin est déjà loin. J’essaie d’occuper mon esprit en imaginant que dans quelques heures, je serai avec Elle à une terrasse, dévorant un sandwich et savourant la fraîcheur d’une bonne bière. Ma montre étant enfermée avec toutes mes affaires dans l’armoire métallique de la pièce d’à côté, je n’ai pas conscience du temps passé, lorsqu’enfin le gardien vient me chercher.
Remonté dans le bureau de l’officier de police, Elle, est là soucieuse de savoir comment je vais. Je ne veux pas l’inquiéter plus qu’elle ne l’est déjà : je la rassure en lui disant que tout va bien, que j’ai pu me reposer dans une cellule propre et manger suffisamment. Tout ce qui m’importe à ce moment, c’est d’en finir avec cette histoire qui n’a pas raison d’exister.
Le policier me dit qu’il a terminé son rapport et que je n’ai plus qu’à le signer. Il me tend un document écrit en arabe, qu’il me relit brièvement. Bien que son contenu soit plus qu’approximatif, ne relatant en rien ce que je lui avais expliqué il y a quelques heures, je lui pose la seule question qui m’importe :
-Donc maintenant je peux sortir, c’est bon ?
-Non Monsieur Combes, vous ne sortirez qu’après avoir eu l’accord du procureur.
-Quel procureur ? Quel accord ? Je ne comprends pas ! Vous n’avez rien vérifié de ce que je vous ai dit ! Comment un procureur peut prendre une quelconque décision sans en avoir les éléments nécessaires ? Allez au moins chercher ce compromis. Vous pouvez même me mettre des menottes pour que je vous accompagne !
Le policier reste impassible devant mon incompréhension et me demande simplement si j’ai pu m’arranger avec l’avocat qui m’avait proposé un désistement contre quatre-cent-cinquante mille Dirhams.
-Comment ça ? Je ne vais pas payer quatre-cent-cinquante mille de Dirhams pour un fax ! Cette histoire n’existe pas ! Faites votre travail, faites votre enquête et laissez-moi sortir ! Je n’ai rien à faire ici !
-Et bien Monsieur, dans ces conditions, je vais vous demander d’attendre ici, le temps que le procureur prenne une décision.
Je me tourne vers Elle et l'angoisse sur son visage m’incite à relativiser : d’accord, je vais attendre. Cette affaire n’ayant pas lieu d’être et le temps perdu étant seulement dû à l’incompétence de ces policiers, je sais que le procureur en question va les renvoyer dans leurs pénates et que je vais enfin pouvoir rentrer chez moi.
Le policier revient et me dit sans plus de tact :
-Bon, on va vous garder ! Le procureur examinera votre dossier demain, en attendant, vous êtes placé en garde à vue.
La colère me submerge ! Comment ce pays qui a su, durant plus d’un an, nous montrer un visage civilisé pouvait soudainement devenir si incompréhensible.
-Comment ça vous allez me garder ? Vous ne pouvez pas arrêter les gens comme ça !
-Monsieur, vous êtes simplement placé en garde à vue le temps que nous vérifions vos dires.
-Mais vous aviez tout le temps de vérifier cet après-midi ! Vous avez fait quoi ? Rien, absolument rien !
Les images de la cage dans laquelle j’étais enfermé quelques heures plus tôt, ressurgissent soudainement. Je dois cependant garder mon sang-froid car je lui ai menti : elle ne sait pas dans quel endroit ignoble cet homme est en train de vouloir me faire redescendre. Impassible, il ne veut rien entendre : la séparation est inévitable. Elle sait qu’elle va devoir rentrer seule à la maison et que pour la première fois depuis notre emménagement au Maroc, elle va dormir sans moi. Sa détresse est palpable, je cache la mienne afin de la rassurer au mieux.
*
Je jette un coup d’œil à ma montre avant de la remettre pour la deuxième fois de la journée au gardien : il est dix-neuf heures trente. J’entends la porte de la cellule se refermer derrière moi, je suis désemparé. Comment vais-je tenir toute une nuit dans cet endroit infâme ? Impossible de m’adosser au mur ou de me caler contre les grilles souillées. Pas moyen non plus de m’asseoir par terre dans la pisse qui jonche le sol. Je reste debout, tournant en rond comme un animal en cage. Privé de ma montre et le sous-sol dans lequel je suis enfermé n’ayant aucune fenêtre, je n’ai plus aucune notion du temps qui s’écoule, le rendant encore plus interminable. La fatigue, la faim, le stress de la journée se font de plus en plus ressentir. J’ai mal partout, je ne sais plus comment me mettre, conscient simplement que je dois tenir et lutter contre l’envie de dormir.
Au fur et à mesure des heures, je vois des policiers entasser des Marocains qui arrivent dans des états pitoyables : sales, crachant et vociférant, tous autant ivres les uns que les autres. A chaque nouvel individu qui rentre, je me sens scruté, je me méfie, angoissé à l’idée qu’ils en mettent un dans ma cage. Je suis envahi par la honte : moi qui ai toujours eu l’habitude d’être reçu avec respect dans les plus beaux établissements du monde, comment pouvais-je me retrouver ici ? Traité comme un chien, à la même enseigne que ces hommes en pleine déchéance, alors que je n’ai absolument rien à me reprocher. L’injustice et l’humiliation de la situation m’oppressent.
Seul au milieu des cages au début de ma garde à vue, il suffit de peu de temps pour me retrouver entouré de plus de cinquante Marocains à l’allure lamentable, pire que des clochards, certains tenant ce qui leur sert de pantalon avec leurs mains, d’autres vomissant leurs tripes, rajoutant à l’odeur pestilentielle de pisse déjà existante, des émanations de crasse et d’alcool.
Je m’accroupis au milieu de la cellule essayant de soulager mon corps en me posant sur mes talons. Le froid m’engourdit peu à peu. J’ouvre ma parka, enveloppe tout mon corps en position fœtale à l’intérieur et la referme jusqu’en haut, la tête dans les genoux afin de me réchauffer avec mon souffle et de m’isoler de l’endroit ignoble où je me trouve.
Soudain, j’entends la voix du gardien qui m’appelle. Sortant de ma torpeur, je me rends compte que je suis couché sur le côté, toujours enfermé dans ma parka, baignant dans le liquide puant qui recouvre le sol. J’ai dû m’endormir et tomber à terre sans m’en rendre compte. Je regarde les trois individus qu’ils ont mis dans ma cage, les autres étant bondées. Ils me dévisagent d’un regard malsain, se demandant certainement ce qu’un Européen si bien habillé fait dans cet endroit sordide. Engourdi et courbaturé, je réussis à me lever pour suivre le policier qui me remonte dans son bureau.
A jeun depuis la veille au matin, je lui demande s’il est possible que l'on me serve quelque chose, mais il me répond que ce n’est pas comme cela que ça se passe ici et que c’est à la famille de subvenir à mes besoins alimentaires. A cet instant, je regrette d’avoir menti à ma future femme hier en lui disant que l’on m’avait donné à manger. Mais je devais la rassurer au mieux et de toute façon dans quelques instant tout va se terminer : je vais rentrer, jeter mes vêtements imprégnés des odeurs immondes d’en bas, prendre une douche et manger un plat qu’elle m’aura préparé. Lorsqu'elle rentre dans le bureau, sa beauté tranche avec la vision d’horreur de l’endroit que je viens de quitter. Habillée avec goût, comme à son habitude, maquillée et parfumée, seuls ses yeux rougis laissent entrevoir la nuit difficile qu’elle vient de passer. Moi je me sens tellement sale que j’ose à peine répondre à son étreinte.
Je demande au policier si toute cette histoire est finie et s’ils ont fait leur travail en récupérant le compromis qui prouve l’inexistence de cette affaire. Il me répond par la négative et me demande simplement où j’en suis avec la proposition de désistement de l’avocat. Je m’effondre sur la chaise en face de son bureau. Je suis vidé du calvaire de la nuit passée. Je capitule.
Je me tourne vers Elle qui semble aussi désemparée que moi :
-Écoute ma chérie, tu vas aller voir ce salop d’avocat. Il veut quatre-cent-cinquante mille Dirhams ? Négocie au mieux, tu paies et je dégage, je ne supporte plus !
Désormais, tout ce qui m'importe c'est de pouvoir prendre l’avion qui doit nous ramener en France le lendemain. Mon esprit fatigué a occulté les mois de bonheur que je viens de passer dans ce pays, je ne vois que les images innommables de cette cage. Je veux partir, fuir loin de ces fous inhumains et incultes.
Je la regarde partir, soulagé de savoir qu’à son retour ce cauchemar sera terminé. Le policier en face de moi semble soudainement plus agréable, me proposant même un café en me disant qu’enfin tout cela sera fini dans quelques heures. Je prends le verre chaud qu’il me tend comme s’il me remettait le bien le plus précieux au monde, chaque goutte de son breuvage explose dans ma bouche, réchauffe mon corps gelé, réveille mon esprit engourdi. Doucement, je reviens à la réalité et l’improbabilité de la situation. Mon raisonnement logique reprend le dessus : tout cela est impossible ! Je ne vais pas payer cet escroc alors que je n’ai rien à me reprocher et qu’est-ce qui me dit qu’il ne va pas continuer à me faire chanter, me demandant encore et encore plus d’argent ? Je ne dois pas rentrer dans cet engrenage !
Je demande à l’officier de police si je peux passer un coup de téléphone, prétextant avoir omis une précision à ma femme. Elle décroche, m’explique qu’elle est à deux minutes de chez l’avocat et ne cache pas son étonnement lorsque je lui demande de revenir au poste immédiatement. Je vois la tête du policier se décomposer au fur et à mesure qu’il m’entend lui expliquer :
-Bébé, ces hommes sont en train d’essayer de nous voler. Je ne céderai pas à ce chantage ! La police va faire son travail, elle va vérifier toute cette histoire et ce sont eux qui vont finir en taule ! Même si ça nous coûte de perdre encore quelques heures, je vais bien finir par être déféré devant un juge plus compétent que ces flics.
Lorsque je raccroche, je vois dans le regard de l’officier de police qu’il a compris que je ne paierai pas. Je lui demande quelle est la procédure pour en finir avec tout ça : il me réclame à nouveau le compromis, je bous de colère :
-Mais je ne l’ai pas avec moi ce putain de compromis ! Vous avez eu toute la journée d'hier pour aller le chercher ou me relâcher pour que je puisse vous le ramener. Et si ma femme y va, là, maintenant, qu’est ce que vous allez me trouver comme excuse pour me garder encore ?
-Aucune Monsieur Combes, elle n’a qu’à nous l’apporter !
Elle, à peine passée la porte du bureau, je lui demande de remonter dans le taxi pour aller chez le notaire. Je n’en peux plus de fatigue et d’énervement, sans compter l’amertume de la voir courir dans tous les sens pour m’aider à sortir de cette situation qui la dépasse. L’office notarial étant à seulement huit-cents mètres du commissariat, à peine cinq minutes se sont écoulées lorsque mon téléphone sonne : Elle est en pleurs, elle m'explique entre deux sanglots que le notaire est absent et que les personnes présentes à l’étude refusent de lui remettre quoi que ce soit.
Mon estomac se tord de la sentir ainsi désemparée. Revenue au commissariat, j’essaie tant bien que mal de la réconforter, mais nous n’arrivons seulement qu’à tomber dans les bras l’un de l’autre, échangeant sur la totale incompréhension qui nous anime. Nous ressentons soudainement de l’animosité face à ces gens et leur pays que nous avons tant aimé et pour qui nous nous sommes tellement donnés.
Le policier entre à son tour dans le bureau et m’annonce que je serai présenté au procureur le lendemain matin. Mes yeux s’attardent sur le beau visage plein de larmes qui me regarde avec angoisse, je comprends que je dois la décharger du poids de cette situation grotesque. Elle n’a pas à vivre ni à subir tout cela. Depuis trois ans que nous partageons notre bonheur, je me suis toujours attaché à la protéger, cela doit rester ma priorité.
L’avion qui devait nous emmener en France étant prévu le lendemain, je lui explique qu’elle doit prendre ce vol et que je la rejoindrai dès que j’aurais vu le procureur. Ces policiers sont incompétents et dépassés par cette affaire, leurs supérieurs verront l’évidence de mon innocence et mettront tous ceux qui en sont à l’origine, derrière les barreaux. C’est seulement après de longues minutes à insister pour qu’elle aille se mettre à l’abri de tout cela auprès de sa famille, après nombre de sanglots et de larmes que je m’efforce d’apaiser, qu’elle accepte finalement de quitter le commissariat pour se préparer à prendre l’avion très tôt le matin.
A la demande de l’officier, deux subalternes rentrent dans le bureau et m’attrapent par les bras pour m’escorter dans la geôle immonde qui m’attend au sous-sol. Elle, passe devant moi et nous séparons avec déchirement à la porte de la pièce. Le cerveau anesthésié d’incompréhension, de douleur et d’injustice, je trouve la force de les stopper devant l’escalier qui doit me descendre vers l’horrible cage dont le souvenir de l’odeur me lève déjà le cœur. Je tourne mon regard vers le bout du couloir où Elle se trouve, prête à sortir. Nos regards se croisent avec une force inexplicable. Les quelques secondes de cet échange visuel me semblent si courtes et interminables à la fois. Toute la puissance de notre amour traverse les quelques mètres de ce couloir. Elle va partir vers la France rejoindre les siens. Moi, je descends vers l’enfer, seul…
*
Je réintègre ma cage avec un dégoût amer de déjà vu. N’ayant avalé qu’un café depuis deux jours, la faim me tord l’estomac. Mais pire encore, tous les membres de mon corps sont endoloris par la fatigue, chaque neurone de mon cerveau est embrumé par l’incompréhension, mes yeux sont vides de ses larmes. Je ne sens plus rien, je ne pense plus à rien, je ne suis plus rien. Je dois laisser mon esprit s’évader pour surmonter cette injuste et douloureuse solitude. Alors je l’imagine : le visage maculé du maquillage que ses larmes ont emporté, elle fait sa valise, le cœur étouffé par mon absence. Elle n’arrive pas à comprendre comment ces gens que nous aimions tant ont pu nous enlever la joie de ces préparatifs ensemble, le bonheur de s’envoler tous les deux vers la France pour annoncer à nos proches l’événement de notre mariage et la joie d’envisager un jour l’arrivée de Léa… Les heures passent et la nuit s'écoule tout aussi terrible que la précédente. Je continue alors à m’absenter de l’entourage immonde dans lequel je me trouve pour l’accompagner dans mes pensées : monter avec elle dans cet avion que nous devions prendre tous les deux, sentir son cœur se serrer au moment du décollage et regarder par le hublot cette terre qu’elle aime tant et déteste profondément à cet instant, car elle lui enlève celui qui est toute sa vie. Je sais ce qu’elle ressent, car nous sommes un depuis toujours. Dans la puanteur et la solitude de ma cage, tout mon être vibre de la même déchirante blessure.
Lorsque je me réveille, je me rends compte que je suis dans la même position fœtale que la veille. Baignant dans les immondices, entouré à nouveau de trublions ivres et puants, une douleur vive me perce le haut de la cuisse lorsque j’essaie de me relever, mais je l’occulte : je dois sortir d’ici, je dois tout faire pour la rejoindre au plus vite.
Les policiers font sortir tout le monde dans le couloir qui dessert les cages et je les vois menotter chaque prisonnier deux par deux. Au fur et à mesure qu’ils s’approchent de moi, je me dis que ce n’est pas possible : ils ne vont pas m’attacher à l’un d’eux ! Pourtant, je reste sans voix lorsque je sens le bracelet se refermer sur mon poignet. Mon cerveau n’arrive même plus à analyser les événements : je suis la meute à laquelle l’on m’a attaché et nous montons dans un fourgon grillagé qui m’amènera, je l’espère, vers la sortie de ce cauchemar.
Le véhicule n’est pas assez grand pour la faune qu’il doit transporter. Les policiers, nous poussent et nous entassent tant bien que mal. Dès que nous arrivons devant le palais de justice, la grille rouillée qui sert de porte réservée aux prisonniers s’ouvre sur un sas où nous nous engouffrons, toujours menottés deux par deux, les uns derrière les autres, jusqu’à un corridor d’au moins trente mètres de long sur à peine un mètre de large. L’endroit est d’un jaunâtre sombre, éclairé par une seule ampoule pendante, laissant entrevoir des murs tout aussi décrépits et sales que ceux de la cage d’où je viens de passer les deux dernières nuits. De la pissotière ouverte dans un renfoncement, émane aussi l’odeur suffocante et infecte de déjections humaines. Au delà de la soixantaine de Marocains qui me précédent, j’aperçois un escalier où commence à monter chaque détenu à l’appel de son nom : il est à peine 8 heures du matin. Je ne comprends pas comment ils peuvent me laisser là, enfermé dans une telle promiscuité avec ces hommes bien plus dangereux pour un Européen qu’ils ne le sont déjà amplement pour leurs propres concitoyens. N’ayant ni mangé, ni bu, ni même pu me changer ou me laver depuis mon arrivée au poste de la police touristique, je me sens imprégné de crasse et de puanteur. Le corps engourdi par la douleur et la fatigue je puise dans ce qu’il me reste de forces pour rester debout. Soudain mon téléphone, qui m’a été restitué en même temps que l’on m’a menotté, se met à vibrer. Je réussis à le sortir de ma poche et mon cœur bondit d’un dernier sursaut de bonheur lorsque résonne la voix familière de mon jeune fils. Resté en France il a été prévenu de ma détention par ma future femme. Au son de ma voix, incapable de cacher mon l'épuisement et la profonde détresse dans laquelle je me trouve, il semble inquiet :
- Écoute papa, je sais que tu es un homme fort et droit, tiens le coup. J’ai toujours été fier d’être ton fils, ne te laisse pas aller et ne fais pas de conneries ! Tu es et resteras le seul exemple que je veux suivre. Je t’aime papa, j’ai besoin de………….
Mon téléphone a coupé : plus de batterie. La solitude qui m’oppresse doublement depuis qu’Elle a quitté le territoire, se matérialise une nouvelle fois. Le dernier fil qui me reliait à la civilisation vient de se couper. Le temps s’écoule avec une lenteur interminable. Chaque seconde semble alourdir un peu plus mes muscles et vider mon cerveau. Depuis que le premier détenu a été appelé ce matin, je n’ai vu aucun d'entre eux redescendre l’escalier et il reste à peine cinq prisonniers. Quand j’entends mon nom, il est plus de 18 heures. Je ne sais même pas comment mes jambes ont encore la force de monter les marches qui m’amènent enfin vers le dénouement de ce cauchemar. Mais j’ai confiance : je vais enfin avoir à faire à une personne compétente qui comprendra que tout cela n’est qu’une mascarade, une injustice sans nom : dans quelques minutes je serai dans un taxi pour rentrer chez moi.
Le policier qui m’attend en haut de l’escalier m’attrape par le bras et me fait entrer dans une pièce, pas moins vétuste, mais nettement plus propre. A ma gauche au fond de la pièce, j’aperçois une table couverte de dossiers derrière laquelle sont assis deux hommes. Le plus imposant par sa tenue vestimentaire civile et très chic, doit être le procureur. A quelques mètres en face de moi, un deuxième officier est posté devant une autre porte et je comprends alors pourquoi je ne voyais pas revenir les détenus qui ont été appelés au fil de la journée. Celui qui me tient par le bras, me dirige dans l’espace restreint qui se trouve entre deux murets en béton, à quelques pas du procureur qui me demande de décliner mon identité. Puis le magistrat sort un document et me présente, non pas une photocopie comme je l’avais vu au commissariat, mais le chèque émis quelques mois auparavant :
-Vous le reconnaissez ?
-Oui, Monsieur, mais sachez que ce chèque concerne un terrain qui ne peut pas être vendu. Lorsque je me suis renseigné auprès de la chambre de commerce de votre ville on m’a expliqué qu’il était agricole et qu’il ne pourrait jamais devenir constructible et encore moins être acheté. De plus, le vendeur s’est rétracté et une renonciation amiable du compromis a été signée chez le notaire.
-Vous êtes d’accord de le payer ?
-Mais bien entendu ! Si le terrain est vendable, le notaire vient, il vous dit que la transaction est possible et je l’achète. Je serai même le premier content !
Le procureur semble absent et indifférent à ce que je lui dis.
-Vous êtes le signataire de ce chèque ?
-Oui c’est moi ! Mais je ne comprends pas : cette affaire est une affaire commerciale ! Je suis signataire de ce chèque pour une société qui veut acheter un terrain. Ce terrain, on ne veut plus nous le vendre ! J’ai aussi découvert que l’on ne peut même pas me le vendre… Ce chèque a été émis pour une transaction qui finalement n’existe pas ! Que voulez-vous que je fasse ?
-C’est moi qui pose les questions ici ! Est-ce que c’est bien vous qui avez signé ce chèque ?
-Oui !
-Avancez !
Le policier resté à mes côtés me pousse vers le bureau et le deuxième homme assis auprès du procureur me tend un papier écrit en arabe :
-Signez là !
Je n’arrive pas à entrevoir si ce que je viens d’expliquer a été compris, mais je me dis que, même si ce n’est pas le cas, mon affaire sera transmise devant un juge d’instruction. Tout ce qui m’importe c’est d’en finir pour aujourd’hui et de rentrer chez moi. Je trempe mon doigt dans l’encrier pour apposer mon empreinte sur le document, seule signature possible dans le service judiciaire marocain, au vu du nombre d’illettrés qui y défilent, et le policier m’entraîne vers la sortie.
Moi qui pensais passer par la porte que tous les détenus précédents avaient dû prendre, il me dirige vers celle par laquelle je suis rentré et me ramène dans le couloir immonde où je viens de passer la journée. Je ne comprends pas. Je pose la question aux trois prisonniers qui restent là, attendant leur tour :
-Pourquoi les autres ne sont pas redescendus ? Ils ont encore des formalités à faire ? Pourquoi ils me remettent ici ?
-Parce que tu pars en prison !
En prison ? Mon cerveau épuisé semble ne pas pouvoir assimiler cette annonce. Nous étions plus de soixante ce matin ! J’étais entouré de malfrats qui ont été libérés alors qu’ils portaient sur eux leurs capacités aux actes les plus inqualifiables et moi on m’envoie en prison ? Non ! C’est impossible ! Absolument impossible ! Je ne suis ni un voleur, ni un violeur ! Seulement un homme qui a toujours fait son travail professionnellement et honnêtement ! Mon corps, ma tête, tout mon être se retrouvent incapables d’ingérer cette situation. Je n’y arrive pas : il va se passer quelque chose. Je ne sais pas quoi, mais il doit se passer quelque chose.
Je me retrouve finalement seul dans ce couloir infâme lorsque deux policiers rentrent par la grille d’où j’étais arrivé le matin même et me menottent sans un mot. Ils m’entraînent vers un camion qui attend à l’entrée, m’enferment dans la cage à l’arrière et montent à l’avant. L’engin démarre. Je n’arrive plus à penser. Je ne sais pas où ils m’emmènent. La prison ? Non. Ce n’est pas possible !
Assis sur le banc en fer, je dois basculer légèrement mon bassin pour me soulager un peu, car la douleur que j'ai ressentie en haut de la cuisse ce matin n'a cessée d'augmenter au fur et à mesure de la journée. Je n'en peux plus : il faut que je dorme. Même dans l’urine de ma cage en garde à vue, il faut que je dorme. A travers les hublots teintés de blancs mais griffés par les détenus précédents j’entrevois les rues de Marrakech. J’aperçois des gens et je me revois me baladant à ses côtés et nous posant à une terrasse de café. Soudain le fourgon s’arrête devant une porte bleue immense qui s’ouvre lentement.
*
Les portes arrière du fourgon s'ouvrent et un des deux policiers m'attrape par la chaîne des menottes pour me faire sortir. Des barreaux formant une alcôve se dressent devant moi, je remarque une inscription en arabe au-dessus. Je ne sais traduire mais mon esprit me renvoie la phrase de l'Enfer de Dante : " Vous qui entrez ici, abandonnez toute espérance ".
La solitude de ma situation m'oppresse : personne au monde ne sait où je suis. Pas un membre de ma famille, pas une seule de mes connaissances ne peut imaginer que l’on est en train de m'enfermer dans l'une des prisons les plus inhumaines de cette planète. Moi-même, je n'arrive pas à assimiler comment j'ai pu me retrouver ici. Comment des hommes peuvent-ils priver un autre homme de sa liberté d'une façon aussi arbitraire ? Tout cela dépasse mon entendement.
Ils me poussent par la porte qui vient de s'ouvrir et m'enlèvent les menottes. En face de moi, se tiennent d'autres uniformes de membres de la police et des hommes en treillis militaire qui me regardent comme une bête curieuse. Je n'ose imaginer le spectacle qui les intrigue ainsi : depuis trois jours que je n'ai ni mangé, ni dormi, que je porte les mêmes vêtements imprégnés de la crasse et de la puanteur des différents endroits où j'ai été traîné. Ni lavé, ni rasé, ni coiffé, je ne dois plus ressembler à rien et encore moins au responsable financier respectable que j'ai toujours été. Je me sens comme une loque humaine incapable de réfléchir. À quoi bon de toute façon : plus personne n'interviendra en leur demandant d'arrêter et que tout cela n'est qu'une erreur. Alors je me laisse entraîner par ces hommes comme une bête vers l'abattoir : résigné. Ils me poussent vers la seule table de ce qui semble être un hall et me demandent de vider mes poches. Je m’exécute, n'osant ouvrir la bouche que lorsque l’on me dit de déposer aussi la chevalière que j'ai au doigt :
-Mais cela fait vingt ans que je la porte, je ne l'ai jamais enlevée, je ne vais pas réussir à vous la remettre !
On me fait comprendre que si je ne le fais pas, là où je vais, on me coupera le doigt pour me la voler. Je la mouille et tire dessus autant que possible. M'arrachant la peau, je réussis à la poser sur le bureau.
Une fois délesté de mes effets personnels, on me tend un papier avec des inscriptions en arabe qui doit en être la liste et je le tamponne de mon pouce trempé dans l'encrier. Puis ils me dirigent vers un sas électronique servant d'entrée à une autre pièce bien plus petite où se trouvent les hommes en treillis que j'avais vus à mon arrivée. Ils m'ordonnent d'enlever mes vêtements. Je ne suis plus en état d'avoir un quelconque choix, je me déshabille avec la honte d'un homme réduit à l'asservissement. En enlevant mon pantalon, je découvre une boule de la grosseur d'une orange en haut de ma cuisse et comprends la raison de la douleur qui me lacère à chaque mouvement ou position depuis ce matin. Au fur et à mesure que je me dévêts, ils prennent mes affaires et les passent au peigne fin, déchirant les ourlets, enlevant les semelles intérieures de mes chaussures au point d'en décoller complètement la semelle, écrasant une partie des cigarettes qu’il me restait.
Moi, je reste là, en caleçon, au milieu de cette pièce sombre et froide, je les regarde me dépouiller. Puis, l'un d'entre eux me demande d'enlever ce qu’il me reste de mon intimité. Complètement nu, il me demande de m’accroupir et m'oblige à tousser en me tapant violemment dans le dos. Je suis au summum de l'humiliation. Je ne suis plus un homme mais un animal à la merci de maîtres insensibles.
Je me rhabille avec ce qui reste de mes vêtements. Mon pantalon sans ceinture tient à peine après ces trois jours de jeûne, ma chemise est déchirée, ma parka dégoûtante et mes chaussures explosées m'obligent à traîner les pieds lorsqu'ils me sortent de cette pièce.
Du mur blindé situé au fond du hall d'entrée, une porte s'ouvre. Une odeur suffocante digne d'une décharge me prend la gorge. A travers les barreaux que forment un sas dans lequel je me trouve, je vois deux grilles gardées chacune par un geôlier. L'une à ma droite et l'autre à ma gauche. Poussé vers la deuxième, j'arrive dans un couloir longé de cellules. Face à chacune d'elles, au sol, se trouve un trou d'environ vingt centimètres de diamètre. J’apprendrai plus tard que sont les toilettes qui se déversent dans ces égouts ouverts et que c'est de là que parvient cette odeur nauséabonde insoutenable.
Encadré de deux cerbères, je passe devant la première geôle et mon esprit me renvoie immédiatement aux photos des camps de concentration de la seconde guerre mondiale : dans une pièce de cinq mètres sur dix, j'aperçois un amoncellement de corps et de tissus sales. Je comprends que ces hommes sont si nombreux dans ce petit espace, qu'on ne peut qu'entrevoir des têtes, des pieds et des mains dans ce fatras de chiffons qui leur sert de vêtements ou de couvertures.
Au fur et à mesure que j'avance, traînant mes chaussures transformées en savates, le spectacle des cellules qui défilent reste le même et me glace le sang. Le bruit du cliquetis des clés des gardiens a intrigué certains prisonniers qui s'approchent des grilles pour me regarder d'un air étrangement effrayant. Pour la plupart, ils ressemblent aux ivrognes que j'ai déjà vus lors de mes nuits de garde à vue. Ce sont les mêmes êtres sales et répugnants mais avec en moins ce qui pouvait leur rester d'humain. Certains n'ont plus de dents, ou s’ils en ont, ce ne sont plus que des chicots noirs. Je passe à côté d'un homme, ou ce qu'il en reste, tellement il saigne de partout, le visage tuméfié, accroupi dans le couloir, il a une main attachée par une menotte aux barreaux d'une des cellules. Un peu plus loin, un autre vêtu de haillons, le regard hagard, la face tailladée de vieilles cicatrices, est assis par terre et se masturbe ouvertement. Arrivé à sa hauteur, l'un des geôliers lui envoie un violent coup de Rangers en pleine figure.
La vision de cet enfer me dépasse. Je me dis que ce doit être un quartier pour les punis, les fous ou les cas les plus dangereux. Ils vont sans aucun doute m'amener vers une cellule plus adéquate à mon statut. Mais au bout du couloir, nous nous arrêtons devant une geôle identique à celles que je viens d'entrevoir. Lorsqu’ils en ouvrent la grille, je marque un temps d'arrêt. Elle est tellement bondée que je ne sais même pas si je vais pouvoir y rentrer. Poussé sans ménagement par les gardiens, je sens un nombre incalculable d'yeux me dévisager. Je n'ai pas la force de lever les miens, j'espère seulement que les geôliers vont rester au moins quelques minutes pour vérifier que je ne me fais pas agresser. Je repense aux conseils qu'on nous donnait lorsque nous arrivions au Maroc : "Surtout faites attention lorsque vous allez vous promener dans les souks ou ailleurs ! Souvenez-vous toujours que les étrangers sont la première cible d'agressions et de vols"
Mais je les vois repartir, me laissant là, seul avec le pire de tous ces hommes déjà si dangereux à l'extérieur. Remarquant un lit sur lequel il n'y a pas de matelas, je me faufile jusqu'à lui et m'assois sur le bord des lattes en fer. Attendant que l'un d'entre eux vienne m'indiquer ma place, pour peu qu'il en reste. J'essaie de trouver une position qui ne fasse pas trop souffrir ma jambe de plus en plus douloureuse. Je suis vidé, complètement à bout de force. Je mets ma tête entre mes mains et ferme les yeux, incapable de résister au gouffre de fatigue qui m'aspire.
*
Secoué par des prisonniers, je sors de ma torpeur. Je me rends compte que je suis recroquevillé sur les lattes en acier du lit où je suis tombé de fatigue et que j'ai passé la nuit ainsi. Une grande agitation s'est emparée de la cellule, je les vois tous sortir dans le couloir et s'aligner le long des murs. Suivant le mouvement comme un automate, je me lève et me mets à la fin de la file. Elle me paraît tellement longue que je n'arrive à imaginer qu'il ne s’agit que du contenu d'une seule et unique geôle : les gardiens nous égrainent, deux par deux, comptant et recomptant chacun des quatre-vingt-cinq prisonniers, au fur et à mesure que nous réintégrons notre cage.
Durant les longues minutes qu'ont duré l'appel, j'ai pris le temps de regarder les visages de mes codétenus : je suis envahi par l'idée que quelque chose de grave va m'arriver... Il me paraît impossible que j'en ressorte indemne alors que je suis entouré de tous ces gens dont les regards ne peuvent cacher leur animalité. Pour la première fois de ma vie, je découvre ce qu'est la sensation oppressante de la peur.
Je regarde les cinquante mètres carrés de la cellule, essayant de ne croiser aucun regard : des seize lits superposés au moindre centimètre carré de sol, je ne vois que des moribonds sales entassés les uns sur les autres. Certains sont difformes, d'autres ont le visage ou le corps scarifié. « La Cour des Miracles » de Victor Hugo devait être un lieu magnifique comparé à ce capharnaüm où je suis enfermé.
Au pied d'un des lits j’aperçois une couverture enroulée. Le plus discrètement possible et soucieux de ne rien toucher de la crasse qui m'entoure, je vais m’asseoir dessus en tailleur. J'essaie de m'isoler en mettant ma tête entre mes mains, mais les bruits environnants m'assaillissent : ceux qui ne parlent pas fort se raclent la gorge avant de cracher je ne sais où. Des deux toilettes turques situées dans un coin de la cellule, sans cloison ni porte pour les isoler, j'entends ceux qui se soulagent sans aucune pudeur. Tout ceci me semble irréel.
Je ne sais pas combien de temps il s'est écoulé lorsque j'entends un brouhaha infernal : mélange de bruits de clés, de grilles qui s'ouvrent, de gens qui crient, se bousculent et courent. Le mouvement s’étend à ma geôle qui se vide dans une cohue de bêtes énervées. J'attends un peu pour me protéger de la bousculade, puis je suis la meute jusqu'à la cour intérieure de la prison.
En voyant la file de prisonniers qui se forme devant les cabines téléphoniques, je comprends leur empressement à sortir pour être à la meilleure place et pouvoir envisager de passer leur appel. J'apprendrai que la règle est de deux essais possibles et seulement trois minutes de communication autorisées, ce qui ne laisse que peu d'espoir aux derniers de la file d'accéder à la cabine.
Je m'assois sur une sorte de trottoir près d'un angle du mur d'enceinte. Je me fige pour ne laisser que mes yeux examiner le lieu où je me trouve. Des milliers de prisonniers présents, il y a ceux qui déambulent tournant tous en rond dans le même sens au milieu de la cour, ceux qui se bousculent et se disputent dans les files d'attente aux cabines téléphonique, espérant gagner une ou deux places. Je réalise qu'il y a moins de quatre jours, je m’apprêtais à fêter la Saint-Valentin avec Elle, bien loin d'imaginer que ma vie basculerait ainsi dans cet autre monde. J'essaie de comprendre et d'analyser au mieux la situation malgré la peur et la faim qui me tiraille.
Je lève les yeux en entendant un homme me dire « Salut » et commencer à me poser des questions auxquelles je prête à peine attention. Je le regarde et ressens une sorte de soulagement en voyant le faciès d'un Européen : pas de balafre, de chicots noirs ou de regards pervers. Un visage d'homme, tout simplement. Il parle un français impeccable. Comprenant à quel point je me sens perdu et déboussolé, il commence à me prodiguer quelques conseils :
-Ici, tu ne dois faire confiance à personne, tu es entouré de ce qu'il existe de pire dans la race humaine : meurtriers, violeurs, escrocs, incendiaires, j'en passe et des meilleures. Moi, j'ai pris trois ans pour une petite arnaque à la con, j'arrive au bout de ma peine, alors je sais de quoi je parle !
Soudain, j'entends les sifflets provenant des gardiens qui font un maximum de bruit en tapant sur les cabines téléphoniques avec leurs matraques pour que tous les prisonniers s'engouffrent vers la porte menant aux cellules. Je suis le mouvement au mieux, toujours retardé dans mes déplacements par la douleur grandissante de ma jambe. Arrivé dans ma cage, je repère la couverture sur laquelle j'avais trouvé refuge ce matin, et m'y rassois au plus vite afin que cette place me reste attribuée. J'ai trop peur de devoir me mêler aux autres. Accroupi, la tête dans les mains, j'ai le sentiment d'être invisible et, par conséquent, un peu en sécurité. Je reste cependant vigilant aux va et vient des détenus qui passent près de moi, ainsi qu'aux bruits incessants qui m'entourent.
Au bout de quelque temps, les gardiens amènent une grande gamelle en fer dans laquelle se trouve un liquide vert. Les prisonniers s'approchent un à un avec une petite auge en plastique que les geôliers remplissent. N'ayant toujours rien mangé depuis près de quatre jours, je m'avance sans oser me demander ce que peut être cette pitance, trop content de pouvoir avaler quelque chose. Le gardien à qui je demande où je peux avoir un bol en plastique me tend un pain rond et me dit simplement de me « démerder » pour le récipient. Conscient que je dois manger, quelle que soit l'odeur infâme émanant de cette gamelle, je décide de rompre mon pain en deux, d’enlever la mie et de m'en servir comme contenant. De retour sur ma couverture, je me recroqueville sur moi-même afin de protéger au mieux mon repas des allées et venues des détenus qui sortent des toilettes, les mains dégoulinantes où des particules de crasse se soulèvent à leur passage. La tête entre les genoux, je commence à manger le plus doucement possible, la douleur de mon estomac vide me faisant bien trop souffrir pour dévorer cette nourriture écœurante.
A peine revigoré d'avoir pu ingérer quelque chose, j'ose lever la tête pour regarder autour de moi, évitant au maximum les regards qui me fixent. J'aperçois un gardien qui passe devant la cellule et me faufile jusqu'à la grille pour lui expliquer à quel point ma jambe me fait souffrir, mais ce dernier me dit qu'il n'est pas possible que l’on s'occupe de moi aujourd'hui et que l'on verra ça le lendemain. Demain semble si loin : tant d'heures à passer encore dans ce taudis. Une nuit supplémentaire que je vais devoir passer sur un morceau de lit dénué de matelas ou sur un sol crasseux. Je ne sais quel instinct m'incite à chercher une solution pour alléger au mieux ou au moindre mal, les conditions inhumaines de cet endroit. J'essaie de m'adresser aux quelques trublions qui semblent les moins atteints pour leur demander où est ma place dans la cellule, mais ils semblent ne rien comprendre de ce que je leur dis. Les voyant, tous autant qu'ils sont, entassés à trois ou quatre par lit, je ne sais pas comment je vais pouvoir passer la prochaine nuit. Je retourne m’asseoir sur ma couverture avec pour seule information : j'ai déjà un surnom « le Gaori », ce qui veut dire « étranger » dans un arabe peu châtié.
Puis un homme s'approche de moi :
-Tu préfères le « DVD » ou « la gare » ?
Je reste interloqué et lui demande ce qu'il veut dire.
Il m’explique dans un français approximatif que le DVD est une place sous un des lits superposés à même le sol et que la gare est l'espace qui sépare les deux rangées de lits.
Je regarde le bas de celui où je suis adossé et calcule à peine vingt centimètre d'espace en hauteur sur tout juste soixante de large. Tous les lits étant collés les uns aux autres, il n'est pas possible de rentrer par le coté, mais seulement par le pied. Comment peut-on même se glisser là dessous ? Je me tourne vers l'allée qu'ils appellent la gare et je vois tous ces prisonniers allongés à même le sol, agglutinés les uns contre les autres en quinconce. Ceux qui se déplacent sont obligés de les enjamber, cherchant un emplacement à la taille de leurs pieds entre chacun des corps pour ne pas leur marcher dessus, les arrosant de leur sueur crasseuse ou autres particules peu ragoutantes. Je ne peux imaginer dormir collé à l'un d’entre eux. J'opte donc pour le DVD. L'homme me dirige vers celui qui m'est attribué : c'est une véritable porcherie où s'entassent des détritus de tous genres, certains tellement anciens que je ne saurais dire ce qu’ils avaient pu être auparavant.
Alors que je me demande encore comment je vais pouvoir me glisser sous ce lit et dormir au milieu des ordures, un gardien m'amène une couverture. Elle est grise, d'un tissu rêche, pleine de taches dont je n'ose imaginer l'origine. J'essaie de regarder comment font les autres avec la leur, car la promiscuité m'empêche d'avoir l'espace suffisant pour pouvoir la plier convenablement. Je décide de la rouler, la pose à l'entrée du DVD qui m'a été attribué et la laisse rouler sous le lit afin qu'elle en recouvre un maximum le sol. Étant inimaginable de demander aux détenus qui m'entourent de se pousser un peu pour me laisser intégrer cet espace si restreint, je continue à réfléchir afin de savoir comment je vais pouvoir faire pour m'y glisser. Ne trouvant aucune solution, je retourne m’asseoir, attendant de voir comment va faire l'un d'entre eux.
Le temps s'écoule d'autant plus lentement que je n'en ai plus la notion. Je comprends seulement qu'il est 14 heures lorsque le vacarme des gardiens qui ouvrent les cellules m'apprend que l'heure de la deuxième promenade est arrivée. Attendant que la cohue identique à celle de ce matin soit passée, je sors de la cellule au rythme lent que m'impose toujours ma jambe malade. Je suis content de voir, au bout du couloir, la lumière du soleil qui vient de la cour. Je me rends compte à quel point l'être humain est capable d'une soumission comparable à celle d'un animal bien dressé lorsqu'il est privé de son libre arbitre et qu'il ne peut avoir pour seule ambition que de se préserver.
Je me pose à nouveau sur mon bout de trottoir dans l'angle de la cour, le mur derrière moi, tout en me protégeant, m'assure d'une vision totale de tous les prisonniers présents. Le Français rencontré ce matin revient me voir pour me demander une cigarette. Denrée rare et très prisée ici, j'apprendrai que c'est aussi la monnaie en vigueur dans ce monde. Il me questionne sur la raison de mon incarcération. Je lui raconte en quelques mots l'incompréhensible histoire qui m'a amené dans cet enfer :
-Oh ce n'est que ça ? T’inquiète ! Dans une semaine tu es dehors !
Une semaine ? Les quatre heures qui me séparent de la précédente promenade me semblent une telle éternité comment imaginer passer une semaine ici ? Je ne peux pas vivre là, même une semaine, c'est impossible !
-Moi quand je sortirai dans trois mois, cela fera trois ans que je suis incarcéré, et des prisons j'en ai fait quelques-unes, alors une semaine c'est rien !
Évidemment, lui m'a avoué être coupable de son larcin mais moi, je n'ai rien à faire ici. Le laissant dans l'ignorance d'un homme qui se satisfait de sa condition, je lui demande comment l’on doit faire pour accéder au téléphone. Il m'explique qu'il faut remplir un bon pour commander une carte qui me sera remise sous quinze jours.
-Quinze jours ? Mais moi, personne ne sait que je suis ici et d'ici quinze jours je serai sorti !
-Il me reste du crédit sur la mienne si tu veux je te l'échange contre quelques clopes !
Reconnaissant de sa proposition, je suis vite dépité en réalisant que je n'ai aucun numéro de téléphone sur moi : ils sont tous dans mon portable qui m'a été enlevé à mon arrivée.
De retour dans ma cellule, assis sur ma couverture, je ferme les yeux essayant de me remémorer au moins un numéro. Tous étant préenregistrés, je n'en connaissais aucun par cœur. Comme quoi la technologie peut nous rendre complètement inaptes face à la capacité de l'être humain de mettre un de ses congénères dans une situation si abominable.
Il doit être à environ 22 heures lorsque je me décide à rentrer dans mon DVD. Après avoir vu un de mes codétenus effectuer l'opération, j'ai compris pourquoi ils appelaient cela ainsi : devant se glisser les pieds en avant la tête sur le côté en se faisant le plus fin possible, la comparaison est évidente. Je m'exécute au mieux, motivé par la nécessité de m'isoler malgré la déchetterie dans laquelle je m'introduis.
Les températures étant basses à cette époque de l'année : je me love à l'intérieur de ma parka. Caché sous ce lit, je ferme les yeux et je me laisse emporter : j'imagine où je pourrais être à cet instant si tout cela n'avait pas existé. Certainement dans mon canapé à regarder « Les Experts » ou je ne sais qu'elle autre série télé, totalement détendu, Elle, blottie dans mes bras. Je prends conscience à quel point cette évasion de la pensée me fait du bien ! C'est décidé : jusqu'à ce que l'on me sorte de cet endroit, je n'y vivrai pas ! Je me transporterai à chaque instant là où je devrais être normalement ! Il n'y a qu'ainsi que je tiendrai : en vivant ma vie dehors, par procuration de l'esprit, restant ainsi en lien avec celui que je suis vraiment !
*
Il doit être à peine 7 heures du matin lorsque je suis réveillé par le prisonnier qui m'avait été désigné comme étant le “chef de chambre”. Il me secoue en criant :
-Mah'kama, Mah'kama, Mah'kama....
Je m'extirpe de mon DVD complètement ensuqué et sors de la cellule. Ne sachant pas vraiment où aller, je sais seulement que “Mah'kama” veut dire tribunal et que les prisonniers qui attendent comme moi devant leurs geôles sont certainement prévus pour y passer aussi aujourd'hui. Les regardant se faire offrir un café ou autre breuvage par leurs congénères à travers les grilles de leur cage, j'essaie de sortir de ma torpeur en aspirant au même privilège, mais aucun des membres de la mienne n'apportera quoique ce soit au “Gaori”.
A l'appel des gardiens, je les suis jusqu'à une petite cour opposée à celle de la promenade et nous sommes alignés en file indienne, deux par deux le long d'un mur. Les rosiers qui arborent ce patio m'embaument le cœur, y voyant même un petit coin de paradis au milieu de cet enfer carcéral. Nos geôliers nous font passer par une fouille bien plus succincte que celle déjà connue et nous dirigent vers le hall où j'avais dû déposer mes effets personnels. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué la cellule qui se trouve près de la grille d'entrée. Cette cage ne pouvant certainement contenir pas plus d'une vingtaine de personne, ils nous bousculent et nous poussent afin de faire rentrer la cinquantaine que nous sommes. Certains ont même le visage acculé aux barreaux tellement nous sommes tassés.
A l'arrivée des policiers, ils nous font sortir, nous menottent les uns aux autres et nous amassent, sans plus de ménagement, dans les fourgons qui nous attendent à l'entrée. Dès qu'un des véhicules est plein, au point de pouvoir à peine en fermer les portes, ils le laissent partir et remplissent le suivant, comme on le fait dans les pays les moins civilisés, pour les bêtes destinées à l'abattoir.
Après une quinzaine de minutes de trajet, nous arrivons au tribunal. Passé la grille d'entrée, je reconnais sur ma droite le répugnant “couloir du procureur”, mais c'est dans la cellule de gauche que nous sommes dirigés. Les endroits successifs dans lesquels nous sommes amassés depuis ce matin nous obligent à gérer au mieux la promiscuité imposée des menottes qui nous tiraillent le poignet. Pour peu que l'éloignement dépasse les quelques maillons de la chaîne qui nous sépare- nous devons même parfois nous donner la main pour souffrir un peu moins - Après quelques instants, nous montons un escalier et au fur et à mesure que nous entrons dans une nouvelle pièce, les policiers nous libèrent de nos bracelets.
J'aperçois une autre porte que celle par laquelle nous venons de passer, les prisonniers s'y engouffrant à l'appel de leur nom. Je comprends, au nombre que nous sommes, que le temps peut être long, mais l'espoir qu'il y a au bout, m'incite à tenir bon. Je vais enfin voir un juge ! Tout ceci n'étant qu'une mascarade bien moins qu'une grossière erreur : ce soir, au plus tard, je serai chez moi !
Je relativise même l'endroit où je me trouve : des toilettes turques, toujours aussi répugnantes, ouvertes sur cette pièce décrépie, émane une odeur tout aussi nauséabonde, mais bien moins suffocante que celle de ma cellule. Je conçois même que l’on m’ait jeté en prison durant ces deux derniers jours : c'était le week-end, pas un magistrat compétent ne pouvait s'occuper de ce malheureux malentendu. Allumant une cigarette, je regroupe l'énergie qu'il me reste pour penser à ma sortie imminente. Un homme près de moi me demande poliment du feu. Le “poliment” me sort de mes pensées : c'est tellement impensable de là où je viens et si naturel d'où je suis issu.
Je regarde le Marocain qui s'adresse à moi et revois le visage de ceux avec qui j'ai l'habitude de travailler dehors. Bien loin des faciès monstrueux empreints d'inhumanité que j'ai côtoyés ces derniers jours, sa vue associée à mes pensées, me donne un avant-goût de liberté.
Nos cigarettes allumées, la conversation s'engage naturellement. Il m'explique qu'il est médecin, incarcéré depuis près d'un mois pour avoir accepté de pratiquer un avortement. Âgé de plus de soixante ans, il a été mis dans le quartier des “anciens” : en d'autres termes, le mouroir de la prison, bien plus calme et moins dangereux que celui où j'ai été enfermé. Il m'explique que l'aile dans laquelle je me trouve s'appelle “Petit Daya”, celle consacrée à ceux qui encourent la correctionnelle. Le couloir que j'ai vu sur ma droite en intégrant la prison est l'aile “Génaya”, destinée à ceux qui vont devoir passer aux assises. Cette dernière étant toujours en surpopulation, regroupant plus de cent dix détenus par cellule, ils étaient obligés d’en envoyer certains dans mon quartier. Je devais cependant être heureux de me trouver parmi “les moins pire du pire sur l'ensemble de ce qu'il y a de pire”.
A sa demande, je lui explique succinctement ce que je fais là :
-Mais c'est du n'importe quoi ton affaire ! Qui est le notaire ?
-Brahim Said
-Ah, je connais ! Et l'avocat c'est Nakh ?
-Oui.
-Et le soi-disant vendeur ?
-Jaouad.
-Ah ok, je vois, je les connais tous autant qu'ils sont ! J’ai eu souvent l'occasion de les rencontrer lors de soirées et cocktails où j'étais invité. Toujours ensemble ces trois là ! Ils sont amis depuis longtemps et connus pour leurs escroqueries ! D'ailleurs, ça fait près de cinq ans que le procureur général de la cour d'appel essaie de les coincer !
Ses mots résonnent dans ma tête comme un appel à la liberté que j'espère.
-Tu as un avocat ?
-Et non ! Je n'en ai pas besoin, je vois le juge aujourd'hui et je vais pouvoir lui expliquer !
Il ne semble pas convaincu par ma réponse, mais peu m'importe : je sors aujourd'hui ! Cette perspective me redonne du courage. Ne pouvant plus tenir debout, car éreinté par le manque de sommeil, la faim et ma jambe qui me fait atrocement souffrir, je m'approche du seul banc existant dans la salle et m'impose avec tous les “excusez-moi” de la bienséance française. Étonnés de mon audace bien plus que de ma politesse, les détenus qui y avaient trouvé place se poussent pour me laisser m’asseoir. L'instinct animal qui m'a envahi depuis mon entrée à Boulmharez me dit que je ne dois plus bouger de cet espace acquis et, malgré la douleur qui m'assaille la cuisse, je cherche une position qui me soulage tout en continuant la discussion avec le seul homme pourvu d'esprit qu'il m'ait été donné de rencontrer depuis ces dernières soixante-douze heures.
Nous échangeons sur le sujet qui le concerne : l'avortement au Maroc. Venant d'un pays où son emprisonnement serait invraisemblable, il n'y a pas vraiment de débat. Je le conforte dans la raison évidente que l'intervention qu'il a pratiquée pour cette jeune fille violée était juste et justifiable....
Lorsque le gardien l'appelle, il me remercie pour cet échange et avant de partir me dit simplement :
-Je t'envoie un avocat, tiens le coup !
Je lui suis reconnaissant, mais n'ose lui dire que je n'ai aucun besoin d'un avocat puisque toute cette histoire sera finie ce soir.
Il doit être environ 14 heures lorsqu'il quitte la cellule pour passer devant le juge. Après son départ les heures s'écoulent, de plus en plus longues et avec elles l’espoir qui m’habitait s’étiole petit à petit. N'ayant encore rien mangé, ni bu depuis la ration infâme de la veille, je ne sais même plus qu'elle est la douleur la plus intense : celle de ma jambe ou de mon estomac. Au fur et à mesure qu'ils sont jugés, les prisonniers reviennent et se regroupent dans un coin de la pièce. Quand ils arrivent à une dizaine, un policier les fait sortir pour les ramener à la prison. Je me sens tellement mal, qu'arrivé en fin de journée, je n'ai plus qu'une seule envie : que l'on me ramène aussi. La faim, la fatigue et la douleur ont raison de mon espérance de liberté, je désire seulement manger un peu de pain et m'isoler dans mon DVD pour me reposer.
Passé 21 heures, je ne suis plus que l'ombre de moi-même lorsque l’on m'appelle enfin. J'essaie de récupérer un peu de force : c'est la dernière ligne droite ! Même si je devais sortir à genoux pour prendre un taxi, il faut que je tienne le coup !
Je rentre dans la salle du tribunal : sur ma droite se trouvent des bancs vidés par l'heure tardive où ne restent assis que quelques avocats et civils. Je me dirige tant bien que mal vers la barre en face de moi et me tourne sur la gauche pour faire face au juge. Le procureur et un greffier sont à ses côtés. Il me fait décliner mon identité et me demande de confirmer ma nationalité.
-Avez-vous un avocat ?
-Non
-Avez-vous un traducteur ?
-Heu... Non.
-Report lundi !
Je ne peux accepter cette réponse et dans un ultime effort :
-Mais, je suis accusé d'un chèque sans provision ! Je veux juste vous dire que ça n'a jamais été un chèque sans provision !
-Report lundi !
Un policier m'attrape fermement par le bras et me dirige vers la cellule d'où je viens. Incapable de réfléchir, ni même de réaliser ce qu'il vient de se passer, je me laisse entraîner. Une fois dans le fourgon, je me demande comment je vais pouvoir tenir une semaine. Je n'ai rien d'autre que les vêtements que je porte depuis quatre jours, mes chaussures défoncées et quasiment plus de cigarettes. Complètement démuni, je ne vois d'autre solution que le Français rencontré dans la cour de promenade. De toute façon, je n'ai ni le choix, ni la force de me révolter, je suis exténué.
De retour dans ma cellule, mes codétenus me regardent tous en répétant :
-Report, report, report ?
Je réalise que, pas un d'entre eux ne m'a gardé ne serait ce qu'un morceau de pain : je ne mangerai donc pas aujourd'hui. Je me glisse dans mon DVD et m'isole dans ma parka. N'étant plus capable de rien, je laisse le sommeil m'emporter.
*
Le lendemain, je ne sors de mon trou qu'au chahut annonçant la promenade. A peine posé sur mon bout de trottoir, le Français me rejoint :
-Report ?
-Oui.
- Normal, le juge du lundi il n’est pas donné.
-Qu'est-ce que tu veux dire ?
-Oh ! Toi tu n’as toujours pas compris comment fonctionne la justice au Maroc ! Faut pas compter dessus ici, même si tu as raison, tout ce qu'ils attendent c'est le nombre de Dirhams que tu peux leur donner. Chaque jour, tu as un juge différent et en fonction de celui sur lequel tu tombes, l'enveloppe peut être plus ou moins importante. C'est ton avocat qui négocie le prix et lui remet le montant nécessaire pour ta libération. Donc il faut que tu le choisisses en fonction du juge avec lequel il travaille.
-Mais pour moi il n'y a pas d'affaire ! Je ne vais pas payer le juge alors que c'est moi qui suis victime d'une escroquerie !
-Oui, tu as raison, dans ton cas c'est un peu différent. Tu devrais porter plainte contre les trois pourritures, cela obligerait le juge à traiter ton cas différemment.
Il me dit que pour porter plainte, je dois expliquer mon cas dans le détail et aller déposer ma plainte au bureau du greffe situé dans le “patio aux rosiers” à côté de la bibliothèque. Là, ils me feront signer ma plainte, la tamponneront avec un numéro d'envoi afin qu'elle soit officiellement enregistrée.
-Mais je n'ai ni papier ni crayon.
-Je peux te prêter un stylo, pour le papier, il faut aller voir le gardien en charge des commandes : il t'en fournira une ou deux feuilles gratuitement. Viens, je vais te montrer où demander.
Nous nous dirigeons vers les cellules. Sur le trajet, je lui demande comment je dois faire pour me procurer des cigarettes, car j'arrive à court.
-Tu dois passer commande auprès du même gardien, là où je te conduis. D'habitude, il faut compter quinze jours à trois semaines pour être livré, mais, comme tu es nouveau, tu as le droit à une commande exceptionnelle urgente que tu pourras réceptionner dans la semaine.
-Ah cool ! Avec l'argent que j'avais sur moi à mon arrivée, j'ai suffisamment pour une cartouche de Gauloises blondes !
-Ne prends pas des Gauloises ça vaut rien ici ! Si tu veux pouvoir t'acheter des trucs, la seule monnaie en vigueur c'est les Marquises !
Nous arrivons dans l'un des cachots situés au bout du quartier où un gardien est assis à une table. Il me tend une feuille où je dois y inscrire mon numéro d'écrou. Je ne suis plus un nom désormais, juste un numéro que je vais devoir apprendre par cœur : 73863.
Une fois cette formalité remplie, je repars avec les quelques feuilles blanches que m'a fourni le geôlier et nous passons par la cellule du Français afin qu'il me prête un stylo. J'en profite pour lui poser l'une des questions qui me tarabuste depuis que je sais que je vais devoir m'organiser afin de tenir la semaine :
-Où puis-je me procurer un bol pour manger ?
-Ah ! Ici on appelle ça une “choupina” : je peux t'en filer une, mais garde-la précieusement c'est difficile à avoir !
-Merci ! Et des couverts ?
-Tu me fais rire ! Ça n'existe pas en prison, il faut te les faire ! Attend, je vais te montrer.
Il attrape une carte téléphonique usagée qu'il casse en deux et la frotte contre le sol pour l’affûter. Il me tend les deux morceaux et le bol en plastique avec un couvercle bleu :
-Et voilà ! Couteau, fourchette et Choupina : tu as ton trousseau de prisonnier !
Je prends ma cigarette allumée et brûle le dessus de la boite à plusieurs endroits. Marquer ce qui m'appartient deviendra un geste instinctif. Dans ce taudis le peu d'hygiène que j'ai la possibilité de garder me parait vital à préserver. J'aplatis un de mes paquets de cigarettes vide afin qu'il prenne moins de place dans la poche de ma parka et y glisse mes “couverts” : ce sera mon portefeuille.
Voyant que j'étais souvent obligé de remonter ou de tenir mon pantalon privé de ceinture et devenu presque trop grand suite à la privation de nourriture, il attrape un sac en plastique qu'il déchire et me le donne. Ayant vu, sur certains détenus à quoi cela pouvait servir, je le tords pour en faire un lien que je glisse dans deux des passants et fais un nœud, resserrant ainsi mon pantalon afin de l’ajuster à ma nouvelle taille.
Entendant le vacarme des gardiens qui sonnent la fin de la promenade, je retourne dans ma cellule.
Isolé dans mon DVD, je commence à rédiger ma plainte. Les faits et la situation étant limpides, je n'ai aucun mal à remplir les feuilles blanches remises par le gardien. Seul le moment du repas m'interrompt. Toujours assailli par la peur lorsque je me retrouve seul dans ma cage, entouré de tous ces fous furieux, je me fais le plus discret possible, attendant mon tour pour faire remplir ma Choupina. Aujourd'hui, c'est « patates-carottes » : des pommes de terre explosées aux carottes dures et filandreuses ; je suis cependant ravi. J'ai perdu l'envie de manger, seule la nécessité compte.
*
Les journées s'écoulent, aussi longues qu'identiques. Entre les promenades et les deux seuls repas, je m'organise autour des codes de ce monde à part, que j'apprends petit à petit. Ce qui m'occupe et m'obsède le plus c'est l'hygiène. Les conditions insalubres qui abritent ces hommes dont le mot « propreté » leur est foncièrement inconnu, rend les choses très compliquées.
Le simple fait de devoir aller aux toilettes est un vrai calvaire : situées dans la cellule, elles sont seulement séparées par un petit muret et dans un état infecte, tout autant que l'odeur qui s'en dégage. Deux planches semblables à de vieux volets sont destinées à être calées pour s'octroyer un semblant d'intimité. Trempant constamment dans les déjections et la pisse, elles sont noires et rongées. Je n'ose même pas utiliser le seul point d'eau qui se trouve dans cet endroit répugnant, n'imaginant pas qu'une eau potable puisse sortir de ce robinet rouillé, éclaboussé d'urine, de matières fécales et de crachats. Je sais que cette hantise de la crasse qui m'entoure m'empêche de faire beaucoup de choses, comme boire, mais il m'est vital de ne pas être atteint par toutes ces souillures.
Même l'idée de prendre une douche n'est pas envisageable : elles se trouvent dans un espace semblable à une cellule, les tuyaux qui montent le long des parois sont dénués de pommeaux. Ouvertes seulement deux fois par semaine, ils se regroupent à une vingtaine, sous chaque filet d’eau, se bousculant, s'engueulant et se savonnant, collés les uns contre les autres, pataugeant dans un liquide couleur sang, dû aux plaies et scarifications encore fraîches qu'ils ont tous sur le visage ou le corps.
Le Français me l'avait expliqué : hormis les bagarres sanglantes qui éclatent plusieurs fois par jour, certains se tailladent volontairement. Pour les uns, c'est en vue de faire les caïds dans leur quartier lorsqu'ils seront sortis. Pour d'autres, en manque de drogue, leur peau les fait tellement souffrir qu'ils se scarifient par besoin.
A chaque promenade avec mon compatriote, j'en apprends un peu plus. Je scrute la cour et à chaque détail qui m’interpelle, il m'en donne la réponse. Lors d'une d'entre elles, je vois l'énergumène qui se masturbait dans le couloir le jour de mon arrivée, se déshabiller et déambuler complètement nu au milieu des prisonniers. Malade psychiatrique, il a pris perpétuité pour avoir tué son père à coups de pierres, ce dernier refusant de lui donner deux Dirhams. Mieux valait l'éviter et surtout qu'il ne t’appelle jamais « papa » ! Plus tard, je regarde un autre prisonnier qui piétine, le regard vers le sol, se baissant et se relevant régulièrement :
-Qu'est ce qu'il fait ?
-Oh lui ? C'est juste un ramasseur de mégots.
-Et eux là-bas, pourquoi ils n’arrêtent pas de cracher comme ça ? Ils sont malades ?
-Non absolument pas ! Tu verras que c'est normal et habituel chez eux. Ils se raclent la gorge bruyamment et crachent comme ça tout le temps ! Parfois on a même l'impression qu'ils dégueulent carrément !
Il les connaît bien tous autant qu’ils sont, car depuis plus de deux ans qu'il est incarcéré, le Français a un mode de fonctionnement bien à lui : c'est un « taxeur professionnel ». Dès qu'il croise un Marocain parlant un tant soit peu français, il lui demande de façon anodine ce qu'il faisait comme métier avant de se retrouver ici et peu importe la réponse que ce dernier lui fait, il a toujours la même :
-Ah ! Tu sais moi j'ai une société à l'extérieur et je vais avoir besoin de toi ! Comme je sors dans quelques mois, laisse-moi tes coordonnées pour que je puisse te recontacter. Tiens, file moi une clope le temps que je note ça !
Espérant tous un emploi à leur sortie, ça marchait à chaque fois, et il les tenait avec cette promesse, récupérant ainsi - sans devoir dépenser quoique ce soit - toutes sortes de denrées. C'est sa façon de survivre. A ce rythme, il n'est pas loin d'embaucher toute la prison !
Moi, j'en aurais été incapable, ce n'est pas dans mon tempérament, mais surtout, je ne veux rien avoir à faire avec ces miteux dangereux !
De tout ce que je découvrais, j'ai rapidement conclu que dans ce monde je devais oublier tout ce qui faisait de moi un homme civilisé. Pas lavé, pas rasé, ni coiffé depuis des jours, je n'ose imaginer à quoi je ressemble. Traînant mes chaussures explosées, ma parka sale et mon pantalon tenu avec un lien en plastique, mon allure de clochard ne dénote pas dans cet enclos de sauvages ! Exit la politesse, les « bonjour Monsieur », les « s'il vous plaît » ou les « merci ». Oubliés les couverts et le maintien à table pour manger proprement ! Comparé aux règles en vigueur ici, même le règne animal serait moins hostile à un véritable être humain.
Toujours habité par la peur, je maintiens mes distances pour ne rentrer dans aucun conflit. Il ne se passe pas un soir sans qu'un minimum de trois disputes sanglantes n’éclate dans ma cellule et la dernière bagarre m'a conforté dans l'idée de rester le plus invisible possible.
Ne comprenant pas un traître mot d'arabe, je ne saurais dire qu'elle en était la raison, mais ce que j'ai vu m'a tétanisé : Les deux belligérants se sont rentrés dedans violemment, le plus costaud a attrapé la tête de l'autre, la lui coinçant sous son aisselle, il s'est servi de sa main libre pour lui incruster les doigts dans l’œil et le lui a arraché complètement. Alors qu'il tenait la totalité du globe oculaire dans sa main, l'autre hurlait et le sang qui giclait partout dans la cellule ne semblait déranger aucun des détenus, presque divertis par le spectacle.
*
Il ne me reste que trois jours à tenir avant mon passage devant le juge prévu lundi. Hier, j'ai enregistré ma plainte au bureau du greffe de la prison. Les quatre pages que j'ai pris soin de rédiger, expliquent dans le moindre détail l'escroquerie dont je suis victime et ne pourront laisser d'autre choix au juge que de me libérer. Je pense à ce que je ferai à ma sortie : me laver, manger et aller me faire soigner. Je n'en peux plus de traîner cette jambe douloureuse. Aucune position ne réussit à me soulager et l'espoir de voir un médecin m'a vite été enlevé : ici c'est mission impossible ! Ceux qui sortent de leur cellule pour des raisons de « santé » sortent les pieds devant. Chaque geôle est équipée d’une porte blindée habituellement toujours ouverte pour permettre à l'air, aussi nauséabond soit-il, de circuler à travers les grilles. Lorsque les gardiens les ferment, c'est qu'un mort doit être évacué. Malgré la violence omniprésente, elle n'est pas la raison de ces décès. Ceux qui partent ainsi sont le plus souvent « libérés » par la maladie, le manque de soins ou l'absence d'hygiène.
Je n'ai même pas conscience que mon cerveau s'est réduit à ne penser qu'à ma survie : plus de réflexion, de prévision, d'anticipation... Plus rien de tout ce qui le faisait fonctionner jusqu'ici. Ne devant travailler que pour survivre en évitant les situations dangereuses, il a assimilé la routine quotidienne. A un tel point que je mets un peu de temps à réagir lorsque le gardien m’appelle et me fait sortir de la cellule.
Je le suis comme un automate qui traîne sa patte esquintée. Dans le hall qui a vu mon entrée, à côté de la cage où j'ai été entassé avant de partir pour le tribunal, il y a un petit bureau dans lequel il me pousse.
Un Européen propre et bien habillé m'y attend. Assis à la seule table de la pièce, son regard me laisse deviner qu'il ne s'attendait pas à voir une loque humaine débarquer.
-Bonjour Monsieur Combes, je suis Monsieur Pimon, consul de France à Marrakech. Comment allez-vous ?
Au diable la politesse et la bienséance : Vu mon état lamentable, comment pense-t-il que je puisse aller ? Vidé de tout espoir, mais surtout exténué par la douleur physique autant que psychologique, je n'ai pas le temps de lui répondre, qu'il continue :
-Nous avons eu un appel d'un membre de votre famille qui nous a informés de votre situation, d'où ma présence ici. Après avoir pris connaissance de votre dossier, je peux vous assurer que vous êtes victime d'une véritable escroquerie : vous ne saviez pas qu'un terrain agricole, pour autant qu'il puisse un jour être constructible, ne peut, de toute façon, jamais n’être vendu à un étranger ? La loi au Maroc l'interdit formellement ! Les trois personnes qui vous ont proposé cette transaction ne pouvaient l'ignorer, étant originaires et notables de ce pays ! Donc…
-Monsieur ! J'ai parfaitement conscience de tout ça mais je suis incapable d'en parler aujourd'hui ! Depuis les premiers jours de ma détention j'ai une grosseur au-dessus de la cuisse qui me fait souffrir le martyre et personne ici n'accepte que je vois un médecin : je n'en peux plus.
Il fait signe au gardien posté sur ma droite et lui demande d'appeler le directeur. A peine quelques minutes après l'arrivée de ce dernier, je me retrouve à l'infirmerie.
-En voilà une belle infection ! Vous avez bien fait d'insister pour venir car vous étiez bon pour une septicémie.
Le médecin attrape une seringue vide, qu'il pique dans l'orange bleutée que j'ai au dessus de la cuisse. Je sens la douleur être aspirée, au fur et à mesure qu'il me vide de ce qui semble être du sang noirâtre. Après m'avoir fait avaler quelques cachets, je suis raccompagné à ma cellule, presque gambadant.
-Alors tu as retrouvé ta jambe ! me dit le Français lorsque je le rejoins à la promenade suivante.
Je lui explique la visite du consul et lui brandis, presque heureux, le bout de papier que ce dernier m'a donné avec le numéro de téléphone de la personne qui l'a prévenu.
-Cool ! Tu es bon pour apprendre à jouer des coudes et de malice si tu veux te faire ta place dans la file téléphonique !
-Je passe chez le juge dans deux jours, je ne vais pas alerter ma famille pour rien ! Je les appellerai une fois libéré ! Tout ce dont je rêve là, c'est d'un café !
-Ah, désolé moi je n’en bois pas, d'autant plus que c'est dur à avoir, ils ne font que du thé ici.... Mais tu vois le tatoué là-bas ? C'est aussi un Français et il a une cafetière.
Je regarde l'Européen qu'il me montre un peu plus loin dans la cour, dont les morceaux de peau visible laissent effectivement entrevoir une « bande mal dessinée ». Étant nouveau venu depuis moins d'une semaine, si un compatriote n’a pas jugé convenable de venir me porter son soutien, je ne me vois pas faire le premier pas. J'oublie donc le plaisir d'un café pour le moment, bien trop intrigué par le mouvement qui a envahi la cour.
Maintenant, habitué aux cris et hurlements incessants, je n'avais pas fait attention à la voix qui semblait recouvrir celles des autres et au silence qui s'était imposé. Comme un seul homme, je vois des centaines de prisonniers s'agenouiller face contre terre, recouvrant presque à eux tous la totalité du sol. Avec étonnement, je regarde le Français qui me chuchote :
-La prière du vendredi.
Habitué et respectueux de la religion musulmane depuis plus d'un an que je vis au Maroc, je ne m'attendais pas à la voir ainsi exprimée dans cet enfer. Toujours en chuchotant, il me précise :
-Tu vois l’Imam qui dirige la prière ? Lui, il est ici parce qu'il avait un fils de cinq ans qui avait des problèmes d'élocution.
-Et alors ?
-Il a pensé qu'un fils handicapé c'était foireux pour un Imam, il l'a donc égorgé.
-Mais c'est ignoble ! Et il est dans ta cellule, lui ?
-Oui, mais toi tu as pire comme colocataires ! Tu as vu les quatre Marocains qui sont arrivés hier dans ta cellule ?
-Vaguement.
-Eux, ils viennent d'être condamnés pour viol.
-Comme bon nombre ici, si j'ai bien compris !
-Ah oui ! Mais eux, ils ont carrément déterré le cadavre d'une jeune fille qui venait d'être inhumée pour violer sa dépouille chacun leur tour !
Je suis abasourdi par ces révélations impensables ! Totalement tétanisé à l'idée de devoir vivre quotidiennement à coté de tels monstres.
*
Le lundi tant attendu est arrivé. Comme je m'y étais préparé, je suis le même rituel qu'il y a huit jours : l'attende dans le couloir à la grille de ma cellule regardant les autres prisonniers prévus en jugement se faire offrir des collations à travers les barreaux. La fouille dans le « Patio aux rosiers » puis l'entassement bestiale dans la cage du hall et dans les fourgons. Les heures interminables dans la geôle du palais de justice d'où est absent le médecin avec qui j'avais si bien échangé.
De retour à la prison, j'ai à peine conscience que tout s’est effectivement passé comme la première fois : je n'ai pas eu le temps de prononcer le moindre mot que les policiers m’entraînaient déjà après la décision du juge prise en seulement quelques secondes :
-Report quinze jours !
Les conditions lamentables que voit passer mon quotidien, les codétenus abjects qui m'entourent, la peur constante qui m'habite sont autant d'éléments qui m'ont rendu incapable de me révolter. Je n'ai de toute façon jamais été un combattant dans l'âme, n'ayant jamais vraiment eu besoin d'autre chose que de mon bon sens et de ma réflexion pour réussir dans la vie. Je dois faire face à un sentiment d’avilissement auquel je ne m'étais jamais préparé. Dans ce pays, les étrangers ne sont pas appréciés par les habitants les plus pauvres car nous sommes synonymes d'une richesse à laquelle ils n'auront jamais accès. Il est donc évident qu'étant en minorité dans cet endroit habité par ce que le Maroc peut créer de pire dans sa population, je sois exclu et même un sujet d'opprobre.
Celui que j'exècre le plus est un Arabe ventripotent de cent trente kilos, toujours dégoulinant de sueur crasseuse. A chaque fois que je veux rentrer dans mon DVD et qu'il est assis sur son lit situé juste au-dessus, il prend un malin plaisir à écarter les jambes pour me laisser passer plutôt que de les relever comme le font tous les autres. Devant me glisser entre ses jambes, il rigole fortement, enchanté de pousser l'humiliation à sous entendre que je m'abaisse à lui faire une fellation. Les autres s'amusant tout autant de sa plaisanterie douteuse : je ne bronche jamais. Ils se battent tout autant violemment qu'ils sont capables de feindre la bonne entente dans un intérêt quelconque. A chaque visite, les familles leur apportent un panier avec des denrées alimentaires, ce qui leur permet de se servir de l'unique petit réchaud de la geôle pour cuisiner. Une seule plaque de cuisson pour quatre-vingt-cinq détenus, c'est un défilé constant de 5 heures du matin à minuit. L'odeur de cuisine se mélangeant à la puanteur ambiante, je ne sais pas si je pourrais remanger un tajine un jour.
Les journées défilent dans cette ambiance exécrable, seulement rythmées par les promenades et les pseudos repas dont huit sur dix sont constitués de patates et de carottes à l'eau. Je suis éreinté par la vigilance constante que m'infligent mon entourage et ma peur. La faim et la fatigue m'anesthésient le cerveau à un tel point que je mets du temps à réagir lorsqu'un gardien m’appelle hors de ma cellule.
L'homme qui m'attend au parloir m'explique qu'il est avocat et qu'il vient à la demande du médecin que j'ai rencontré lors de mon premier passage au tribunal. Il précise qu'il a pris connaissance de mon affaire et qu'elle sera simple à régler.
-C'est bien pour cela que je ne pense pas vraiment avoir besoin d'un avocat. Hormis le fait que mon jugement a déjà été reporté trois fois, l'évidence de la situation ne pourra que sauter aux yeux du juge lorsqu'il traitera mon dossier.
-Monsieur Combes, il est de meilleur augure que vous soyez représenté, je serais au tribunal lundi.
Je me laisse convaincre. De toute façon, tout ce qui m’importe : c'est ma sortie. Ce n'est pas parce que la force des choses m'a obligé à m'adapter à la situation que je dois oublier mon innocence et mon but ultime : retrouver ma liberté et rejoindre ma douce aimée. C'est animé de cet espoir que je me présente devant le juge le lundi suivant. Mon avocat est là, comme il me l'avait promis, mais je ne comprends pas son silence lorsque j'entends pour la quatrième fois : report !
M'accrochant à la barre pour ne pas que les policiers m'emmènent, je fulmine :
-Non ! Ça va faire plus d'un mois que je suis emprisonné injustement ! Si vous voulez que je paie ce putain de chèque, je le paie, pour peu que le terrain soit vendable ! Dites-le-moi et dans quarante-huit heures il est honoré !
Mon avocat fronce les sourcils, l'air de me demander de ne pas faire de scandale, mais je n'en peux plus ! Je ne veux pas rester quinze jours de plus à Boulmaharez ! Malgré ma colère, personne ne m'entend, les policiers m'arrachent de la barre et me ramènent sans ménagement.
De retour dans ma cellule, je m'assois sur ma couverture roulée où m'attend un autre prisonnier. Franco-Colombien, Pablo est arrivé il y a quelques jours et nous avons sympathisé. Petit, d'allure sportive, il a grandi dans le milieu de la drogue et c'est presque naturellement qu'il est devenu trafiquant. Hormis les discutions durant lesquelles il me raconte l'univers des stupéfiants qui m'est inconnu, il a une culture générale très poussée qui nous donne la possibilité d'échanger sur un nombre impressionnant de sujets intéressants. Cela me fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui parler.
*
Assis dans la cour avec le Français et Pablo, un Marocain qui dénote un peu des autres par le soin de son apparence, s'approche de nous :
-Vous connaissez Philippe Combes ?
-Oui, c'est moi !
-Vous avez eu un problème avec Brahim Saïd, Mohamed Nakh et Jaouad ?
-Oui tout à fait.
-Je suis ici à cause d'eux.
Intrigué, je me lève et nous nous éloignons un peu du groupe.
-Je m’appelle Sherkaoui, je suis expert-comptable à Marrakech. Ils étaient chargés de la vente de restaurants et m'avaient demandé de préparer les bilans comptables. Juste avant les transactions, ils en ont modifié les chiffres pour les vendre plus chers, mais un des acheteurs s'en est rendu compte et ils m'ont fait porter le chapeau : voilà pourquoi je suis ici. Je sais qu'ils t'ont escroqué aussi, alors si tu as besoin de quoi que ce soit n'hésite pas !
Depuis plusieurs jours, les chaleurs étouffantes de l'été sont arrivées, rendant l'air irrespirable encore plus suffocant. Jusqu'ici, toujours emmitouflé dans ma parka, je dois désormais trouver des solutions pour me rafraîchir. Contre quelques Marquises, j'ai pu agrandir mon trousseau de deux petites bouteilles en plastique et d'une paire de chaussettes. L'une des gourdes me sert de cendrier dans mon DVD et l'autre me permet d'avoir de l'eau à portée de main. Afin de la garder fraîche autant que possible, je la mets dans une des chaussettes que je mouille régulièrement. Avec l’autre, je me suis fait une sorte de sac : après avoir déchiré un bout de sac plastique, je l'ai roulé et légèrement fait fondre avec mon briquet afin d'en faire un lien. J'ai passé ma ficelle artisanale dans les mailles de la chaussette que j'ai attachée à mon cou. Prenant soin de toujours la laisser sous ma chemise, je peux ainsi y ranger le paquet de cigarettes écrasé qui me sert de portefeuille, mes couverts et tous autres petits effets que j'ai besoin d'avoir sur moi. Le système D carcéral commence à ne plus avoir de secret pour moi, mais qu’un Marocain qui semble être respecté par les autres me propose son aide, me rassure quelque peu.
Avec ces nouvelles températures caniculaires, je dois remettre en question mon refus de prendre une douche. Nous en avons parlé avec les quelques Européens que je fréquente. Tous infestés de puces, de poux et de tiques qui nous piquent constamment, énervés par la chaleur, nous avons décidé de réquisitionner un des tuyaux de douche afin de pouvoir nous laver entre nous sans devoir nous mêler aux autres. Mais, quitte à me sentir propre, une dernière chose me pose souci et je décide d'accepter l'aide de Sherkaoui :
-Écoute, cela fait plus d'un mois que je suis ici et que je n'ai pas pu laver mes vêtements car je n'ai rien pour me changer.
-T'inquiète ! Passe me voir dans ma cellule dans dix minutes, je vais te trouver ça.
Je manque d'éclater de rire lorsqu’après l'avoir rejoint il me tend un de ses pantalons. Sachant qu'il fait minimum cinquante kilos de plus que moi, je pourrais y rentrer quatre hommes de mon gabarit ! J'imagine à quel point mon accoutrement doit être grotesque lorsque je m'attaque au lavage de mes vêtements : ma douche prise, mais n'ayant pu, ni me coiffer, ni me raser, je devais ressembler à un clown avec mon bas de jogging dix fois trop grand pour moi.
Afficher en entierCommentaires récents
Carole Léautaud
5,0 sur 5 étoiles Un récit fascinant !
Commenté en France le 2 mai 2020
J’ai littéralement dévoré ce livre.
Une fois commencé, je n’ai jamais pu le refermer.
Je l’ai lu d’une traite ce qui m’a empêché de dormir. Mais je n’aurais jamais pu abandonner le héros dans ses tribulations incroyables.
Un récit passionnant.
Un style lisse qui coule comme une évidence, sans fioritures, avec toujours les mots justes.
Une sorte de thriller qui tient le lecteur en haleine du début au dénouement.
Le héros est incarcéré de manière injuste dans les prisons du Maroc puisqu’il est innocent.
Le lecteur est tenu en haleine de demandes de libération avortées en sévices monstrueux.
Il espère à chaque ligne avec ce Français, homme d’affaires respecté, réduit du jour au lendemain à l’état de bagnard ou de galérien d’un autre temps.
Il vibre avec lui au rythme des tortures révoltantes qu’il subit et qui émanent pourtant d’un pays touristique et politiquement correct.
Les scènes d’amour sont distillées comme des cris de désespoir déchirants lancés dans le désert.
On meurt d’envie de le défendre, de brandir des étendards pour sa libération.
Ce qui est étonnant ? Les rebondissements.
On ne s’ennuie jamais dans ces abimes moyenâgeuses qu’il côtoie et décrit si brillamment.
On l’accompagne dans la guerre désespérée qu’il livre pour survivre.
Lisez-le! C’est une pure merveille! Il me tarde de le voir adapté au cinéma! Je verrais bien Bradley Cooper dans le rôle de Philippe Combes.
On aurait tous pu vivre une telle tragédie.
On frémit à cette idée.
Afficher en entierAnnonce publicitaire
Date de sortie
Prisoner n° 73863
- France : 2018-02-06 - Poche (Français)


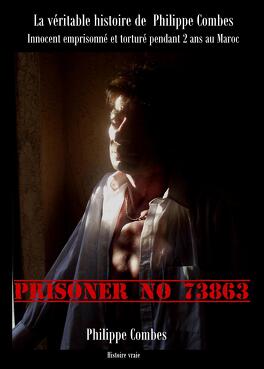




























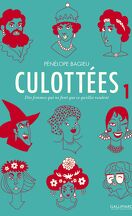






































Résumé
Vous avez aimé « Midnight Express », vous allez adorer ce récit bouleversant et poignant.La véritable histoire de Philippe Combes emprisonné pendant deux ans au Maroc. Cette histoire ne se déroule pas dans les années 70 à l'autre bout du monde mais aujourd'hui et à seulement 18 kilomètres de l'Europe. Philippe Combes est un homme d’affaires réputé et heureux. Il coule des jours empreints de bonheur avec sa compagne depuis plus de deux ans, quand ils décident de partir tous les deux pour Marrakech. Une nouvelle vie dans la continuité du bonheur quotidien qu’ils partagent. Le Maroc devient rapidement une terre d’accueil chaleureuse et ils en tombent aussi profondément amoureux qu’ils le sont l’un de l’autre. Pendant un an, ils vont s’investir personnellement et professionnellement afin d’apporter leur contribution à l’évolution de ce pays qui leur est cher. Une seule rencontre avec trois de ses ressortissants va pourtant tout faire basculer. A travers ce récit, vous allez découvrir le monde judiciaire et carcéral dans ce qu’il existe de plus terrible : humilié, battu, torturé, déshumanisé, Philippe n’aura que sa force et sa dignité pour tenir debout. Vous allez comprendre comment, en toute connaissance de cause, le pays des Droits de l’Homme a laissé un de ses concitoyens croupir dans ce qu’il existe de pire comme prison en ce monde. Livré à lui-même, vous découvrirez le quotidien d’un homme qui n’aura pour seul but que de survivre pour recouvrer sa liberté.
« Si vous étiez le premier de vos amis à lire PRISONER NO 73863 , vous recommanderiez absolument ce récit. » The Sun
« L'intrigue de ce récit est vertigineuse. PRISONER N° 73863 est un livre puissant, sans échappatoire, mais profondément émouvant et sincère. À couper le souffle. » C. L. Taylor
« Captivant et bien mené. » The Sunday Mirror
« Une histoire vraie, passionnante et exaltante. » Rachel Rhys
« Les lecteurs d'histoires fortes vont adorer. » - Library Journal
« Une intrigue menée de main de maître ! On retient son souffle jusqu’à la dernière page. » - New York Times
« Un suspense haletant. » - Sunday Express
« Une histoire très efficace, un suspense à couper le souffle, une grande humanité. » - Herald
Afficher en entier